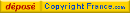Ossian GANI
Analyse critique de l’usage de la culture dans la ville nÃĐo-libÃĐrale
 La ville est une construction complexe, dans laquelle sâentremÊlent un espace objectivÃĐ par des approches scientifiques (gÃĐomÃĐtrie, gÃĐographie, cartographie) ou thÃĐoriques (urbanisme, planification) et un espace vÃĐcu, perçu, mental. Elle est ÃĐgalement un produit social, soit une retranscription des rapports de production et des rapports culturels. En ce sens, la ville nâest pas un espace neutre, elle est au contraire instrumentale, puisquâil sâagit dâun ÂŦ lieu et milieu oÃđ se dÃĐploient des stratÃĐgies, oÃđ elles sâaffrontent. Âŧ[1]
La ville est une construction complexe, dans laquelle sâentremÊlent un espace objectivÃĐ par des approches scientifiques (gÃĐomÃĐtrie, gÃĐographie, cartographie) ou thÃĐoriques (urbanisme, planification) et un espace vÃĐcu, perçu, mental. Elle est ÃĐgalement un produit social, soit une retranscription des rapports de production et des rapports culturels. En ce sens, la ville nâest pas un espace neutre, elle est au contraire instrumentale, puisquâil sâagit dâun ÂŦ lieu et milieu oÃđ se dÃĐploient des stratÃĐgies, oÃđ elles sâaffrontent. Âŧ[1]
Ainsi les soulÃĻvements populaires parisiens de 1830 et surtout de 1848 ont entraÃŪnÃĐ une rÃĐaction urbanistique. Avant la deuxiÃĻme moitiÃĐ du XIXÃĻme siÃĻcle, les ouvriers et les bourgeois cohabitaient dans certains quartiers comme le Marais à Paris. Les ÃĐtages bas ÃĐtaient habitÃĐs par les bourgeois, les hauts ÃĐtages par les ouvriers (division verticale). Cette situation a commencÃĐ Ã se modifier avec les premiers travaux dâurbanisme moderne parisien (Londres les avait dÃĐjà expÃĐrimentÃĐs suite à lâincendie de la ville au XVIIÃĻme siÃĻcle) : les travaux du baron Haussmann entament la planification spatiale de la ville capitaliste. Il sâagit dâune part de favoriser le transfert des flux dans le cadre du capitalisme industriel â transport de matiÃĻres premiÃĻres, de produits manufacturÃĐs et de la main-dâÅuvre â et dâassurer un contrÃīle social â le boulevard permettant à lâarmÃĐe de charger et de tirer au canon[2].
Le changement profond liÃĐ au passage du paradigme productif â dâune sociÃĐtÃĐ de la raretÃĐ â au paradigme consumÃĐriste â dâune sociÃĐtÃĐ de lâabondance â quâa connu lâensemble des Etats occidentaux une fois les reconstructions liÃĐes à la Seconde Guerre mondiale effectuÃĐes a eu une incidence sur la composition sociale de la ville. La classe possÃĐdante a conservÃĐ et poursuivi le processus de rÃĐorganisation de la ville à son image, mais selon une violence plus discrÃĻte nommÃĐ tantÃīt renouvellement, rÃĐgÃĐnÃĐration, requalification, revitalisation ou renaissance. La classe populaire se trouve expulsÃĐe vers des pÃĐriphÃĐries de plus en plus lointaines, sous la double pression de la spÃĐculation immobiliÃĻre â attaque ÃĐconomique â et de la promotion dâun ÂŦ art de vivre Âŧ qui lui correspond fort peu[3] – attaque culturelle, des centres-ville. La ville se trouve ainsi Être un ÂŦ phÃĐnomÃĻne de classe Âŧ oÃđ devrait se rÃĐvÃĐler la conflictualitÃĐ sociale[4].
Or, un ensemble de concepts liÃĐs à la ville (la mixitÃĐ, le vivre-ensemble, la vie de quartier, la convivialitÃĐ) tend à effacer et à nier toutes rÃĐfÃĐrences aux tensions sociales et aux classes sociales dans une sociÃĐtÃĐ prÃĐsentÃĐe comme dÃĐsormais rÃĐconciliÃĐe avec elle-mÊme â ou ayant le devoir de le faire[5].
Cette ÃĐvolution de la ville et du langage qui lâaccompagne est soutenue et portÃĐe par le type de culture et de comportements culturels promus par les industries de lâÃĐloge culturel (de Walt Disney à TÃĐlÃĐrama) suivies par les politiques locales. Le ÂŦ renouvellement urbain Âŧ se pare de ses beaux habits culturels pour tenter de cacher la rÃĐalitÃĐ de la violence sociale quâimplique toute politique urbaine ne tenant que peu compte de la rÃĐalitÃĐ existante. La thÃĐmatique de lâinstallation de lieux vouÃĐs à la culture ou dâÃĐvÃĐnements culturo-festifs rÃĐpond ainsi à un double impÃĐratif : masquer la conflictualitÃĐ et sÃĐduire les forces en prÃĐsence. Le renouvellement urbain vise ainsi, à lâaide de la culture, à façonner lâespace urbain en renouvelant la population pour mieux la faire coÃŊncider avec la nouvelle vocation dÃĐvolue à la ville : une production de lâespace conforme à la nouvelle ÃĐconomie de lâinformation et de la communication[6]. Le rÃīle ÃĐmancipateur de la culture sâefface ainsi, à coups de subventions ÃĐtatiques, au profit dâune culture garante de lâordre ÃĐtabli et dâune valorisation du mode de vie et de consommation libÃĐral. La ville nÃĐo-libÃĐrale tend ainsi à devenir un espace de consommation grimÃĐ en parc dâattraction.
Les acteurs de lâem-nÃĐobourgeoisement des quartiers populaires
Les quartiers populaires des moyennes et grandes villes se trouvent pris dans un phÃĐnomÃĻne dâappropriation progressive par les ÃĐlites urbaines, classe moyenne supÃĐrieure en tÊte. Pour dÃĐsigner ce phÃĐnomÃĻne, le terme ÂŦ gentrification Âŧ a ÃĐtÃĐ formÃĐ. ForgÃĐ Ã partir de lâanglais gentry, signifiant en premier lieu petite noblesse, mais dÃĐsignant par extension la bonne sociÃĐtÃĐ, le terme a ÃĐtÃĐ utilisÃĐ la premiÃĻre fois
 au dÃĐbut des annÃĐes 1960 pour dÃĐfinir lâinstallation dans des quartiers dÃĐfavorisÃĐs du centre londonien de population de la classe moyenne, alors que le schÃĐma dominant ÃĐtait jusque là de sâinstaller dans la pÃĐriphÃĐrie rÃĐsidentielle. Pour notre part, nous privilÃĐgierons le terme dâem-nÃĐobourgeoisement (contraction dâembourgeoisement et de nÃĐo-bourgeois) pour distinguer la nÃĐo-bourgeoisie de la bonne sociÃĐtÃĐ, qui nâest pas concernÃĐe par le processus que nous tentons de cerner.
au dÃĐbut des annÃĐes 1960 pour dÃĐfinir lâinstallation dans des quartiers dÃĐfavorisÃĐs du centre londonien de population de la classe moyenne, alors que le schÃĐma dominant ÃĐtait jusque là de sâinstaller dans la pÃĐriphÃĐrie rÃĐsidentielle. Pour notre part, nous privilÃĐgierons le terme dâem-nÃĐobourgeoisement (contraction dâembourgeoisement et de nÃĐo-bourgeois) pour distinguer la nÃĐo-bourgeoisie de la bonne sociÃĐtÃĐ, qui nâest pas concernÃĐe par le processus que nous tentons de cerner.
Ce changement est en lien avec le nÃĐo-libÃĐralisme qui a replacÃĐ la ville au centre de son systÃĻme. Lâindustrialisation a engendrÃĐ une urbanisation des villes selon un processus dâimplosion/explosion dÃĐcrit par Henri Lefebvre : les ouvriers affluent en ville et sây entassent oÃđ ils peuvent (implosion) pendant que des industries continuent de sâinstaller en bordure de la ville crÃĐant un ÃĐtalement urbain (explosion)[7]. Lâurbanisation liÃĐe à lâindustrialisation nâimplique pas une planification capitaliste de lâurbain ; des tentatives peuvent voir le jour (citÃĐs ouvriÃĻres, patrons paternalistes). DÃĐsormais il semble, au contraire, que lâurbanisation planifiÃĐe soutient le capitalisme : par lâaction du marchÃĐ (capital foncier en partie spÃĐculatif) et par lâaction ÃĐtatique (construction de la ville et de structures favorables à lâexpansion de lâÃĐconomie capitaliste à lâexclusion de toute autre).
Lâensemble des villes est ainsi touchÃĐ par le phÃĐnomÃĻne dâem-nÃĐobourgeoisement. Les villes dÃĐveloppÃĐes de lâÃĐconomie capitaliste, Londres, New York, Paris, ont ÃĐtÃĐ les premiÃĻres atteintes par le phÃĐnomÃĻne, qui sâÃĐtend dÃĐsormais aux villes durement touchÃĐes par la dÃĐsindustrialisation : Liverpool, Roubaix, Bilbao ou Glasgow par exemple.
Le nÃĐo-bourgeois
Chaque acteur de lâem-nÃĐobourgeoisement des quartiers populaires relÃĻve dâun intÃĐrÊt particulier et est mÃŧ par un ÂŦ vice Âŧ libÃĐral[8] : dÃĐsir de jouissance immÃĐdiate (le nÃĐo-bourgeois), ÃĐgoÃŊsme calculateur (le dÃĐlinquant) et intÃĐrÊt ÃĐconomique et/ou politique composant dans leur ensemble lâÃĐthique nÃĐo-libÃĐrale (ou le comment agir au mieux de maniÃĻre libÃĐrale).
Le rÃīle principal dans le processus de lâem-nÃĐobourgeoisement est jouÃĐ par les ÂŦ classes moyennes intellectuelles Âŧ. Pour parer à la difficultÃĐ de dÃĐfinition de cette catÃĐgorie socioprofessionnelle composite, nous dÃĐfinissons ces acteurs selon la place quâils occupent dans le processus de production en reprenant la division mise en place par Michel Clouscard : il sâagit de la partie du salariat qui, dans le cadre de la division capitaliste du travail, est chargÃĐe de lâanimation (versant culturel) et de lâencadrement (versant ÃĐconomique) du libÃĐralisme libertaire[9]. Elle assure la gestion de lâÃĐconomie capitaliste, pour la bourgeoisie, sans possÃĐder ni le Capital ni les moyens de production. Bourgeoise, elle sâest nÃĐanmoins crue un instant la tÊte de proue du navire contestataire voguant vers la libÃĐration des masses. La tension entre ces deux pÃīles a connu un renversement en France à la suite du mai 68 ÃĐtudiant et, lors de ses ÃĐquivalents en Europe (Italie) ou lors de mouvements plus limitÃĐs (Angleterre) lorsque la bourgeoisie de capital a acquis à sa cause ses ÂŦ nouvelles ÃĐlites intellectuelles Âŧ[10].
Ce passage les marque dâun pÃĐchÃĐ originel : lâinconscient de classe, puisque celle-ci ne prend pas conscience du processus historique dont elle est issue et quâelle mÃĐconnait son rÃīle dans la perpÃĐtuation des rapports sociaux. Le nÃĐo-bourgeois se construit dans une double opposition formelle : contre la bourgeoisie traditionnelle et contre la classe populaire, deux avatars dâun monde ancien. Son regard sur son environnement est façonnÃĐ par son dÃĐsir, dÃĐsir qui ne peut Être que prÃĐsent ou projetÃĐ dans un futur proche.
De maniÃĻre gÃĐnÃĐrale, cette classe moyenne sâinsÃĻre dans la stratÃĐgie libÃĐrale dont elle est la publicitÃĐ et dont elle promeut lâidÃĐologie. Individualiste, sa sensibilitÃĐ aux problÃĻmes sociÃĐtaux (homosexualitÃĐ, ÃĐcologisme, fÃĐminisme et plus rÃĐcemment le combat contre la fessÃĐe) va de pair avec un dÃĐsintÃĐrÊt pour les problÃĻmes rÃĐellement sociaux (aliÃĐnation, critique de la quotidiennetÃĐ, marchandisation, thÃĐmatiques pourtant prÃĐgnantes dans les annÃĐes 1960, mais vite abandonnÃĐes).
La puissance de ÂŦ contagion Âŧ de ces nÃĐo-bourgeois accentue au contraire lâaliÃĐnation de la classe populaire par la valorisation de leur style de vie et de la consommation subversive officielle. Leur style de vie libÃĐral-libertaire tendant à devenir mode de vie, psittacisme du capitalisme.
Lâartiste en ÂŦ crÃĐateur Âŧ
Dans la reprÃĐsentation contemporaine, lâartiste incarne une forme souhaitable du travailleur moderne : lâindividuel en place du collectif, lâinnÃĐ et non lâacquis, la prÃĐcaritÃĐ et non la sÃĐcuritÃĐ[11]. Cette construction est le fruit de la lutte pour la reconnaissance du statut dâartiste (la Renaissance) et la volontÃĐ de distinction qui en dÃĐcoule (la BohÃĻme).
Le BohÃĻme a ÃĐtÃĐ le refus aristocratique de la vie bourgeoise marquÃĐe par la rÃĐussite matÃĐrielle et les valeurs de la famille. Refuge de certains aristocrates dÃĐpossÃĐdÃĐs de rÃīle politique, elle marque le glissement de lâart au service du prince (dâApelle et Alexandre le Grand à Le NÃītre et Louis XIV en passant par Titien et Charles Quint) à lâart pour soi-mÊme (lâArt pour lâArt, lâartiste maudit et lâincompris). Ainsi au refus des valeurs bourgeoises, à lâaristocratisation du statut de lâartiste rÃĐpond paradoxalement un non-rejet de la sociÃĐtÃĐ bourgeoise. En effet, suite au coup dâarrÊt donnÃĐ au mÃĐcÃĐnat royal, princier ou ecclÃĐsiastique, lâartiste est ÃĐconomiquement dÃĐpendant de la bourgeoisie par le dÃĐveloppement du marchÃĐ de lâart. La BohÃĻme est la crise dâadolescence de lâartiste cherchant la reconnaissance de la bourgeoisie : on en refuse les valeurs, mais on en accepte lâargent.
Les fondements de cette ÃĐvolution sont dÃĐjà visibles au XVIIIÃĻme siÃĻcle, qui a vu lâÃĐmergence du ÂŦ Grand Public Âŧ[12] suite à la prise de distance de la sociÃĐtÃĐ aristocratique et de la haute-bourgeoisie vis-à -vis de la sociÃĐtÃĐ de cour. Ce nouveau public, bien dÃĐfini à partir de 1750, entraÃŪne une nouvelle production (nouveau goÃŧt) accompagnÃĐe dâun nouveau discours sur le rÃīle de lâart : le gÃĐnie contre les AcadÃĐmies. Le XVIIIÃĻme siÃĻcle libÃĐral commence ainsi à parler de lâartiste comme un crÃĐateur.
Avec le libÃĐralisme dÃĐveloppÃĐ en systÃĻme ÃĐconomique â le capitalisme, lâartiste est relÃĐguÃĐ Ã un statut social qui lui est propre :
ÂŦ (âĶ) ce qui est reconnu nâest plus lâÅuvre. Câest lâartiste qui est Åuvre. Ce qui est agrÃĐÃĐ, ce nâest pas lâesthÃĐtique, mais un mode dâexistence, une pratique, un vÃĐcu : le statut de la marginalitÃĐ. Âŧ[13].
Si auparavant il pouvait symboliser une ÃĐchappatoire au travail, ou au moins au travail aliÃĐnant, il incarne dÃĐsormais une nouvelle version du travail aliÃĐnant, en ÃĐtant dÃĐpossÃĐdÃĐ de ses moyens symboliques de production (la pensÃĐe â lâidÃĐe) et de sa production (lâÅuvre) au profit de sa reprÃĐsentation : le statut social. Son nouveau statut social engage un refus de la production au profit de la crÃĐation, maniÃĻre noble et distinctive de signifier la crÃĐation de richesse. Lâartiste satisfait lâidÃĐal capitaliste dâun travail spÃĐcialisÃĐ Ã forte valeur ajoutÃĐe. En outre, il promeut dans son travail la flexibilitÃĐ assumÃĐe et ÃĐrigÃĐe en libertÃĐ. Ce passage de la sÃĐquence artiste – art (pensÃĐe) – Åuvre à la sÃĐquence artiste – culture (idÃĐologie) – crÃĐation a trouvÃĐ sa rÃĐalisation dans la figure du crÃĐateur. Bon grÃĐ, mal grÃĐ, la crÃĐation porte en elle le statut dâartiste, dâoÃđ une inflation des termes dâartiste et dâartistique sans que lâart sâen sorte grandi. Sous lâacception ÂŦ crÃĐateur Âŧ on trouvera dÃĐsormais aussi bien le publicitaire, le graphiste, le dÃĐcorateur dâintÃĐrieur, le designer, le couturier, le jardinier. Socrate est mortel, Jean-Paul Gaultier est un artiste.
Les dÃĐlinquants de quartier, forme contemporaine du LumpenprolÃĐtariat
Son rÃīle est marquÃĐ du sceau de lâambiguÃŊtÃĐ, mais par bien des aspects le dÃĐlinquant est lâalliÃĐ objectif du nÃĐo-bourgeois.
Selon Jean-Claude MichÃĐa, le rapport entre dÃĐlinquance et libÃĐralisme nâest pas à dÃĐfinir comme un rapport dâexclusion, mais au contraire dans un rapport dâinclusion[14]. Ce nâest pas la misÃĻre engendrÃĐe par le systÃĻme ÃĐconomique qui crÃĐe le dÃĐlinquant â pas plus que la richesse crÃĐÃĐe ne produit de lâhonnÊtetÃĐ ou le sens du don, mais celui-ci symbolise un autre mode dâintÃĐgration au libÃĐralisme. Il en reproduit à son ÃĐchelle les traits et les valeurs constitutifs : ÃĐgoÃŊsme calculateur, gain maximal, compÃĐtition, rejet des entraves au commerce ou encore rÃĐussite matÃĐrielle. Au contraire, la dÃĐlinquance ÂŦ gratuite Âŧ[15] mine une des derniÃĻres prÃĐrogatives (ÃĐvidente car visible) de lâEtat, la sÃĐcuritÃĐ intÃĐrieure. La dÃĐliquescence de la puissance ÃĐtatique entamÃĐe dans le domaine ÃĐconomique et politique par le capitalisme se poursuit dans les quartiers par la dÃĐlinquance[16]. En outre, la dÃĐlinquance organisÃĐe (grand banditisme, mafias) est complÃĐmentaire de la dÃĐlinquance en col blanc (marchÃĐ illicite, circuit monÃĐtaire parallÃĻle et blanchiment dâargent) sans compter la florissante industrie de lâapologie de la ÂŦ racaille Âŧ (rap hardcore, cinÃĐma et produits dÃĐrivÃĐs). Le ÂŦ sauvageon Âŧ ou la ÂŦ racaille Âŧ, selon quâon adopte une critique de gauche ou de droite de la dÃĐlinquance, nâest que le produit brut du capitalisme, dÃĐbarrassÃĐ de ses adversaires (rÃĐpublicanisme, socialisme et mÊme droite de tradition bonapartiste)[17].
Une telle situation ne peut que dÃĐtruire les formes de sociabilitÃĐ qui naissaient spontanÃĐment et sâincarnaient dans des lieux spÃĐcifiques (le cafÃĐ, le parc, la place). Cette sociabilitÃĐ ouverte se remplace par une sociabilitÃĐ fermÃĐe â la rÃĐunion dâhabitants excÃĐdÃĐs par la violence et la dÃĐgradation de la qualitÃĐ de vie, caution morale et locale de lâentreprise de renouvellement urbain. Or, les ÃĐtudes sur la ville amÃĐricaine ont dÃĐmontrÃĐ le rÃīle des stratÃĐgies de sÃĐcurisation et de contrÃīle de lâespace dans le renouvellement urbain, jusquâà dÃĐboucher sur les ÂŦ gated communities Âŧ. Si lâÃĐquivalent amÃĐricain des ÂŦ communautÃĐs fermÃĐes Âŧ ne sâest pas encore exportÃĐ stricto sensu en Europe, la nÃĐcessitÃĐ de lâintervention pour lutter contre la dÃĐlinquance et revaloriser ainsi lâimage du quartier est une ÃĐvidence. Lâem-nÃĐobourgeoisement de New York sâest ainsi construit sur la thÃĐmatique de la tolÃĐrance zÃĐro dans les annÃĐes 1980 reprise ensuite à Londres. La dÃĐlinquance de quartier ouvre ainsi le processus de requalification de quartiers.

 mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-
mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-