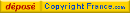Processus et finalitÃĐ de lâem-nÃĐobourgeoisement des quartiers populaires
Deux modalitÃĐs de gentrification sont gÃĐnÃĐralement reconnues : la gentrification par la rÃĐsidence et la gentrification par la consommation[18]. Cette distinction nâest cependant pas opÃĐrante ; sâil existe bien des multiplicitÃĐs de modalitÃĐs de lâappropriation bourgeoise et capitaliste de lâespace, celle-ci varie plutÃīt selon lâhistoire propre à la ville (industrialisation prÃĐcoce ou non, type dâindustrie, niveau dâinsertion dans lâÃĐconomie mondialisÃĐe, prÃĐsence dâun bÃĒti historique ou dâespaces atypiques). La distinction des deux types dâappropriation est le fruit de deux erreurs :
a. une erreur ÃĐpistÃĐmologique, inspirÃĐe par le postulat idÃĐologique de la neutralitÃĐ de lâespace, qui consiste à considÃĐrer lâhabitat et le logement comme une problÃĐmatique spÃĐcifique.
b. la constance et la cohÃĐrence du phÃĐnomÃĻne se trouvant dans les rapports de production.
LâÃĐvincement des classes populaires par les politiques locatives
AprÃĻs la pÃĐriode dans laquelle rÃĐnovation rimait (câest le cas de la place des FÊtes dans le XIXÃĻme arrondissement de Paris) avec destruction-reconstruction a succÃĐdÃĐ une pÃĐriode de rÃĐhabilitation, cherchant à sauvegarder le patrimoine architectural. Cette ÃĐvolution rÃĐsulte dâune rÃĐorientation du rÃīle ÃĐconomique de la ville. Dans la ville capitaliste du XIXÃĻme siÃĻcle et de la premiÃĻre moitiÃĐ du XXÃĻme siÃĻcle, la prÃĐsence de la classe populaire se justifiait par la structure du systÃĻme de production : la ville regroupait la production matÃĐrielle et donc la main-dâÅuvre. La transformation de la ville capitaliste industrielle en ville capitaliste informationnelle dÃĐbouche sur une ÂŦ inutilitÃĐ Âŧ partielle de la prÃĐsence en ville de la main-dâÅuvre, phÃĐnomÃĻne accentuÃĐ par le dÃĐveloppement du rÃĐseau de transports en commun. Ce nâest plus en ville que doit rÃĐsider la ÂŦ surpopulation flottante Âŧ, puisque la part dâemployÃĐs non-qualifiÃĐs nÃĐcessaire y dÃĐcroÃŪt. La rÃĐhabilitation du 65-67 rue du faubourg Saint-Martin dans le XÃĻme arrondissement de Paris illustre le changement de paradigme : lâimmeuble arbore lâinscription ÂŦ Aux classes laborieuses Âŧ, vestige dâun ancien magasin spÃĐcialisÃĐ dans les tenues de travail. Il accueille dÃĐsormais un bureau de lâagence de publicitÃĐ BETC, filiale dâEuro RSCG. Lâinscription a ÃĐvidemment ÃĐtÃĐ conservÃĐe, mais les classes laborieuses remplacÃĐes, les cols blancs ont succÃĐdÃĐ aux cols bleus[19].
Le parc social est ÃĐgalement touchÃĐ par ce mouvement de ÂŦ rÃĐhabilitation Âŧ. Ainsi en Angleterre, la politique mise en place dans les annÃĐes 1980 du right to buy de logements sociaux a crÃĐÃĐ une sÃĐgrÃĐgation entre les zones attractives et les zones dÃĐlabrÃĐes. Entre 1971 et 2003, la part de logements sociaux est passÃĐe de 30% à 18%, les investisseurs dÃĐlaissant le parc social au profit du parc privÃĐ. La politique française dâaccession à la propriÃĐtÃĐ inaugurÃĐe par les ministres de la ville du gouvernement Fillon ne va pas crÃĐer une situation diffÃĐrente.
Quant aux constructions de logements sociaux, la situation nâest guÃĻre meilleure pour les mÃĐnages les plus modestes. Suite à la loi Borloo sur le logement en 2003, une sÃĐrie de chantiers est lancÃĐe dans le secteur de lâhabitat. Les destructions de bÃĒtiments sont encouragÃĐes (en banlieue) afin dâen reconstruire de nouveaux, selon la rÃĻgle un bÃĒtiment dÃĐtruit un bÃĒtiment reconstruit. Or, lâObservatoire des zones urbaines sensibles a notÃĐ dans son rapport 2009 que :
ÂŦ la diversification par lâhabitat vise à implanter dans les quartiers de lâhabitat privÃĐ et de lâhabitat social intermÃĐdiaire (de moyenne et haute gamme), en vue dâattirer de nouvelles populations. Âŧ.
Ainsi les constructions ont essentiellement concernÃĐ le logement en accession à la propriÃĐtÃĐ (53% des livraisons) et le logement locatif intermÃĐdiaires (13%)[20]. Dâautre part, les constructions concernent principalement les logements de taille modeste, alors que les destructions sâattaquent en prioritÃĐ aux grands logements[21].
 Les rÃĐhabilitations de quartiers entiers entraÃŪnent ÃĐgalement une autre consÃĐquence perverse : la fin du logement social de fait dans le parc privÃĐ. Si la nÃĐcessitÃĐ de la rÃĐnovation de cet habitat souvent insalubre ne peut Être remis en cause, lâengagement de moyens financiers consÃĐquents semble autoriser le promoteur à expulser les locataires et aux propriÃĐtaires à augmenter les loyers. A lâÃĐvidence, malgrÃĐ un discours intÃĐgrateur, la rÃĐhabilitation ne bÃĐnÃĐficie pas, et ne peut bÃĐnÃĐficier, aux anciens locataires.
Les rÃĐhabilitations de quartiers entiers entraÃŪnent ÃĐgalement une autre consÃĐquence perverse : la fin du logement social de fait dans le parc privÃĐ. Si la nÃĐcessitÃĐ de la rÃĐnovation de cet habitat souvent insalubre ne peut Être remis en cause, lâengagement de moyens financiers consÃĐquents semble autoriser le promoteur à expulser les locataires et aux propriÃĐtaires à augmenter les loyers. A lâÃĐvidence, malgrÃĐ un discours intÃĐgrateur, la rÃĐhabilitation ne bÃĐnÃĐficie pas, et ne peut bÃĐnÃĐficier, aux anciens locataires.
Le pauvre, un produit dâappel ? Le credo urbain de la ÂŦ mixitÃĐ sociale Âŧ
Lâimplication des acteurs institutionnels dans lâem-nÃĐobourgeoisement des villes est particuliÃĻrement visible dans le cas de lâAngleterre. Les Travaillistes ont placÃĐ la question urbaine au centre de leur prÃĐoccupation, alors que la politique urbaine des Tories ÃĐtait marquÃĐe par la primautÃĐ laissÃĐe au secteur privÃĐ[22]. Lâarchitecte Richard Rogers est chargÃĐ par Tony Blair dâune ÃĐtude sur les raisons de lâaffaiblissement du rÃīle de la ville. LâÃĐtude de cent propositions nommÃĐe ÂŦ Urban Task Force[23] Âŧ remise en 1999 consacre le vocabulaire de la renaissance urbaine. Le programme le Livre Blanc Urbain de 2000 reprend de nombreuses propositions de lâUrban Task Force. La volontÃĐ dâinstaller les classes moyennes en ville, en lieu et place des classes populaires, y apparaÃŪt clairement sous un discours promouvant la mixitÃĐ sociale et lâÃĐgalitÃĐ des chances.
NÃĐanmoins la mixitÃĐ sociale, aussi bien en France quâen Angleterre, est entendue exclusivement comme mixitÃĐ rÃĐsidentielle. Or, si cohabitation rÃĐsidentielle il peut y avoir, on ne peut pour autant parler de mixitÃĐ. La renaissance urbaine anglaise et la politique de la ville française posent comme une ÃĐvidence deux ÃĐlÃĐments distincts : la nÃĐcessitÃĐ de lutter contre les poches de pauvretÃĐ prÃĐsente en ville par lâinstallation de la classe moyenne dans ces quartiers. LâidÃĐe qui sous-tend cette construction idÃĐologique est que lâarrivÃĐe des classes moyennes dans des quartiers pauvres ne peut que favoriser lâintÃĐgration des pauvres dans lâÃĐconomie. Or, lâincompatibilitÃĐ des deux ÃĐlÃĐments est patente, ne serait-ce que par le simple principe physique des vases communicants : lâarrivÃĐe de nouveaux habitants implique nÃĐcessairement le dÃĐpart dâautres habitants. Lâaspect historique de la composition et de la dÃĐmographie de Paris le prouve : la capitale française fut pendant longtemps une ville plus populaire que la moyenne française, la perte dâhabitants entre 1950 et aujourdâhui (dâenviron 3.000.000 à environ 2.100.000) a officialisÃĐ son passage en ville bourgeoise.
En outre, lâutilisation de lâespace par les nouveaux arrivants ÃĐtait diffÃĐrent car le mode de consommation est distinct entre classes sociales et que les espaces frÃĐquentÃĐs nâÃĐtaient pas similaires : ÃĐcoles diffÃĐrentes, cafÃĐs diffÃĐrents. La nÃĐo-bourgeoisie, malgrÃĐ un discours dâouverture, se caractÃĐrise, à lâimage de la bourgeoisie traditionnelle, par un entre-soi[24]. Cela sâinaugure dÃĻs le plus jeune ÃĒge avec le dÃĐveloppement des crÃĻches parentales parmi la nÃĐo-bourgeoisie, suivi par le dÃĐtournement de la carte scolaire pour inscrire les enfants dans des ÃĐtablissements mieux cotÃĐs.
Le culturel au sens large semble Être le seul domaine dans lequel la nÃĐo-bourgeoisie sâautorise la diversitÃĐ et la mixitÃĐ sociale, mais dans un cadre de consommation libÃĐrale mondialisÃĐe et dans un rapport net de domination : cuisine, artisanat, mode ou art[25]. En ce sens, le nÃĐo-bourgeois consomme symboliquement du pauvre, de la mÊme maniÃĻre que par le tourisme il consomme de lâautre. La magie de la globalisation et des mouvements de travailleurs immigrÃĐs lui permet de consommer les deux à la fois et prÃĻs de chez lui.
Culture et ville crÃĐative
Le gÃĐographe Richard Florida rattache lâattractivitÃĐ dâune ville et la prÃĐsence de la classe crÃĐative, qui se caractÃĐrise par la technologie, le talent et la tolÃĐrance[26]. Sa dÃĐfinition de la classe crÃĐative est relativement floue : il y englobe des catÃĐgories professionnelles (scientifiques, ÃĐcrivains, avocats, analystes financiersâĶ) et des catÃĐgories ÂŦ sociÃĐtales Âŧ (communautÃĐ homosexuelle, scÃĻne rockâĶ). Si les thÃĐories de Florida ne sont pas trÃĻs novatrices dans le lien existant entre capital humain et dÃĐveloppement ÃĐconomique, elles semblent de plus confondre ce qui relÃĻve des causes et ce qui relÃĻve des consÃĐquences. En effet, il postule que la prÃĐsence de la classe crÃĐative est la cause nÃĐcessaire et suffisante du dÃĐveloppement ÃĐconomique, alors quâau contraire, la classe crÃĐative, population largement mobile, se dirige vers les zones ÃĐconomiquement prospÃĻres[27].
En rÃĐsumÃĐ, pour R. Florida, une ville attractive est une ville oÃđ la classe qui doit Être attirÃĐe est attirÃĐe ; thÃĐorie tautologique (mais il est vrai que tourner en rond implique un mouvement, mouvement mÊme du nÃĐo-libÃĐralisme), mais thÃĐorie qui rÃĐsonne aux oreilles des dÃĐcideurs, attentifs à toute idÃĐe nouvelle. Selon lui, les villes doivent adapter les politiques afin de servir au mieux les intÃĐrÊts et les besoins de cette classe. Il en appelle ainsi à une ÂŦ mÃĐtamorphose branchÃĐe Âŧ des villes pour favoriser la crÃĐation[28]. On retrouve une telle idÃĐe dans lâimportance prise par les ÃĐvÃĐnements culturels dans la politique urbaine de la ville selon lâidÃĐe que la ville est un produit marketing comme un autre. La figure de lâartiste et du centre culturel et artistique rÃĐpond ainsi à cette volontÃĐ dâassigner à un quartier une marque. Lâartiste devient un vecteur de la marque[29].
Ainsi lâÃĐvolution urbaine du cÅur de ville en Occident est marquÃĐe par un phÃĐnomÃĻne progressif dâexclusion des classes populaires : ÃĐvidemment non incluses dans les ÂŦ beaux quartiers Âŧ[30], mais ÃĐgalement exclues des quartiers historiquement populaires. Les stratÃĐgies de renouvellement urbain sont un processus sÃĐculaire, dont les procÃĐdÃĐs ont considÃĐrablement ÃĐvoluÃĐ. La violence de la tabula rasa de la rÃĐnovation (et de lâexpulsion) a ÃĐtÃĐ remplacÃĐe par la violence plus discrÃĻte et cachÃĐe du renouvellement urbain. Dâautant que ce renouvellement est accompagnÃĐ dâun discours cherchant à dÃĐsamorcer la rÃĐalitÃĐ de la violence exercÃĐe : le vivre-ensemble semble bien plus se destiner aux classes populaires ÂŦ forcÃĐes Âŧ de vivre, pour un temps, avec la nouvelle classe moyenne intellectuelle[31].
Cette euphÃĐmisation du discours est liÃĐe de maniÃĻre directe au passage de la ville capitaliste industrielle à la ville capitaliste nÃĐo-libÃĐrale, le passage du rythme de travail mÃĐcanique â lâennui â au rythme de travail crÃĐatif â le loisir. La dialectique travail â non-travail sâest mutÃĐe en dialectique travail â loisir. Dans une sociÃĐtÃĐ capitaliste, les rÃĐductions de temps de travail ne se font pas selon lâaugmentation de la productivitÃĐ, mais bien pour laisser du temps aux loisirs selon une optique keynÃĐsienne traditionnelle[32]. Le temps laissÃĐ libre du travail devient encore plus un temps de consommation, qui dâactivitÃĐ marginale passe à activitÃĐ essentielle. Dans ce sens, la ville sâoppose irrÃĐmÃĐdiablement à la pÃĐriphÃĐrie ÂŦ productive Âŧ ou à la ville industrielle et post-industrielle ÃĐgalement en matiÃĻre dâamusement. Expulsion de la classe populaire, nouveau rÃīle dÃĐvolu à lâespace urbain, la boucle est bouclÃĐe : pleine place est faite au ludique, à la frivolitÃĐ, au culturo-festif.

 mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-
mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-