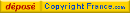Tout est culturel !
Culture et « culturel »
Le pouvoir, la politique et le monde de l’art ont tout au long de l’histoire connu de nombreuses convergences à dÃĐfaut d’une longue histoire d’amour. Ce n’est que rÃĐcemment (fin du XXÃĻme siÃĻcle) que la confusion organisÃĐe de main de maÃŪtre est parvenue à gommer les frontiÃĻres non seulement entre les avenues et les goÃŧts du pouvoir mais aussi entre l’art et ce qui n’en est pas â ce dans quoi il faut inscrire la « marchandise ».
Ayons l’humeur badine et le souvenir souriant, retour en 1968 : tout est politique, prÃĐtend-on, « pisser », affirmaient les murs des toilettes de la Sorbonne, ÃĐtait « un acte politique ». Vu de mes yeux, vu. Soit.
Aujourd’hui, la mode à changÃĐ, mais si peu, en fin de compte : il suffit de remplacer politique par « culturel ». Tout est culturel. C’est si vrai que nous en viendrions (comme en 68) à nous demander en urinant si nous remplissons convenablement notre fonction d’ »acteurs culturels »âĶ
La mode, aujourd’hui, nous porterait plutÃīt à parler de « passeur » â la terminologie « bobo » des annÃĐes 2000 raffole de ce vocable, encore que nul ne sache vraiment qui « passe » quoi. Serait-ce la culture ? En train de passer l’arme à gauche, comme dit l’expression ?
N’oublions pas, bien plus sÃĐrieusement cette fois, que l’autre mot pour « passeur » est « nocher » â Caron est le nocher. Il mÃĻne, sur sa barque, les morts outre Styx. Toutes ces rÃĐfÃĐrences culturelles ne peuvent tout de mÊme pas Être passÃĐes sous silence. Peu de vocables de la mode sont rÃĐellement « innocents ».
Nombre d’ÃĐpoques ont asservi tous leurs gestes à un sens quasi-unique, le religieux, puis l’utile, ou encore le rationnel. Ainsi prÃĐtendait-on ÃĐpouser utile au bas Moyen Age, et affichait-on un plan de vie rationnel sous la troisiÃĻme rÃĐpublique. Aujourd’hui on ferait volontiers dans le « culturel ». Si l’on veut s’amuser, se divertir, tuer le temps ou se reposer tout simplement, on ne peut le faire sans la caution de « s’adonner à un divertissement culturel ». Ah, aurait pu dire Brel, « chez ces gens-là », on s’ennuie utile. On s’ennuie « culturel ».
Le snobisme ne s’arrÊte pas là . Quitte à Être accusÃĐ par Ph. Dagen et ses semblables de pratiquer « la haine de l’art » (sous-entendu contemporain) reconnaissons qu’il faut un rÃĐel talent (social, voire mondain) pour parvenir à faire passer n’importe quel gribouillis pour de l’art, de la culture, pour une expression explicitement esthÃĐtique, intentionnellement aboutie. Comme si, seul le diffuseur faisait art de toute production qu’il dÃĐsigne à l’attention de ses contemporains. Comme s’il ÃĐtait celui qui proclame et attribue l’appartenance, ce que jadis on aurait oser nommer « qualitÃĐ », et que, inversement, l’artiste â fÃŧt-il confirmÃĐ â ne pÃŧt dÃĐcider s’il visait là une Åuvre d’art ou s’il faisait des gammes pour se dÃĐgourdir ou essuyer son pinceau. Confusion.
Le fait culturel comme objet de mode
Nous le disions et Fumaroli, Schneider, Harouel et quelques autres l’ont bien dÃĐmontrÃĐ : le fait culturel est objet de mode. Il faudrait cependant ÃĐcrire de nombreux ouvrages pour ÃĐpuiser les aspects et les effets de la mode du culturel : ses origines, ses finalitÃĐs, ses aspects, ses limites…
Je signalerai simplement ici un des dangers qui se laissent percevoir : celui d’une neutralisation issue d’une gÃĐnÃĐralisation abusive. Si tout est politique plus rien ne l’est et c’est grave pour la sociÃĐtÃĐ. De mÊme si tout est culturel.
La pÃĐriode Lang, l’aprÃĻs 1981 au sens large, dans les arts et la pÃĐriode post-68 en politique se sont traduites, l’une comme l’autre, dans les faits, les productions, les « sÃĐlections » (ou ce qui en tenait lieu) par une « pensÃĐe molle », ou plutÃīt une non-pensÃĐe.
La pensÃĐe molle est souvent la traduction dans les faits quotidiens dâune idÃĐologie totalitaire une pratique terroriste froide et souriante à la fois qui entend tout se soumettre par le biais d’une indiffÃĐrence affectÃĐe, d’une tolÃĐrance absolue. C’est ainsi qu’elle s’assure de ne rien laisser en dehors d’elle.
Pas plus qu’à PanoptÃĻs ou à Big Brother, rien ne lui ÃĐchappe. Rien qui soit en dehors. L’art est total autrement dit il n’est plus. La poubelle, le caniveau, les ÃĐgoÃŧts sont passeurs d’objets d’art puisque tout est art. Enfin, d’une certaine façon. Car il suffisait de le proclamer, que dis-je, de le dÃĐcider « ministÃĻriellement ». « Valois vaut loi ! » put-on dire alors.
Un monde d’artistes fonctionnaires
Grouillait ainsi sous Mitterrand une cohorte d’artistes-fonctionnaires à la solde d’un pouvoir cultureux inquiet à l’idÃĐe qu’un jour un artiste puisse Être tentÃĐ de renoncer à la gloriole dÃĐcernÃĐe, venue d’en haut, et pousse l’affront jusqu’à autonomiser ses modes de production et de diffusion… SANS subvention.
Mais Grand FrÃĻre veillait : mÊme les friches industrielles, (les lofts de l’art), furent parfois rÃĐcupÃĐrÃĐes par le parti quand elles n’ÃĐtaient pas (comme à Strasbourg) directement instituÃĐes par celui-ci ; le pouvoir central s’arrogeant non seulement la gestion mais mÊme la genÃĻse des lieux de « marginalitÃĐ » ou de « contestation ». Ce fut grandiose que d’assister à la mise en place de cette subtile confusion.
Qu’attendre d’une culture « managÃĐe », « coachÃĐe », « pilotÃĐe »âĶet ce mÊme dans ses courants alternatifs, marginaux ou contestataires ? Sommes-nous conduits (condamnÃĐs) à vivre dans un monde de poÃĻtes-laurÃĐats, dâartistes fonctionnaires ? On le voit, encore aujourd’hui, pour des raisons qui ne sont pas tellement diffÃĐrentes d’ailleurs, jour aprÃĻs jour, lâart nâest plus connu que par le biais des stars de son management : ses mÃĐdiateurs-vedettes ; les artistes passent mais les marchands restent voire s’incrustent (les prÃĐsentateurs de la TV tout comme les inamovibles critiques bien chenus en sont un bon exemple). Les uns sont des « intermittents » (pauvres artistes) les autres sont des « inter-minables… » ou pire des « permanents » au sens que prend le mot dans tel parti ou tel syndicat !
« Manager » la culture
Ce n’est toutefois pas un hasard si pouvoir et argent ont tirÃĐ au sort la robe de l’art. D’oÃđ cet abominable oxymoron que constitue l’expression bien mal inspirÃĐe de « management culturel ». S’agit-il de management des activitÃĐs, des productions culturelles ? S’agit-il de rendre culturelles les activitÃĐs de management ? S’agit-il plus simplement de paraÃŪtre Être dans le vent ? En tout cas ça dÃĐcoiffe : vaste programme à vrai dire que ce rapprochement de la culture et du management.
Redevenons sÃĐrieux, la chose existe, bien que cocasse dans le vibrant doute ontologique qu’elle ÃĐmet dÃĻs qu’elle cherche à se lÃĐgitimer. Comment dÃĐpeindre ce qui n’est guÃĻre plus qu’une extraordinaire facultÃĐ d’adaptation et une capacitÃĐ inlassable d’ÃĐcoute, d’attention mise au service de la dÃĐcouverte de nouvelles rÃĐfÃĐrences ou de nouveaux modes d’expression ? N’y a t-il, donc, dans ce vocable malencontreux, que la quÊte de nouvelles mÃĐthodes d’organisation? Est-ce du « management » : que de savoir repÃĐrer des ÂŦ imaginaires Âŧ, moteurs mythologiques qui sous-tendent la crÃĐativitÃĐ et la crÃĐation, le dÃĐsir du plaisir esthÃĐtique ? Sans ce dernier, en amont de la communication, il n’est pas de produit culturel.
Par ailleurs est-ce du management que d’interroger sans cesse le monde infini du non-dit, du non-explicite pour faire apparaÃŪtre les moteurs qui conduisent au dÃĐsir ? Comment parvenir dÃĻs lors à situer lâarticulation sociale de lâimaginaire esthÃĐtique du goÃŧteur dâart ? RÃĐponse qui ne se voudrait pas sordide : rien de tout ceci nâÃĐchappe à lâaxe de la consommation donc à celui du commerce. Pourtant…
La culture est finalement, sous nos yeux, bel et bien devenue une marchandise comme une autre… avec peut-Être, le poids politique en plus.
Marchands et vendeurs – Commerce et trivialitÃĐ
A dÃĐfaut de la prÃĐcÃĐdente rÃĐflexion qui devrait impÃĐrativement Être menÃĐe pleinement par tout « manager culturel » en chacune de ses actions pour et dans la culture, le manageur culturel ne demeurera qu’un modeste vendeur de grande surface ! Pas mÊme un « marchand » (de ceux qui s’impliquent dans « leur » production comme le fait l’artisan ou le maraÃŪcher). Les circuits et rÃĐseaux oÃđ le produit est offert deviennent indiffÃĐrents : autrement dit on aboutit à un pur commerce de denrÃĐes culturelles ÃĐquivalentes. Car, par parenthÃĻses, câest bien ce qui distingue le vendeur du marchand. Comment faire des managers culturels autre chose que des boutiquiers ou des relais, des moteurs, des actuateurs de ces politiques qui sont dÃĐcidÃĐes ailleurs quâen leur prÃĐsence ? Comment ÃĐviter ÃĐgalement que se constitue un corps poussiÃĐreux de routiniers de la culture, que se forme un poujadisme cultureux en lâespace de quelques dÃĐcennies ?
La rÃĐponse est peut-Être à chercher du cÃītÃĐ de la responsabilitÃĐ, donc du risque et de son angoisse, et in fine dans la dÃĐcision en son extrÊme solitude.
DÃĐcideur
Lâacteur culturel est un dÃĐcideur : donc il est responsable et isolÃĐ. Lâun parce que lâautre. Cette responsabilitÃĐ est autant morale quâintellectuelle. C’est de solitude profonde que provient sa compÃĐtence et son originalitÃĐ. Et d’elle seule.
Un Être non solitaire n’aurait pas sa place à l’intersection entre crÃĐation et diffusion. Tous les mondains, traÃŪne-cocktails et hableurs professionnels se sont engouffrÃĐs dans le mÃĐtier. Ils y ont gagnÃĐ – sinon à Être connus – une vie de tapage et de frivolitÃĐ. Les artistes et leur public, eux, y ont tout perdu.
Le vrai dÃĐcideur : quâest-ce que câest ? Un Être isolÃĐ et responsable. Car on ne dÃĐcide que dans la solitude la plus extrÊme. La « dÃĐcision collective » ou « de groupe » est pure lÃĒchetÃĐ, tic de langage ÃĐlÃĐgant, suprÊme mascarade qui, heureusement, ne trompe plus personne. Il y a toujours un maÃŪtre à faire penser, à faire dÃĐcider, un manipulateur qui disperse les choix et « fait » dÃĐcider.
Les enjeux qui s’offrent au vÃĐritable dÃĐcideur peuvent Être de natures trÃĻs diverses. Art et responsabilitÃĐ : beau programme là encore ! OÃđ lâon retrouve lâaffrontement quantitatif – qualitatif, avec en plus le problÃĻme de la qualitÃĐ du temps : cÃĐlÃĐritÃĐ contre qualitÃĐ, dans un monde oÃđ la communication (le fait seul de communiquer – quoi que ce soit, bien ou mal) importe plus que le contenu.
Type de question (à propos de la violence, par exemple) que peut se poser un tel dÃĐcideur : dois-je accepter la (soi-disant) « sublimation » de lâhorreur par le fait mÊme quâelle est « reprÃĐsentÃĐe » ?
au nom des nobles fins de la dissuasion : « plus jamais ça! » (et tant que ça fait vendre on ne va pas sâen priver),
au nom de la re-motivation de militants qui auraient pu oublier contre quoi on pourrait Être amenÃĐ Ã se battre …
au nom de nâimporte quoi mais qui, toujours, cache mal la dÃĐlectation morose, malsaine, fascinÃĐe, sidÃĐrÃĐe par lâabjection, lâignominie, la violence, lâarbitraire et la haine …
OÃđ, en son ÃĒme et conscience, le dÃĐcideur doit-il cesser dâaccepter le prÃĐtexte esthÃĐtique et ne plus soutenir, approuver la reprÃĐsentation de lâhorreur?
Ce problÃĻme est identique à celui que devraient se poser plus souvent (pas seulement en matiÃĻre de violence) les journalistes dans le cadre de leur dÃĐontologie.
Au secours ! Tout est culturel !
Pour nous rÃĐsumer. Il semble, et, j’en conviens, c’est affligeant de banalitÃĐ, qu’il faille encore et encore reprendre et nourrir le mÊme dÃĐbat de fond sur la notion de ÂŦ culture Âŧ et de ÂŦ culturel Âŧ et, surtout, sur les choix de sociÃĐtÃĐ et les politiques impliquÃĐes. Car, ce qui aurait dÃŧ demeurer bien ÃĐvident et qui ne lâest plus du tout depuis le brouillage politicien des ÂŦ annÃĐes Lang Âŧ, câest que si tout, absolument tout, par le biais de la rÃĐcupÃĐration des marginalitÃĐs mÊme les plus provocatrices, est culturel plus rien ne lâest. Ceci ÃĐquivaut à dire quâen tous points lâunivers recelle du particulier ou quâinversement le particulier contribue à lâuniversel. Ce qui nâa strictement aucun intÃĐrÊt.
Si la culture devient un bien d’Etat, on a, quoi qu’on fasse, une « culture officielle » et l’ÃĐmergence, heureusement, ici ou ailleurs, d’une autre ou de plusieurs autres cultures qui, elles, ne le sont pas. En France, à la fin du XXÃĻme siÃĻcle, le risque a ÃĐtÃĐ pris que la chose « culture » nâait plus aucun sens et les cultures dites de la marge furent en passe d’Être rÃĐcupÃĐrÃĐes toutes… jusqu’aux rave-parties les plus libres ou « sauvages » qui ont bien risquÃĐ d’Être estampillÃĐes voire brevetÃĐes.
Car si la culture (au sens le plus large) dÃĐborde la notion de culturel ; le culturel, lui, est bel et bien, en soi, un fait de culture, c’est un objet strictement idÃĐologique. Ainsi, le propre de la culture parisiano-mondaine française est d’Être « culturelle ». Lâacquisition de cette disposition dâesprit est indispensable à qui se frotte à lâart, à la crÃĐation, à lâexpression du nouveau, du jamais dit… ou à lâinterprÃĐtation personnelle de lâÅuvre de lâautre. Tout gestionnaire de lâinfrastructure nÃĐcessaire à la ÂŦ mise à lâair libre Âŧ â autrement dit à la rÃĐvÃĐlation au public â de lâÅuvre doit apprÃĐhender comment son action sâarticule dans le vaste jeu des codes, des sens, des rapports de force et de dÃĐsir du contexte social et culturel oÃđ il se trouve.
Que faire de lâencombrante culture et de la plus encombrante encore notion de « culturel » ? Les restreindre aux « activitÃĐs de production et de publication-circulation des objets esthÃĐtiques-artistiques » ? Faut-il y incorporer l’industrie du divertissement ? Jusqu’oÃđ ? Un fabricant de jeux de cartes est-il un mÃĐdiateur culturel, un artiste ou un manager ? Ne pourrait-il pas plus simplement demeurer un artisan fournissant des produits manufacturÃĐs et se passer de l’accablant qualificatif de culturel ?
Toutes ces remarques sont faites pour ÃĐviter les dangers du babelisme
, de la si ÃĐlÃĐgante et politiquement correcte confusion ambiante, du brouillage plus ou moins dÃĐlibÃĐrÃĐ des repÃĻres, du « multiculturel » creux et fourre-tout et du profit qu’en tirent toujours les mafias qui prospÃĻrent dans de ces situations d’irrepÃĻre.
Constantes mythiques et autres prÃĐjugÃĐs sur l’art
Pauvres artistes – I
Faut-il manquer d’argent, manquer mÊme de l’essentiel pour dÃĐsirer crÃĐer ? Faut-il souffrir dans sa vie, dans sa chair, dans son quotidien pour engendrer des sursauts de nouveautÃĐ ? L’art est-il le produit dÃĐrivÃĐ de la privation ?
rsistants relents de romanatisme qui nous animent semblent insister pour que tel soit son statut.
L’art ne serait-il pas plutÃīt le fruit d’une ascÃĻse ? Mais qui connait encore le (vÃĐritable) sens de ce mot ? Celui d’exercice.
Bien plus qu’à se dÃĐbattre contre le conformisme (celui d’une imagerie à la mode, il est vrai, depuis des siÃĻcles maintenant) l’artiste gagnerait à s’exercer, tant à son art qu’à une perception juste du monde, de la « situation », oÃđ il se trouve. C’est en effet une belle « ascÃĻse » que de mÃĐditer et sentir. C’est souffrance sans la moindre valeur ascÃĐtique que de crever de faim et de froid. Pourtant, nous le disions c’est plus mÃĐdiatique, et ça ne date pas d’hier : le pauvre va nu pied est nettement plus attachant que l’artiste repu. Le voyeurisme des nantis, mÃĐcÃĻnes ou autres a la vie dure.
Artistes croyez-moi, c’est hÃĐlas toujours vrai, feignez le dÃĐnuement si vous voulez percer. Fin de l’ÃĐpisode.
Pauvres artistes – II
RÃĐvolution protestante (constate Weber). Le succÃĻs et la fortune sont envoyÃĐs par Dieu à ceux qui « rÃĐussissent ». L’argent n’est pas honteux. La richesse est une marque de la grÃĒce accordÃĐe par le Ciel. La notoriÃĐtÃĐ et les dollars qui vont avec ne peuvent Être que mÃĐritÃĐs. Le temps c’est de l’argent. Le temps est donnÃĐ aux hommes pour qu’ils le fassent « fructifier ». Nouvelle logique, soit.
Mais alors la pitiÃĐ qu’il nous fallait avoir au paragraphe prÃĐcÃĐdent est bel et bien perdue, dÃĐprÃĐciÃĐe, dÃĐmonÃĐtisÃĐe ? Que faire de nos capacitÃĐs de gÃĐnÃĐreux voyeurisme et de commisÃĐration ?
C’est pourtant simple il nous faut, dÃĐsormais, les investir dans la presse ou la tÃĐlÃĐ « people ». Pleurer sur ces pauvres artistes persÃĐcutÃĐs … par les paparazzi. RuinÃĐs par des demi-douzaines de pensions alimentaires à verser çà et là . Par d’innombrables procÃĻs intentÃĐs pour rÃĐtablir leur « dignitÃĐ » (ou leurs profits).
La dÃĐtresse de l’artiste est bien là , fidÃĻle au poste â sous des formes nouvelles certes â encore que …
Car de la maigreur cadavÃĐrique pour cause de malnutrition et dÃĐnuement à l’anorexie-spectacle des figures de la mode, le famÃĐlisme est toujours de mise. Rien ne serait plus aisÃĐ que de dÃĐvelopper toute la gamme de correspondances similaires.
CrÃĐateurs virtuels â une dialectique de la rÃĐsignation ?
Quand l’homme, s’exprimant par ses mains, son corps, son papier, son pinceau et son crayon, aspirait de tout son Être à aller plus loin… il ne se heurtait qu’à lui-mÊme, à sa propre incompÃĐtence ou, si l’on prÃĐfÃĻre, à sa perfectible compÃĐtence.
Mais s’il a recours à mille et un artifices – disons « outils » – de type informatique ou ÃĐlectronique, il dÃĐcuple, sans doute, sa force et / ou sa prÃĐcision… toutefois, s’il se heurte à un obstacle, il ne peut le surmonter en prenant sur lui, en s’exerçant mieux. Il devra apprendre à se rÃĐsigner, à se soumettre aux limites de l’outil technologique.
L’outil d’expression, dÃĻs lors, devient outil de pensÃĐe, de conception â et il limite celle-ci : car alors le « crÃĐateur » pliera sa pensÃĐe, sa conception aux limites de l’outil ; limites qu’il intÃĻgre bientÃīt, inconsciemment, de maniÃĻre aussi intime que les siennes propres. La pensÃĐe devient façonnÃĐe par les possibilitÃĐs de l’outil. Cette autocensure bride son imaginaire et sa crÃĐativitÃĐ d’une part et son goÃŧt de l’effort, du perfectionnement, du progrÃĻs personnel, d’autre part.
Sans doute, nul ne le conteste, l’inverse est-il strictement aussi vrai et vÃĐrifiÃĐ tous les jours. La technologie permet des aventures crÃĐatrices totalement dÃĐbridÃĐes. des sursauts parfaitement inouÃŊs de gÃĐnie pur.
Reste que le crÃĐateur intÃĻgre à la fois les virtualitÃĐs d’aide de son nouvel outil aussi bien que les contraintes qu’il implique.
Mais ce qui est nouveau c’est que si un progrÃĻs survient il n’en sera pas (ou trÃĻs rarement) l’auteur. Il attendra – progrÃĻs collectif venu du technicien et du commerçant – que l’outil ait ÃĐtÃĐ amÃĐliorÃĐ pour dÃĐbrider un peu plus son gÃĐnie crÃĐatif… Ce sera la sphÃĻre des techniciens et non lui qui gÃĐnÃĐrera le progrÃĻs. C’est à elle que l’artiste sera redevable du nouveau pas en avant qu’il accomplira ensuite sÃŧrement.
A moins qu’ayant perdu l’habitude de prendre sur lui, de lutter vers son idÃĐal de perfection, et de n’Être jamais rÃĐsignÃĐ, il ne se rÃĐsigne à … la rÃĐsignation et cesse de ressentir – de dÃĐplorer – les contraintes de l’outil, n’ÃĐprouvant mÊme plus le besoin de dire ce que l’outil ne permet pas d’exprimer.
Sommes-nous bien certains de ne pas en Être dÃĐjà arrivÃĐs là ?
L’orgue
Le poids de la technique sur les crÃĐateurs ne se fait pas sentir aujourd’hui seulement â et ceci nuance singuliÃĻrement ce qui vient d’Être dit.
Pensons simplement aux progrÃĻs accomplis à travers les siÃĻcles en matiÃĻre, par exemple d’instruments de musique. Luthiers et facteurs de toutes sortes ont ouvert des portes merveilleuses aux interprÃĻtes et compositeurs qui ont su les exploiter et les intÃĐgrer à leur panoplie, à leur vocabulaire. Toutefois jamais encore on n’avait fait aussi fabuleux, grandiose, qu’avec l’orgue. Instrument total, mÃĐgalomaniaque, paranoÃŊaque par excellence : ses innombrables registres « ÃĐmulent » nombre d’autres instruments et engendrent en outre des sons ÃĐtymologiquement inouÃŊs.
Rien d’ÃĐtonnant à ce que les crÃĐateurs littÃĐraires l’aient donnÃĐ comme instrument favori à leurs « puissants », maÃŪtres absolus, gÃĐnies totalitaires … mÊme à bord du Nautilus NÃĐmo joue de l’orgue ! (Jules Vernes, Vingt-mille lieues sous les mers).
Le nom de l’orgue tel celui du Diable (qui veut dire le Double de Dieu) est lÃĐgion. L’ÃĐlectronique en a encore renforcÃĐ sa capacitÃĐ Ã doubler tous les autres instruments de l’orchestre.
Là encore, ou dÃĐjà à ce moment là le technicien facteur d’orgue bridait ou dÃĐbridait la crÃĐativitÃĐ. Ici aussi l’ÃĐlectronique et le savoir faire de la trÃĻs haute et trÃĻs mathÃĐmatique physique technicienne rÃĐpond aux et anticipe sur les aspirations des crÃĐateurs.
De là la terrifiante et mystÃĻrieuse satisfaction qu’il y a à l’ÃĐcouter ronfler aussi bien que chantonner dans des registres qui vont comme chacun sait du sacrÃĐ au jazz en passant par le frivole divertissant. Cet ÃĐtrange plaisir procÃĻde de la disproportion qui existe entre la cause et l’effet, entre le petit homme derriÃĻre ses claviers et l’immense tonnerre produit par cette profonde futaie d’immenses tuyaux. Plaisir non diffÃĐrent de celui qu’il y a à considÃĐrer tout ce que l’on peut tÃĐlÃĐ-commander d’une trÃĻs modeste pression sur un bouton.
C’est encore et toujours une ÃĐmotion forte pour l’homme moderne que de voir les effets immenses d’un minuscule action (le « clavier » lieu de co-existence de touches multiples spÃĐcifiques (aux effets de surcroÃŪt modulables) en est le plus souvent le vecteur privilÃĐgiÃĐ) relayÃĐe par une chaÃŪne et des rÃĐseaux dont nul n’imagine pleinement le maillage de connexions et de commandes en cascades.
Il n’est qu’une seule sorte d’imaginaire
Mais y a-t-il divorce ou au moins « rupture » ÃĐpistÃĐmologique entre la crÃĐation du crÃĐateur (artistique) et celle du technicien-concepteur d’artefacts ? Non, l’imaginaire est, en dÃĐfinitive, toujours le mÊme qu’il soit scientifique, technique ou artistique.
L’imaginaire est le seul moteur et aussi le seul interlocuteur. Il est le produit mÊme de l’ÃĐternelle, la constante insatisfaction de l’Être humain. Petite graine dans le gÃĐnome de la race ou autre chose, l’humanitÃĐ toute entiÃĻre amÃĐliore son sort (ou tend à le faire). La crÃĐativitÃĐ est une pulsion commune et l’ÃĐlan, l’ÃĐrotique, devrais-je dire, de la « dÃĐsirance » forte d’un objet qui soit le « mÊme mais en mieux » est partagÃĐe à des degrÃĐs divers par toutes les civilisations de la planÃĻte à toutes les ÃĐpoques. Et ceci, là encore, tant dans les domaines techniques qui vont du petit savoir faire de la quotidiennetÃĐ aux immenses rÃĐalisations industrielles ou spatiales que dans le champ de l’esthÃĐtique, du dÃĐcoratif aussi bien que de la sacralitÃĐ figurÃĐe : l’homme vit dans le « beau ».
Vivre dans le beau
A-t-il fallu que l’homme produise du beau pour qu’il s’aperçoive des richesses esthÃĐtiques du monde qui l’entoure ? Nul ne sait. Il y cependant forcÃĐment un lien. Et le risque existerait alors que si on le cantonne dans la consommation d’objets à la volatilitÃĐ trop grande, objets que, finalement, il mÃĐprise par ce qu’il doit les jeter sitÃīt acquis ou presque (par effet de mode ou pour cause de fragilitÃĐ), l’homme en vienne peut-Être à ne plus produire ni beau ni bon, à n’en plus mÊme en percevoir l’existence là oÃđ elle se trouve.
C’est la notion mÊme de talent qui serait alors menacÃĐe.
Le talent, le vrai celui qui ne s’affiche pas qui ne se fait pas remarquer comme tel dans l’oeuvre qu’il a engendrÃĐ. Le talent, le vrai est totalement transparent. La transparence est une forme d’oubli qualifiÃĐ, admis, entraÃŪnÃĐ. La facultÃĐ du talent est de se faire oublier dans l’insistance mÊme de son Être-là . La prÃĐsentification opÃĐrÃĐe et rÃĐussie doit faire oublier ce qui prÃĐsentifie.
Il est oubli, et ne s’actualise que dans l’Être-là de l’Åuvre qu’il a portÃĐe. Il ne s’affiche pas comme ou par le vecteur. C’est là qu’est toute la diffÃĐrence entre le talent et son absence.
C’est exactement cela qu’il importe de ne pas abandonner à la « confusion ».
L’art montre le rÃĐel en s’en dÃĐtournant
L’art, ainsi, est ce qui, pour s’en Être dÃĐtournÃĐ un instant, dÃĐsigne le mieux la matiÃĻre. Dans sa prÃĐsence la plus mate. dÃĐpourvue de sens, de rÃĐsonnance, d’ÃĐcho. Il la dÃĐsigne et s’y substitue tout à la soumettant au sens qu’il lui impose.
L’inventeur, avant d’agir et de vÃĐrifier son projet par l’action doit rÊver celle-ci tout comme il lui faudra rÊver la matiÃĻre qui le permet. L’homme admettra-t-il un jour que tout naÃŪt du rÊve et y retourne. La matiÃĻre n’est qu’une brÃĻve illusion, virtuelle, frivole, volatile, sans ÃĐpaisseur. Tandis que le rÊve, lui… S’il savait !
… Et mille et une autres considÃĐrations qui si elles venaient à Être perdues de vue nous installeraient dans la plus ÃĐpouvantable confusion des esprits, des objets tant rÃĐels qu’imaginaires et des valeurs.
Et c’est là que le rapport à la culture, à celle dont nous sommes dÃĐpositaires, lÃĐgataires joue un rÃīle dÃĐterminant. Nous ne pouvons occulter le fait que nous sommes, à tout moment, à la fois hÃĐritiers et gÃĐnÃĐrateurs de patrimoine. Ici et maintenant hic et nunc entre passÃĐ et avenir. Nier l’un ou l’autre des deux termes reviendrait à suicider la race humaine.
C’est pourquoi aujourd’hui, hic et nunc, il est capital de se poser la question : quel avenir pour le passÃĐ ?

 mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-
mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-