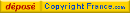Laetitia SILVENT
 Particuliû´rement prisûˋ mais û la fois source de grandes polûˋmiques, le concept de ville crûˋative connait depuis plusieurs annûˋes un succû´s retentissant de par le monde. Dans un contexte de mondialisation, de dûˋrûˋgulation ûˋtatique, de crise ûˋconomique, de transition post-industrielle et de chûÇmage ûˋlevûˋ, les mûˋtropoles sont en quûˆte de nouveaux modû´les urbains capables de rûˋpondre û leurs attentes. Elles doivent faire face û une concurrence accrue qui les pousse û se rûˋinventer continuellement et û faire preuve de crûˋativitûˋ. Les promesses allûˋchantes de prospûˋritûˋ et dãattractivitûˋ du concept de ville crûˋative apparaissent comme des solutions et deviennent dû´s lors sources de convoitises. Pour attirer les fonds et gagner ou conserver une certaine notoriûˋtûˋ, les mûˋtropoles se tournent vers les prûˋdicateurs de cette doctrine de ville crûˋative pour renouveler les tissus ûˋconomiques et urbains. Ceux-ci ûˋlaborent des classements, des indices de positionnement et prodiguent des conseils aux ûˋlus et leur garantissent le dynamisme de leurs villes. A la hauteur des espoirs quãil suscite, le concept de ville crûˋative attise ûˋgalement les critiques inhûˋrentes û ses capacitûˋs et û ses diffûˋrentes acceptations. Bien que de nombreux auteurs soulû´vent les limites de la dûˋmarche jugûˋe confuse (Markusen[1]), non novatrice (Glaeser[2]), affirmant des conclusions prûˋmaturûˋes (Shearmur[3]) ou fondûˋes sur une vision simplifiûˋe des mûˋcanismes de croissance (Levine[4]), force est de constater quãelle suscite un engouement considûˋrable et universel.
Particuliû´rement prisûˋ mais û la fois source de grandes polûˋmiques, le concept de ville crûˋative connait depuis plusieurs annûˋes un succû´s retentissant de par le monde. Dans un contexte de mondialisation, de dûˋrûˋgulation ûˋtatique, de crise ûˋconomique, de transition post-industrielle et de chûÇmage ûˋlevûˋ, les mûˋtropoles sont en quûˆte de nouveaux modû´les urbains capables de rûˋpondre û leurs attentes. Elles doivent faire face û une concurrence accrue qui les pousse û se rûˋinventer continuellement et û faire preuve de crûˋativitûˋ. Les promesses allûˋchantes de prospûˋritûˋ et dãattractivitûˋ du concept de ville crûˋative apparaissent comme des solutions et deviennent dû´s lors sources de convoitises. Pour attirer les fonds et gagner ou conserver une certaine notoriûˋtûˋ, les mûˋtropoles se tournent vers les prûˋdicateurs de cette doctrine de ville crûˋative pour renouveler les tissus ûˋconomiques et urbains. Ceux-ci ûˋlaborent des classements, des indices de positionnement et prodiguent des conseils aux ûˋlus et leur garantissent le dynamisme de leurs villes. A la hauteur des espoirs quãil suscite, le concept de ville crûˋative attise ûˋgalement les critiques inhûˋrentes û ses capacitûˋs et û ses diffûˋrentes acceptations. Bien que de nombreux auteurs soulû´vent les limites de la dûˋmarche jugûˋe confuse (Markusen[1]), non novatrice (Glaeser[2]), affirmant des conclusions prûˋmaturûˋes (Shearmur[3]) ou fondûˋes sur une vision simplifiûˋe des mûˋcanismes de croissance (Levine[4]), force est de constater quãelle suscite un engouement considûˋrable et universel.
Il est ici question de mesurer lãinstrumentalisation qui est faite de la culture et dãen comprendre la portûˋe. Que signifie le terme ô¨ô crûˋatifô ô£ pour ces prûˋdicateursô ? Est-il question de cultureô ? Enfin, si la culture est bien prûˋsente, quelle forme peut-elle revûˆtir et quels enjeux lui sont confûˋrûˋsô ?
La ville crûˋative, ses concepts et ses usages
Particuliû´rement en usage depuis quelques annûˋes, le concept de ô¨ô ville crûˋativeô ô£ suscite de nombreux dûˋbats sur les avantages et les inconvûˋnients quãil peut engendrer. Le concept de ville crûˋative a notamment ûˋtûˋ pensûˋ par Charles Landry qui, au cours des annûˋes 1980, sãest fait connaitre grûÂce û son ouvrage The Creative Cityô : A toolkit for urban innovators [5]publiûˋ en 2000. Lãidûˋe centrale dûˋfendue est celle dãune ô¨ô crûˋativitûˋ urbaineô ô£. Toute la difficultûˋ du concept rûˋside dans lãacception du terme ô¨ô crûˋativitûˋô ô£. Pour lui, les villes dûˋtiennent un potentiel de crûˋativitûˋ quãelles se doivent dãoptimiser. Il affirme quãil existe sept groupes de facteurs intervenant dans ce conceptô : les crûˋatifs, la qualitûˋ des dirigeants, la diversitûˋ des talents, lãouverture dãesprit, lãintensitûˋ de lãidentitûˋ locale, la qualitûˋ des installations urbaines et les possibilitûˋs de mise en rûˋseau. En quelques mots, la ville crûˋative est, selon Charles Landry, un modû´le de dûˋveloppement territorial, une sorte de label visant û attirer les investisseurs.
Autre figure emblûˋmatique de la rûˋflexion sur les reconversions urbaines contemporaines, Richard Florida[6], gûˋographe et urbaniste de Toronto, est largement considûˋrûˋ comme le ô¨ô porte-drapeau de lãurbanitûˋ sûˋlectiveô ô£[7]. Il prûÇne une ville qui se rûˋinvente par la sûˋlection de ses habitants. Il ûˋtudie en particulier la corrûˋlation entre la performance ûˋconomique des villes et la prûˋsence dãune certaine classe de la population, la ô¨ô classe crûˋativeô ô£. Selon lui, la croissance des villes est dûˋpendante de leur capacitûˋ û attirer ceux quãil nomme les ô¨ô crûˋatifsô ô£ qui sont source dãimpulsion pour lãensemble de lãûˋconomie rûˋgionale. Pour y parvenir, les villes doivent faire en sorte de favoriser la combinaison de trois domaines contractûˋs sous la forme des 3 T, qui sont la technologie, le talent (Bac+5) et la tolûˋrance (diversitûˋ culturelle, communautûˋ homosexuelle et domaine artistique). Ainsi sous ces trois indices, il amalgame de nombreux individus aux profils socio-ûˋconomiques et professionnels pourtant trû´s variûˋs mais toujours trû´s qualifiûˋs et surtout flexibles. La classe crûˋativeô rassemblerait environ 30ô % de la population active et 70ô % du pouvoir d’achat disponible[8]. Selon Richard Florida, les travailleurs de la classe crûˋative sont tout dãabord attirûˋs par les lieux crûˋatifs oû¿ se crûˋent, par la suite, les emplois et non lãinverse. Le bouillonnement crûˋatif devient ainsi le moteur de la croissance des villes.
De faûÏon gûˋnûˋrale, les villes pionniû´res de ce concept sont principalement celles qui, historiquement, ont subi le plus durement le dûˋclin du secteur industriel, telles que Saint-Etienne ou Lille. Les villes se concentrent alors sur lãimplantation dãactivitûˋs stratûˋgiques quãelles organisent en grappes ou ô¨ô clusters[9] ô£ qui peuvent ûˆtre de deux types : les grappes dãinnovations et les grappes dãentreprises. La Silicon Valley[10] en est un parfait exemple. Ces grappes sont considûˋrûˋes comme les vecteurs majeurs du dûˋveloppement et de la compûˋtitivitûˋ pour les entreprises et les territoires.
Les vertus de cette ûˋconomie crûˋative ont trû´s tûÇt ûˋtûˋ exprimûˋes au Royaume-Uni oû¿, dû´s les annûˋes 1990, les rapports officiels mentionnaient le terme dãindustries crûˋatives. Cette notion se fondait alors principalement sur les nouvelles technologies de communication numûˋrique en plein essor qui ont fait prendre conscience du puissant potentiel dãune production immatûˋrielle. Sous Gordon Brown (Premier ministre de 2007 û 2010), le Dûˋpartement de la culture, des mûˋdias et des sports publie en 2008, Creative Britainô : new talents for the new economy, une ûˋtude stratûˋgique visant û faire du Royaume-Uni ô¨ô le céur du monde crûˋatif par lãinvestissement dans le talent et la crûˋativitûˋ comme moteur de la croissance ûˋconomique[11]ô£. De cette ûˋtude ressort une contribution du talent et de la crûˋativitûˋ dans lãûˋconomie britannique de lãordre de 7,3%. Dû´s lors, ces travailleurs qualifiûˋs de ô¨ô classe crûˋativeô ô£ par Richard Florida sont prûˋsentûˋs comme une solution û la crise ûˋconomique dans les pays oû¿ la main dãéuvre est onûˋreuse.
Sur le plan europûˋen, la Commission europûˋenne montre ûˋgalement une certaine conviction quant au potentiel de la crûˋativitûˋ et de lãinnovation. Entrûˋ en vigueur en 2009, le Traitûˋ de Lisbonne porte û lãagenda ce systû´me de ville crûˋative ô¨ô comme moteur de croissance ûˋconomique et comme stratûˋgie de rûˋsistance face aux puissances ûˋconomiques et industrielles ûˋmergentesô ô£[12]. Mais si la culture et lãart reviennent frûˋquemment dans ce modû´le ûˋconomique, quelle place leur est accordûˋeô ? Peut-on parler dãûˋchelle dãinstrumentalisationô de la culture dans ce concept de ville crûˋativeô ?
Les degrûˋs dãinstrumentalisation de la culture
La notion de crûˋativitûˋ, telle que dûˋcrite prûˋcûˋdemment, englobe un trû´s large secteur dãactivitûˋs professionnelles qui rûˋduit implicitement lãapport culturel û un outil mobilisable si nûˋcessaire. Dans ce concept, la crûˋativitûˋ ne peut en aucun cas se restreindre au seul champ culturel et artistique. Si on se rûˋfû´re û la dûˋfinition du dictionnaire Trûˋsor de la Langue franûÏaise (TLF) 2012, la crûˋativitûˋ renvoie û la ô¨ô capacitûˋ, pouvoir quãa un individu de crûˋer, cãest-û -dire dãimaginer et de rûˋaliser quelque chose de nouveauô ô£. Aussi, parmi les nombreuses interprûˋtations du concept de ville crûˋative, le domaine artistique se voit attribuer des rûÇles bien diffûˋrents, allant dãune prûˋsence trû´s nûˋgligeable, voire insignifiante, û une position centrale. Se pose alors la question de ô lãinstrumentalisation[13] qui peut ûˆtre faite de la culture.
 Malgrûˋ une forte propension des partisans û ûˋvaluer lãaspect artistique comme servant un autre but, des rûˋseaux de villes se sont construits autour de lãacception de la culture comme enjeu central. En 2004, lãUnesco lance le rûˋseau mondial de villes crûˋatives[14] qui, bien que basûˋ sur la notion dãûˋconomie crûˋative, met toutefois lãaccent sur des domaines artistiques ou culturels et moins sur des domaines technologiques ou financiers. Sur un plan plus national, The Creative City Network of Canada[15] promeut ûˋgalement une approche culturelle du concept. Cãest alors une vûˋritable imbrication entre politiques culturelles et stratûˋgies urbaines qui se faûÏonne û travers ce processus de mûˋtropolisation.
Malgrûˋ une forte propension des partisans û ûˋvaluer lãaspect artistique comme servant un autre but, des rûˋseaux de villes se sont construits autour de lãacception de la culture comme enjeu central. En 2004, lãUnesco lance le rûˋseau mondial de villes crûˋatives[14] qui, bien que basûˋ sur la notion dãûˋconomie crûˋative, met toutefois lãaccent sur des domaines artistiques ou culturels et moins sur des domaines technologiques ou financiers. Sur un plan plus national, The Creative City Network of Canada[15] promeut ûˋgalement une approche culturelle du concept. Cãest alors une vûˋritable imbrication entre politiques culturelles et stratûˋgies urbaines qui se faûÏonne û travers ce processus de mûˋtropolisation.
Mais au-delû de ces organismes de valorisation de la culture comme pivot des villes crûˋatives, dãautres acteurs lui accordent une importance nettement plus utilitaire.ô La culture et les arts deviennent alors des outils de promotion. Depuis le milieu des annûˋes 1980, les acteurs locaux ont dûˋveloppûˋ des stratûˋgies de communication similaires û celles des entreprises afin de rûˋpondre aux critû´res des villes internationales. Le ô¨ô marketing urbain[16] ô£ est dûˋsormais devenu incontournable pour les gouvernements locaux qui font face û une concurrence internationale effrûˋnûˋe. Egalement appelûˋ city branding (ô¨ô ville-marqueô ô£) ou region branding (ô¨ô territoire-marque[17]ô£), les villes ou les rûˋgions cherchent û se crûˋer une ô¨ô marque de fabriqueô ô£, comme û travers les slogans,ô I amsterdam (Amsterdam) ou Think London (Londres) et des cabinets de conseils ont spûˋcialement dûˋveloppûˋ des stratûˋgies et des outils au service de cette attractivitûˋ urbaine. Parmi ces outils apparaûÛt lãensemble du secteur culturel qui se voit essentiellement prûˆter ici un rûÇle de rayonnement international. Cãest ce que les cabinets de conseil appellent le marketing culturel-urbain. Il nãest pas inutile de rappeler que pour Richard Florida, lãindice relatif aux pratiques artistiques est considûˋrûˋ comme une sous-catûˋgorie dãun des ô¨ô 3 Tô ô£, lãindice Tolûˋrance. Dans un systû´me de boucle, le marketing se met au service de la ville et la culture au service du marketing. Une conception qui sûˋduit de plus en plus les dûˋcideurs publics.
En outre de la crûˋation dãune image et de symboles, lãinstrumentalisation de la culture sãarticule ûˋgalement autour dãune notion purement financiû´re. La construction dãune ville crûˋative est un enjeu majeur pour attirer les investissements, encourager la consommation et crûˋer de la richesse in fine. La classe dite crûˋative, aisûˋe et consumûˋriste, est û lãorigine du phûˋnomû´ne de gentrification, anglicisme signifiant embourgeoisement, qui symbolise le processus de renouvellement de la population dãun quartier par lãapparition de nouveaux profils socio-ûˋconomiques issus de couches sociales supûˋrieures. Pour ces classes, dont la reconnaissance sociale se cultive en grande partie par les sorties culturelles, lãaccessibilitûˋ aux services culturels de qualitûˋ ou renommûˋs est primordiale. Outre cet aspect social de la culture, la gentrification entraine une dimension commerciale qui se traduit par le renouveau des commerces de proximitûˋ (produits locaux et de qualitûˋ) et le regain dãintûˋrûˆt pour les marchûˋs traditionnels. Ainsi lãûˋconomie locale se rûˋgûˋnû´re de faûÏon favorable pour les pouvoirs publics locaux qui voient dans la culture une stratûˋgie de dûˋveloppement urbain. Ainsi, dans le cadre des politiques urbaines, la culture est û proprement parler un outil de valorisation de lãespace.
Indûˋpendamment dãune population propre û un territoire, la culture gûˋnû´re ûˋgalement des retombûˋes ûˋconomiques grûÂce au tourisme, ou plus prûˋcisûˋment au tourisme culturel. Publiûˋe en 2009, une ûˋtude commandûˋe part le ministû´re de la Culture chiffre lãimpact ûˋconomique du patrimoine en France û environ 21 milliards dãeuros[18], soit plus de vingt fois supûˋrieure û la dûˋpense publique selon ce mûˆme rapport. Mais dûˋsormais, le qualificatif envahissant lãensemble de lãûˋconomie, cãest le tourisme qui devient lui-mûˆme crûˋatif. Dû´s 2006, lãUnesco le dûˋfinit comme une ô¨ô expûˋrience engagûˋe et authentique, avec des apprentissages participatifs dans les domaines des artsô£[19]. Il est alors question ô¨ô dãune nouvelle gûˋnûˋrationô de tourismeô ô£[20]. Mais quelles consûˋquences cette vision de la culture instrumentalisûˋe peut-elle avoir sur les politiques urbainesô et culturellesô ?
Une course û lãattractivitûˋ
Le retour sur investissement promu par les partisans de la ville crûˋative entraine un bouillonnement des mûˋtropoles qui veulent toutes aspirer û tirer profit ce levier ûˋconomique. Souvent perûÏue comme seule alternative face aux enjeux mondiaux, les villes se tournent vers lãûˋconomie de la connaissance et cãest une vûˋritable bataille quãelles se livrent. û coup dãûˋquipements et dãinfrastructures, elles tentent de rûˋpondre aux nouvelles normes mûˋtropolitaines. Les mûˋtropoles sãarment culturellement[21] pour sãoffrir des labels prometteurs de renommûˋe et de retombûˋes financiû´res. La course û la Capitale europûˋenne de la culture en est une bonne illustration. Les enjeux ûˋconomiques sont consûˋquents pour lãensemble dãune rûˋgion. Particuliû´rement mis sur le devant de la scû´ne par le succû´s de Lille 2004[22], le titre connaûÛt une convoitise grandissante. Le label de Capitale europûˋenne de la culture permet, en outre, û lãUnion europûˋenne de rayonner internationalement.
Mais dans cette course au rayonnement, une renommûˋe culturelle peut elle-mûˆme devenir label et sãexploiter en tant que tel. Des noms reconnus dans le monde entier, des logos distinctifs, symbole de qualitûˋ et de valorisation, toutes ces qualitûˋs attribuables aux grands musûˋes sont aussi les qualitûˋs propres dãune marque. Les mûˋtropoles rivalisent dãastuces pour rendre leurs musûˋes plus glorieux et incontournables. Cette quûˆte du plus grand projet musûˋal a dûˋsormais un nom, ô¨ô le syndrome de Bilbao ô£. Les rûˋpercussions internationales du musûˋe Guggenheim ont littûˋralement inscrit la ville de Bilbao sur la carte. En une dizaine dãannûˋes, la ville de Bilbao a connu une ûˋvolution spectaculaire. Lãarchitecture grandiose (par lãarchitecte Frank Gehry[23]) et particuliû´rement originale, en fait un passage obligûˋ pour nombre de touristes et rapporte 230 millions dãeuros[24] chaque annûˋe û lãûˋconomie rûˋgionale. Souvent plus connus pour leur architecture que pour leurs contenus, ô¨ô ces musûˋes icûÇnesô ô£[25] misent ûˋnormûˋment sur leur esthûˋtique, et pour cela, les mûˋtropoles ont recours aux plus grands noms dans le mûˋtier. En 2010, le MAXXI[26] (ou grand vaisseau blanc) de Rome est conûÏu par la laurûˋate anglo-irakienne du prix dãarchitecture Stirling, Zaha Hadid[27] etô le nouveau Centre Pompidou de Metz est imaginûˋ par lãarchitecte japonais Shigeru Ban[28].
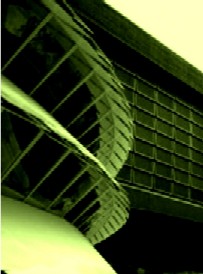 Dans cette logique de marques, les grands noms vont mûˆme jusquãû pratiquer ce qui pourrait sãapparenter au systû´me de franchise ou filiale. Lãun des plus importants musûˋes au monde, le Louvre, assis sur une renommûˋe indûˋtrûÇnable, rentabilise son image en exploitant son nom en dehors de la capitale. Prûˋvu pour dûˋcembre 2012, Le Louvre-Lens[29] symbolise cet espoir de mise en valeur par association de symboles. Lû encore, la construction a donnûˋ lieu û un grand concours international que lãagence japonaise SANAA[30], laurûˋate du prix Pritzker, a remportûˋ.ô Hors hexagone, la marque Louvre est ûˋgalement convoitûˋe. Comme antenne ou branche de la marque, le paroxysme de cette course û la rûˋputation est la construction dãun Louvre dans les Emirats arabes Unis, le ô¨ô Louvre des sablesô ô£. Dûˋbutûˋ en 2010 et prûˋvu pourô une ouverture en 2015, le Louvre Abou Dhabi (dont la conception a ûˋtûˋ confiûˋ û lãarchitecte Jean Nouvel[31]) est conûÏu comme une composante dãun gigantesque quartier culturel sur lãûÛle de Saadiyat oû¿ il cûÇtoiera entre autre le Guggenheim Abou Dhabi[32]. Cet accord se chiffre û environ un milliard dãeuros sur trente ans pour le musûˋe du Louvre et pour les autres musûˋes partenaires. Lãexploitation dãun symbole musûˋal offre un bon potentiel de rentabilitûˋ. A travers cette pratique les institutions culturelles sont mises û ûˋgalitûˋ avec les marques commerciales. Mais ces pratiques ne sont pas sans consûˋquences. La rûˋputation de ces musûˋes, majoritairement liûˋe û la rûˋputation de leur crûˋateur- architecte, est particuliû´rement vulnûˋrable et sujette û la critique de la ô¨ô coquille videô ô£[33] . En effet, la teneur de leurs collections passe souvent û lãarriû´re-plan. Se pose la question de la frûˋquentation de ces musûˋes phares dans les prochaines annûˋes, surtout face au devenir de lãapprûˋciation esthûˋtique du bûÂtiment vieillissant. En ce sens, lãaccord concernant le Louvre Abou Dhabi lui a dãailleurs valu le nom de ô¨ô Las Vegas des sablesô ô£[34]. FranûÏoise Cachin, Jean Clair et Roland Recht parlent ainsi de ô¨ô dûˋrive de lãûˋthique du travail des musûˋesô ô£[35].
Dans cette logique de marques, les grands noms vont mûˆme jusquãû pratiquer ce qui pourrait sãapparenter au systû´me de franchise ou filiale. Lãun des plus importants musûˋes au monde, le Louvre, assis sur une renommûˋe indûˋtrûÇnable, rentabilise son image en exploitant son nom en dehors de la capitale. Prûˋvu pour dûˋcembre 2012, Le Louvre-Lens[29] symbolise cet espoir de mise en valeur par association de symboles. Lû encore, la construction a donnûˋ lieu û un grand concours international que lãagence japonaise SANAA[30], laurûˋate du prix Pritzker, a remportûˋ.ô Hors hexagone, la marque Louvre est ûˋgalement convoitûˋe. Comme antenne ou branche de la marque, le paroxysme de cette course û la rûˋputation est la construction dãun Louvre dans les Emirats arabes Unis, le ô¨ô Louvre des sablesô ô£. Dûˋbutûˋ en 2010 et prûˋvu pourô une ouverture en 2015, le Louvre Abou Dhabi (dont la conception a ûˋtûˋ confiûˋ û lãarchitecte Jean Nouvel[31]) est conûÏu comme une composante dãun gigantesque quartier culturel sur lãûÛle de Saadiyat oû¿ il cûÇtoiera entre autre le Guggenheim Abou Dhabi[32]. Cet accord se chiffre û environ un milliard dãeuros sur trente ans pour le musûˋe du Louvre et pour les autres musûˋes partenaires. Lãexploitation dãun symbole musûˋal offre un bon potentiel de rentabilitûˋ. A travers cette pratique les institutions culturelles sont mises û ûˋgalitûˋ avec les marques commerciales. Mais ces pratiques ne sont pas sans consûˋquences. La rûˋputation de ces musûˋes, majoritairement liûˋe û la rûˋputation de leur crûˋateur- architecte, est particuliû´rement vulnûˋrable et sujette û la critique de la ô¨ô coquille videô ô£[33] . En effet, la teneur de leurs collections passe souvent û lãarriû´re-plan. Se pose la question de la frûˋquentation de ces musûˋes phares dans les prochaines annûˋes, surtout face au devenir de lãapprûˋciation esthûˋtique du bûÂtiment vieillissant. En ce sens, lãaccord concernant le Louvre Abou Dhabi lui a dãailleurs valu le nom de ô¨ô Las Vegas des sablesô ô£[34]. FranûÏoise Cachin, Jean Clair et Roland Recht parlent ainsi de ô¨ô dûˋrive de lãûˋthique du travail des musûˋesô ô£[35].
En outre, la marchandisation des musûˋes, et leur transformation en entreprises culturelles, entraûÛnent ûˋgalement la question de la marchandisation des éuvres qui sãy trouvent. Le principe dãinaliûˋnabilitûˋ des éuvres dãart acquises par les pouvoirs publics, ûtat ou collectivitûˋs territoriales, dont jouissent de nombreux ûtats (dont la France) est particuliû´rement remis en cause. A travers les principales raisons officiellement avancûˋes en faveur de lãaliûˋnation, comme le nombre dãéuvres dûˋlaissûˋes en rûˋserve, du financement des acquisitions ou dãun manque de dynamisme des musûˋes, cãest bien le discours du marchûˋ de lãart qui sãexprime dans cette attente. La circulation marchande des éuvres attire les convoitises et entraûÛne avec elle le risque de transformer les musûˋes en une suite de collections privûˋes au dûˋtriment dãune prûˋservation historique dãun patrimoine.
Enfin, sur le plan social, lãeffet dãattraction des ô¨ô classes crûˋativesô ô£ et surtout aisûˋes, entraûÛne la flambûˋe des valeurs fonciû´res et immobiliû´res ainsi que lãaccroissement des inûˋgalitûˋs sociales. Les ûˋcarts de salaires se creusent, lãinflation se gûˋnûˋralise, cãest la gentrification. Particuliû´rement valorisable pour certains, la gentrification signifie ûˋgalement lãexpulsion pour dãautres dont les artistes eux-mûˆmes. Comme dans toutes les villes, cãest alors un cercle vicieux dãexpulsions qui se met en place.
Depuis ses prûˋmisses dans les annûˋes 1990 en passant par les thûˋorisations des tûˋnors des cabinets de consultants, la ville crûˋative est progressivement devenue un modû´le ûˋconomique plûˋbiscitûˋ par les pouvoirs politiques. Face û une dûˋsindustrialisation source de crise ûˋconomique, les villes se tournent vers cette promesse dãeldorado. Cependant, le flou du terme crûˋatif accorde une certaine marge de manéuvre et permet sa transposition dans des secteurs dãactivitûˋs ou des catûˋgories socio-professionnelles trû´s variûˋs. Parmi les indices de crûˋativitûˋ, la culture a ainsi une place particuliû´rement controversûˋe. Hormis quelques puristes, la culture se voit allouer un rûÇle trû´s pragmatique au service dãune pensûˋe nûˋolibûˋrale. Cette instrumentalisation sãopû´re sur deux champs principaux, la culture comme outil de marketing et la culture comme source de revenus. Face û une concurrence internationale, les mûˋtropoles utilisent le pouvoir symbolique de la culture pour attirer lãattention et faire de leur nom une marque ûˋvocatrice de modernitûˋ et de rûˋussite. En outre, cãest bien lãaspect financier qui gouverne cette politique urbaine. Allouer une telle capacitûˋ û lãart et û la culture a tout dãabord le mûˋrite de dûˋplacer le dûˋbat. La culture cesse dãûˆtre en quûˆte perpûˋtuelle de financement pour devenir une source de ressources. La concurrence est en soi un moteur dãinnovation et de prise de risque qui peut ûˆtre bûˋnûˋfique au secteur. Mais au-delû de cette ûˋnergie productive, cette concurrence se traduit par un mercantilisme exacerbûˋ qui envahit lãensemble du secteur. La marchandisation dãune notoriûˋtûˋ patronymique, comme celle des grands musûˋes, est une pratique hasardeuse et notamment en terme qualitatif dãoffre culturelle. Enfin, sur un plan social, si aux yeux des ûˋlus locaux, cette politique prûˋsente lãavantage de vivifier des quartiers en perte de vitesse, cãest une ûˋvolution û double vitesse pour la population qui se met alors en place. Les quartiers sãembellissent mais tout un pan de la population en est exclu et mûˆme forcûˋ de sãen ûˋloigner. Pour ûˆtre rûˋellement viable, la ville crûˋative se doit dãintûˋgrer la dimension de diversitûˋ culturelle (inclusion sociale, dialogue interculturel, etc.) au sens ethnologique du terme afin de penser une ville plus participative. Mais face au ô¨ô rouleau compresseur de la gentrification [36]ô£ et û cette course au marketing culturel-urbain, cette volontûˋ reste encore relativement utopique.
Simple indice de positionnement ou outil de marketing dûˋployûˋ comme un ûˋtendard, la culture se voit attribuer, en dûˋfinitive, un rûÇle avant tout ûˋconomique. Il est alors lûˋgitime de sãinquiûˋter des transformations intrinsû´ques de la culture et de la viabilitûˋ du concept de ville crûˋative û long terme.

 mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-
mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-