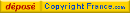Michelle van WEEREN
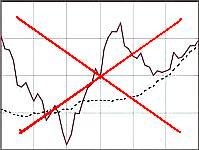 Les Luddites ûˋtaient des ouvriers ô textiles anglais qui, lors dãune ûˋmeute û Manchester en 1811 – 1812, brisû´rent des machines û tisser pour protester contre les nouvelles mûˋthodes de travail mûˋcaniques. Ils tirent leur nom dãune figure mythique, Ned Ludd, qui aurait dûˋtruit la machine de son maûÛtre û la fin du XVIIIe siû´cle et qui est devenu le symbole de ces mouvements de contestation sociale. Lãhistoire des Luddites est souvent citûˋe comme une anecdote qui illustre lãirrationalitûˋ de ceux qui craignent les changements induits par le progrû´s. Car ces machines nãûˋtaient-elles pas juste de simples outils, facilitant le quotidien des travailleurs ? La rûˋponse nãest pas si simple. On ne peut pas penser lãHomme sans les outils techniques avec lesquels il sãentoure et qui lui servent û amûˋliorer sa productivitûˋ et son confort. Or, la relation que lãHomme nourrit vis-û -vis de ces outils est ambivalente. Il ne sãagit pas, comme les technophiles aiment û le penser, dãun rapport fructueux qui contribue de maniû´re linûˋaire au perfectionnement de la condition humaine. Il sãagit au contraire dãune relation caractûˋrisûˋe par des ruptures et des turbulences, oû¿ lãHomme sãest parfois retrouvûˋ dans une situation dûˋsagrûˋable, voire dans une position subordonnûˋe par rapport û lãoutil censûˋ lui faciliter la vie.
Les Luddites ûˋtaient des ouvriers ô textiles anglais qui, lors dãune ûˋmeute û Manchester en 1811 – 1812, brisû´rent des machines û tisser pour protester contre les nouvelles mûˋthodes de travail mûˋcaniques. Ils tirent leur nom dãune figure mythique, Ned Ludd, qui aurait dûˋtruit la machine de son maûÛtre û la fin du XVIIIe siû´cle et qui est devenu le symbole de ces mouvements de contestation sociale. Lãhistoire des Luddites est souvent citûˋe comme une anecdote qui illustre lãirrationalitûˋ de ceux qui craignent les changements induits par le progrû´s. Car ces machines nãûˋtaient-elles pas juste de simples outils, facilitant le quotidien des travailleurs ? La rûˋponse nãest pas si simple. On ne peut pas penser lãHomme sans les outils techniques avec lesquels il sãentoure et qui lui servent û amûˋliorer sa productivitûˋ et son confort. Or, la relation que lãHomme nourrit vis-û -vis de ces outils est ambivalente. Il ne sãagit pas, comme les technophiles aiment û le penser, dãun rapport fructueux qui contribue de maniû´re linûˋaire au perfectionnement de la condition humaine. Il sãagit au contraire dãune relation caractûˋrisûˋe par des ruptures et des turbulences, oû¿ lãHomme sãest parfois retrouvûˋ dans une situation dûˋsagrûˋable, voire dans une position subordonnûˋe par rapport û lãoutil censûˋ lui faciliter la vie.
Cet article retrace la face sombre du progrû´s et examine lãaliûˋnation qui sãest produite, dans le paradigme moderne dominûˋ par la croyance dans le progrû´s, entre les produits techniques et les utilisateurs dãune part, et les outils techniques et les travailleurs dãautre part. Il raconte aussi lãhistoire dãune rûˋponse rûˋcente et cûˋlûˋbrûˋe par de multiples voix û cette aliûˋnation, qui cherche û rûˋinventer la relation û la technique par la ô¨ô dûˋmocratisationô ô£ des modes de production et de consommation de la technique.
Le progrû´s sans les travailleurs
Les Luddites nãûˋtaient pas pris par une peur irrationnelle et conservatrice par rapport aux nouveaux moyens de production. Ils sentaient, tout simplement, que ces nouveaux outils ûˋtaient susceptibles dãinfluencer les rapports de pouvoir quãils entretenaient avec les possesseurs de ces outils ainsi que leurs conditions de travail de maniû´re dûˋsavantageuse. Les machines û tisser automatiques nãûˋtaient pas la propriûˋtûˋ des ouvriers, mais des capitalistes possesseurs des usines. Lãidûˋe derriû´re leur introduction nãûˋtait pas en premier lieu de faciliter les conditions de travail des travailleurs, mais surtout dãaccûˋlûˋrer la production du tissu. Suite û lãûˋmergence de ces machines capables de se substituer û un artisan, ils avaient lãimpression de perdre le contrûÇle sur leur mûˋtier. Puisque la machine pouvait rendre le processus de production plus rapide sans que cela demande des compûˋtences spûˋcifiques de la part des ouvriers, ces derniers se sentaient dûˋpossûˋdûˋs de ce quãils pouvaient apporter de singulier û leur mûˋtier. Tout dãun coup ils se trouvaient dûˋgradûˋs du statut dãartisan û celui de simple travailleur. De plus, ils nãûˋtaient plus maûÛtres de leurs processus de travail, car ils ûˋtaient dûˋsormais soumis au rythme de production dûˋterminûˋ par la machine. Le progrû´s technique ûˋtait alors ûˋprouvûˋ comme une marche dûˋterminûˋe et irrûˋsistible, il devenait angoissant et agressif. Celui qui travaillait et celui qui pensait le progrû´s ûˋtaient dûˋsormais deux personnes diffûˋrentes (Simondon, 1958, p. 116).
Ces ruptures et bouleversements du XVIIIe et XIXe siû´cle sont symptomatiques dãun processus plus profond, dans lequel le progrû´s technique joue un rûÇle de facilitateurô : la domination croissante de lãûˋconomie sur les autres sphû´res de la sociûˋtûˋ. Depuis la Rûˋvolution industrielle, le culte de la productivitûˋ que nous connaissons toujours aujourdãhui sãest instaurûˋ petit û petit dans les sociûˋtûˋs industrialisûˋes. Le rûÇle de la sociûˋtûˋ sãen est trouvûˋ progressivement diminuûˋ, jusquãû ne plus ûˆtre que celui dãun simple rûˋservoir de facteurs de production. Alors que dans les sociûˋtûˋs prûˋindustrielles, comme le met en avant Sahlins (1972), lãûˋconomie nãûˋtait pas au centre de la sociûˋtûˋ mais conûÏue comme une simple mûˋthode pour organiser les ûˋchanges pour que chacun puisse subvenir û ses besoins, on assiste au moment de la Rûˋvolution industrielle û une inversion des moyens et des fins. Lãûˋconomie, qui ûˋtait un moyen au service de la sociûˋtûˋ, devient une fin en soi, et acquiert une valeur pour elle-mûˆme, indûˋpendante de son utilitûˋ pour cette sociûˋtûˋ.
Dans la mesure oû¿ lãemprise de lãûˋconomie sur la sociûˋtûˋ nãa fait que sãintensifier lors de ces derniers siû´cles et que les objets techniques sont toujours, pour la plupart, cûˋlûˋbrûˋs comme des objets neutres destinûˋs û amûˋliorer la condition humaine, il nãest pas surprenant que les phûˋnomû´nes qui jadis suscitaient la colû´re des Luddites constituent toujours un problû´me aujourdãhui. Car tout comme l’introduction des machines û tisser n’a pas forcûˋment amûˋliorûˋ les conditions de travail pour les Luddites, l’automatisation progressive et l’influence croissante des technologies d’information et de communication û laquelle on assiste aujourdãhui n’ont pas eu que des avantages pour les ouvriers modernes.
Lãautomatisation dans lãindustrie est souvent prûˋsentûˋe comme un processus qui libûˋra les ouvriers dãune grande partie des efforts physiques et psychologiques du travail. Or, comme le montre Noble (1955) dans son analyse historique des effets du progrû´s technique sur la vie des ouvriers, depuis son dûˋveloppement dans les annûˋes 50, lãautomatisation de lãindustrie et des services nãa pas conduit û un allû´gement des tûÂches pour les travailleurs. Au cours de trente ans dãautomatisation aux Etats-Unis, les salaires ont moins augmentûˋ que la productivitûˋ (croissance de la production par personne de 115%, augmentation des salaires de 84% en moyenne), le nombre dãheures travaillûˋes est restûˋ stable ou a augmentûˋ, et le chûÇmage a fortement grimpûˋ dans lãindustrie et les services (donnûˋes du Dûˋpartement du Travail des Etats-Unis et du Bureau des Statistiques du Travail, citûˋs par Noble, 1995, p. 109 – 111). Il paraûÛt donc que le progrû´s technique nãa pas ûˋtûˋ utilisûˋ pour rendre la vie des travailleurs plus facile, mais uniquement pour augmenter la production et le profit des entreprises.
La plus grande menace de lãautomatisation pour les travailleurs est toujours la mûˆme quãau XVIIIe siû´cleô : celle du chûÇmage et de la dûˋqualification. Comme le montre un article de The Economist de janvier 2015, la rûˋvolution technique est susceptible de creuser encore plus lãûˋcart entre les favorisûˋs, ceux qui ont fait les meilleures ûˋcoles de commerce et qui disposent du capital intellectuel nûˋcessaire pour se trouver une place dans ce monde hautement technicisûˋ, et les autres. Ce qui sãest passûˋ pour la classe ouvriû´re û partir des annûˋes 60 sãopû´re maintenant pour la classe moyenne : des machines sophistiquûˋes rendent superflu leur travail. Dãaprû´s Andrew McAfee de la Sloan School of Management du MIT (citûˋ dans The Economist, janvier 2015), 50% des postes actuels disparaûÛtront suite û lãautomatisation. Le processus est dûˋjû en marche : en Chine, le premier restaurant avec un personnel composûˋ entiû´rement de robots a ouvert ses portes en 2010.
Une forme spûˋcifique dãautomatisation qui concerne la quasi-totalitûˋ des secteurs ûˋconomiques est la domination croissante des ordinateurs dans les mûˋthodes de travail. Parmi les avantages de lãinformatisation on compte habituellement la simplification du travail et la disparition des tûÂches rûˋpûˋtitives, confiûˋes aux ordinateurs. Lãinformatisation est aussi rûˋputûˋe rendre le travail plus efficace et ûˆtre un facteur important dãaccroissement de la productivitûˋ. Or, ces effets positifs sont loin dãûˆtre univoques. La numûˋrisation de lãûˋconomie est la plus grande menace pour des mûˋtiers traditionnels.
En Allemagne, des courtiers en assurance dãAllianz, la plus grande compagnie dãassurance du monde, peuplent encore des villes et des villages avec leurs agences aux devantures marquûˋes de leur nom. Cãest lû que pendant des dûˋcennies, ils ont accueilli les habitants du quartier pour les conseiller en matiû´re dãassurances. Mais en novembre 2016, Oliver BûÊte, PDG du groupe, prûˋsente son ô¨ô Renewal Agendaô ô£ pour 2018, avec comme ûˋlûˋment clûˋ la numûˋrisation de lãensemble des activitûˋs du groupe (Allianz, 24 novembre 2016). Lãangoisse monte parmi les courtiers indûˋpendants; 630 dãentre eux se sont associûˋs û un groupe Facebook critique oû¿ ils ûˋchangent plaintes et inquiûˋtudes (Wirtschaftswoche, le 6 mai 2015). Bon nombre de postes devraient ûˆtre supprimûˋs dans le cadre de la stratûˋgie de numûˋrisation des assureurs allemands, les estimations fluctuant entre un tiers et la moitiûˋ des postes actuels (Versicherungswirtschaft Heute, le 12 octobre 2016). Dãici 2018, les panneaux dotûˋs du logo dãAllianz accompagnûˋs du nom dãun courtier auront probablement quasiment disparu.
Certains avanceront que si la numûˋrisation fait disparaûÛtre des postes, elle en crûˋe dãautres. Il est vrai quãen tant que spûˋcialiste de lãinformatique, on nãa pas û craindre le chûÇmage dans ces temps modernes. Ce qui ne veut pas dire pour autant quãon soit libûˋrûˋ des conditions de travail difficiles propres aux ouvriers du XVIIIe siû´cle. En rûˋalitûˋ, lãinformatique est û lãorigine dãune nouvelle catûˋgorie de travailleurs exploitûˋs. Les SSII (Sociûˋtûˋ de Services en Ingûˋnierie Informatique), ces entreprises qui envoient leurs employûˋs informaticiens chez des clients oû¿ ils ont pour mission dãaider û instaurer ou û entretenir des systû´mes dãinformation, sont connues pour les conditions de travail dûˋplorables. Dans un article publiûˋ en 2009, Rue89 dûˋnonce ainsi la pression au travail et la vente des compûˋtences inexistantes pour placer le plus de salariûˋs le plus rapidement possible. Ce qui nous intûˋresse ûˋgalement ici, est ô¨ô lãobsolescenceô ô£ rapide des compûˋtences de ces informaticiens. Lãarticle cite en effet un employûˋ du secteur, qui explique le taux de turn-over ûˋlevûˋ dans les SSII de la maniû´re suivante : ô¨ Lãinformatique est un domaine en perpûˋtuelle ûˋvolution. Pour les entreprises clientes, externaliser la main-dãéuvre permet dãûˋviter le risque de se retrouver avec des informaticiens pûˋrimûˋs. ô£ (Rue 89, le 12 mars 2009). Jacques Ellul lãavait dûˋjû notûˋ lorsquãil ûˋcrivait Le bluff technologique en 1977 : lorsque le progrû´s technique sãaccûˋlû´re, le savoir technique devient de plus en plus rapidement obsolû´te (Ellul, 1977, p. 175).
Si le progrû´s technique peut mener au chûÇmage ou û la dûˋqualification pour certains, est-ce quãil nous libû´re au moins des inconvenances du travail physiqueô ? Pas forcûˋment. Lãûˋlimination progressive du travail physique suite û la mûˋcanisation nãa pas pour autant supprimûˋ les maladies professionnelles, le stress ou la fatigue. Qui a dûˋjû fait lãexpûˋrience dãexercer un travail sûˋdentaire sur ordinateur pendant trente-cinq ou quarante heures par semaine, peut en mesurer les possibles et douloureuses consûˋquences : mal de dos, microtraumatismes rûˋpûˋtûˋs de la main, problû´mes de poids. Certains scientifiques tentent de dûˋmontrer que les effets sur notre santûˋ mentale et capacitûˋs intellectuelles peuvent ûˋgalement ûˆtre nocifs. En effet, dãaprû´s certains travaux de recherche, les interruptions frûˋquentes que nous subissons dans cette ûˋpoque caractûˋrisûˋe par la connectivitûˋ permanente perturbent notre cerveau et dûˋgradent notre capacitûˋ de concentrationô (Markowetz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1er Octobre 2015).
Enfin, un autre changement, plus fondamental, sãest opûˋrûˋ dans les modes dãapprentissage modernes suite au progrû´s technique. En effet, la technicisation de lãenseignement implique une culture de lãintelligence pratique et non pas rûˋflexive ou critique. Il faut apprendre û se servir des machines pour ûˆtre capable dãexercer un mûˋtier. Dans les mots dãEllul, ces connaissances pratiques ô¨ô collent lãindividu au concret sans aucune capacitûˋ intellectuelle autre quãopûˋrationnelleô ô£ (Ellul, 1988, p. 175). La victoire de la pratique sur la rûˋflexion se reflû´te aussi dans le dûˋveloppement de lãenseignement supûˋrieur. Avec lãaugmentation de lãinfluence des techniques sur le fonctionnement de lãûˋconomie, les enseignements pratiques ont montûˋ en influence et en notoriûˋtûˋ. Aujourdãhui en France, les ûˋlû´ves sortis dãûˋcole dãingûˋnieur ou de commerce, qui ont appris des compûˋtences concrû´tes directement applicables dans des secteurs ûˋconomiques spûˋcifiques, ont souvent moins de difficultûˋ û trouver un travail que les ûˋtudiants ayant effectuûˋ des ûˋtudes plus thûˋoriques et analytiques û lãuniversitûˋ.
Malgrûˋ ces nombreux exemples de difficultûˋs pour les employûˋs induites par lãautomatisation et lãinformatisation, la technicisation des processus et lieux de travail ne fait gûˋnûˋralement pas lãobjet de nûˋgociations entre managers et salariûˋs. Ceux qui demandent un dûˋbat dûˋmocratique sur ces sujets sont parfois mûˆme ridiculisûˋs, comme le montre lãexemple dãIBM.ô En 1979, en rûˋaction û des protestations contre la disparition de certains postes suite û lãinformatisation, lãentreprise amûˋricaine rappelle û ses salariûˋs que les Luddites ûˋtaient une menace pour lãûˋconomie britannique au XIXe siû´cle et que, û lãaube de la ô¨ô nouvelle rûˋvolution industrielleô ô£, il convenait dãûˋviter ce type de protestation ô¨ô futilesô ô£, puisque ô¨ô itãs not progress itself which is the threat, itãs the way we adapt to it ô£[1]. Protester contre les nouvelles technologies comme le faisaient les Luddites serait aussi bûˆte que de casser des horloges dans lãespoir que cela pourrait ralentir le temps (Robins et Webster citûˋs par Jarrige, 2014, p. 298).
Le progrû´s sans les utilisateurs
Ce nãest pas uniquement chez les travailleurs que le progrû´s technique peut mener û lãaliûˋnation. En observant la queue devant lãApple Store au moment de la sortie de lãiPhone 7, le lien entre progrû´s technique et consumûˋrisme est ûˋvident. Pour ces personnes qui attendent devant la boutique, lãiPhone nãest pas seulement un objet dãutilitûˋ pratique qui les aidera û mieux gûˋrer leur vie quotidienne. Cãest aussi et surtout un signe de prestige et de distinction sociale[2]. Possûˋder la derniû´re version dãun objet technique contribue û accroûÛtre son capital social, au mûˆme titre quãune grande maison ou une voiture onûˋreuse pour la gûˋnûˋration prûˋcûˋdente. La consommation ostentatoire, concept forgûˋ par Veblen lorsquãil observait le comportement de la haute bourgeoisie amûˋricaine de la fin du XIXû´me siû´cle, et dont lãobjectif principal est de confirmer un certain statut social et se dûˋmarquer de ses voisins, sãapplique aujourdãhui aussi bien û la consommation des gadgets techniques. Des entreprises comme Apple ont bien compris que lãobjectif primaire dãun tûˋlûˋphone portable aujourdãhui nãest pas dãeffectuer des appels, et que beaucoup de consommateurs sont prûˆts û payer des sommes importantes pour un design ûˋlûˋgant et une marque prestigieuse. La diffûˋrence avec le monde de Veblen est que, avec lãaugmentation des standards de vie dans les pays industrialisûˋs et ûˋmergents, cette consommation est devenue une consommation de masse qui exacerbe les dûˋgûÂts ûˋcologiques causûˋs par le gaspillage.
Nombreux sont les auteurs qui ont ûˋcrit sur les liens entre progrû´s technique et consumûˋrisme. Illich condamne une sociûˋtûˋ peuplûˋe dãhomme-machines, qui ne connaissent pas la joie placûˋe û portûˋe de main, ou le ô¨ô saut qualitatif quãimpliquerait une ûˋconomie en ûˋquilibre stable avec le monde quãelle habiteô ô£ (p. 34). Ces usagers-consommateurs du monde moderne sont incapables dãenvisager une ô¨ô sobriûˋtûˋ heureuseô ô£, pour emprunter lãexpression de Pierre Rabhi. Dans le paradigme moderne, les consommateurs croient que ce qui est nouveau est toujours meilleur. Or, cette croyance crûˋûˋ forcûˋment toujours de nouveaux besoins, car si ce qui est nouveau est meilleur, ce qui est vieux nãest pas si bon (Illich, p. 111). Le consommateur ressent toujours cet ûˋcart entre ce quãil a et ce quãil pourrait avoir, ou, dans les termes de cette sûˋrie amûˋricaine exemplaire du consumûˋrisme des annûˋes 60ô : ô¨ô Happiness is the moment before you need more happiness. ô£ (Don Draper, Mad Men).
Ellul, pour sa part, estime que lãincitation û la consommation est une dynamique inhûˋrente au progrû´s technique. ô¨ Lãimportant, û partir du moment oû¿ il y a crûˋation dãun produit technique avancûˋ, cãest dãobliger le consommateur û lãutiliser, mûˆme sãil nãy trouve aucun intûˋrûˆt. Le progrû´s technique le commande ô£ (Ellul, 1988, p. 247). Il dûˋcrit ainsi trois types de besoins crûˋes par le progrû´s technique qui stimulent le consumûˋrisme.
Premiû´rement, il note les besoins nouvellement crûˋûˋs. Car le progrû´s technique ne fait pas que rûˋpondre aux besoins, il en produit ûˋgalement. Les gadgets, quãEllul dûˋcrit comme des ô¨ô inventions techniques qui prûˋsentent une utilitûˋ disproportionnûˋe û lãinvestissement multiple quãelles impliquentô ô£ (Ellul, 1988, p. 313), relû´vent typiquement des besoins nouveaux. Ces besoins nouveaux sont gûˋnûˋrûˋs par la publicitûˋ, par les dynamiques de comparaison et de distinction sociale mentionnûˋes plus haut ou par la simple crûˋation dãune nouvelle possibilitûˋ. Le besoin dãune fûˋcondation in vitro naûÛt ainsi avec sa possibilitûˋ technique (Ellul, 1988, p. 311). Dans nos sociûˋtûˋs hautement technicisûˋes, oû¿ les nouvelles possibilitûˋs crûˋûˋes par les techniques sont abondantes, il est parfois difficile de distinguer les besoins primaires, nûˋs dãun manque ou dãun dysfonctionnement, et les besoins nouvellement crûˋûˋs. Car lorsquãun nouveau besoin est suffisamment ancrûˋ dans les méurs, il devient, dans la perception de la majoritûˋ, un besoin naturel. Le dûˋsir dãun enfant est ainsi perûÏu comme un besoin tout û fait normal pour la plupart des couples. Lorsque quãun couple a des problû´mes de fertilitûˋ, il y a peu de gens qui condamneraient le recours aux artifices. Pour Cûˋline Lafontaine en revanche, sociologue canadienne et auteur dãun ouvrage rûˋcent sur les effets de la bio-ûˋconomie sur la marchandisation du corps, il se cache une logique consumûˋriste derriû´re lãidûˋe quãun enfant soit un droit. Pour elle, les techniques modernes de fûˋcondation artificielle ont crûˋûˋ un nouveau besoin difficilement justifiable[3] (Lafontaine, 2014).
Le deuxiû´me type de besoins mentionnûˋ par Ellul correspond û des besoins de compensation. Ce phûˋnomû´ne fait penser û lãincapacitûˋ de la technique de rûˋsoudre des problû´mes sans en crûˋer dãautres. Comme pour les Parisiens qui supportent mal la vie dans une ville dense et polluûˋe et ont ô¨ô besoinô ô£ de partir en week-end û la campagne rûˋguliû´rement pour ô¨ô respirerô ô£, la plupart dãentre nous a besoin de compenser les effets de notre vie dominûˋe par des techniques de toutes sortes (travail sûˋdentaire sur ordinateur, stress crûˋûˋ par les embouteillages pendant le trajet domicile-bureau, pollution causûˋe par les vûˋhicules motorisûˋs, etc.) par dãautres techniques, dites de relaxationô : yoga, camping, jogging, rûˋgimes alimentaires, etc.
Enfin, il y a les besoins accessoires, qui accompagnent et perpûˋtuent les besoins nouvellement crûˋûˋs. Comme le cadre de vie est constamment modifiûˋ, les besoins sont ûˋgalement constamment modifiûˋs. La technique crûˋe plus de techniques (Ellul, 1988, p. 314) : des accessoires pour ordinateur, des chargeurs, cartouches, etc. Dans de nombreux cas, il faut en plus que la marque de ces produits techniques soit compatible avec celle des produits dûˋjû en possession pour fonctionner, ce qui aggrave les effets de gaspillage.
Quelles conclusions tirer de ce lien entre progrû´s technique et consumûˋrismeô ? Certes, lãHomme a toujours inventûˋ et utilisûˋ des objets et des artefacts techniques pour amûˋliorer ses conditions dãexistence. Il nãy rien de nouveau û cela. Ce qui est nouveau en revanche, cãest la dûˋconnexion entre la fonctionnalitûˋ de lãobjet technique et son utilisateur. Nous nous entourons aujourdãhui dãune quantitûˋ dãobjets techniques toujours plus grande, dont chaque objet individuel est dãune complexitûˋ croissante. Lãhomme de jadis qui se servait dãune lance pour chasser le gibier comprenait comment son objet fonctionnait, souvent il en ûˋtait le crûˋateur. Lãhomme moderne, qui achû´te sa viande issue de lãindustrie agroalimentaire en hypermarchûˋ, qui prend la voiture pour se rendre au travail et qui utilise des appareils et technologies de communication complexes pour travailler et entretenir des contacts sociaux, nãa gûˋnûˋralement aucune idûˋe des modes de production exactes de sa nourriture, du fonctionnement de son moyen de transport ou de ses outils de travail. Il sãest transformûˋ dãun utilisateur, maûÛtre de son objet technique, en un consommateur pur, qui, au moment oû¿ son ordinateur tombe en panne, nãa pas dãautre choix que de se rendre dans un atelier de rûˋparation spûˋcialisûˋ.
Est-ce bien grave, tout celaô ? Lorsque la mesure du jugement est celle du dûˋveloppement durable, et lãobjectif de construire un monde commun avec des conditions de vie acceptables, aujourdãhui et dans lãavenir, il est clair que lãattitude consumûˋriste et aliûˋnûˋe vis-û -vis des objets techniques, qui favorise la nûˋgligence et le gaspillage, nãest pas û privilûˋgier.
Les exemples mentionnûˋs plus hauts dûˋcrivent des formes dãaliûˋnation quãon a pu observer chez les travailleurs et les utilisateurs suite au progrû´s technique incontrûÇlûˋ, sur lequel on ne peut pas influer. Cette aliûˋnation est caractûˋristique de la sociûˋtûˋ moderne dans son ensemble. Comme pour chaque changement majeur aux consûˋquences nûˋgatives, des contrecourants qui tentent de regagner le contrûÇle sur la technique sont apparus ces derniû´res annûˋes.
Mouvements contemporainsô : signe dãune rûˋappropriation de la techniqueô ?
Dans le cadre des bouleversements techniques et ûˋconomiques que nous vivons, on entend de plus en plus parler de la prosommation. La prosommation implique û la fois la production et la consommation dãun produit et a notamment pris de lãampleur, dans un premier temps, dans le cadre de contenus crûˋûˋs par des utilisateurs sur Internet.
Lãun des adeptes les plus optimistes de lãûˋconomie ô¨ô horizontaleô ô£ qui est la sphû´re des prosommateurs (par opposition û lãûˋconomie verticale, oû¿ le consommateur ne peut pas influencer le processus de crûˋation des objets de consommation produits par des entreprises) est lãintellectuel cûˋlû´bre Jeremy Rifkin. Rifkin voit dans le dûˋveloppement rapide des nouvelles technologies lãûˋmergence dãun nouveau paradigme ûˋconomique qui va se substituer û lãancien paradigme du propriûˋtaire du capital et du travailleur, du vendeur et du consommateur. Dans ce nouveau modû´le, des prosommateurs produiront, partageront et consommeront dans ce que Rifkin appelle les ô¨ô communaux collaboratifsô ô£. Pour lui, lãautomatisation, dont on a vu les consûˋquences problûˋmatiques plus haut, rûˋsultera au contraire en la libûˋration des anciens travailleurs, qui nãauront plus besoin de travailler pour produire, mais qui pourraient consacrer leur temps û ô¨ô jouerô ô£ dans ces communaux collaboratifs en ligneô : crowdfunding, couchsurfing, covoiturage, impression 3D etc. (Rifkin, 2014, p. 201). Rifkin prûˋcise bien que cãest grûÂce au dûˋveloppement de nouvelles technologies de communication que ce nouveau paradigme pourrait voir le jour.
Un exemple concret de ce nouveau monde collaboratif et dûˋcentralisûˋ peut dãores et dûˋjû ûˆtre observûˋ dans lãûˋmergence du rûˋseau des Fab Labs. Le premier Fab Lab a ûˋtûˋ crûˋûˋ en 2005 par Neil Gershenfeld, physicien et enseignant au MIT (Massachussetts Institute of Technology), comme rûˋsultat de son cours ô¨ô How to create (almost) everything ô£. Les Fab Labs sont des plateformes de prototypage technique et de crûˋation numûˋrique rapide ouvertes û tous, dotûˋes dãun certain nombre dãappareils de fabrication sophistiquûˋs et opûˋrûˋs par des systû´mes dãinformation open source. Les Fab Labs, dont le nombre est en croissance rapide un peu partout dans le monde, se disent ûˆtre porteurs de la ô¨ô dûˋmocratisation de lãaccû´s aux outils de lãinvention techniqueô ô£ (Fab Foundation, 2015) et adeptes dãun modû´le non-hiûˋrarchique de lãapprentissage. Dans ces espaces, il sãagit de fabriquer des objets dãexpression personnelle, dãinventer librement, de ô¨ô jouerô ô£ avec les objets techniques. La Charte des Fab Labs de la Fab Foundation prûˋcise que lãûˋducation et lãaccû´s libre constituent les aspects les plus importants de la vie dãun Fab Lab, auxquels les activitûˋs commerciales qui peuvent y ûˆtre initiûˋes ne doivent pas faire obstacle (The Fab Charter, Fab Foundation, 2015). La plupart des membres des Fab Labs, les ô¨ô crûˋateursô ô£ ou ô¨ô makersô ô£, sont convaincus que leur mouvement sera û lãorigine dãune vûˋritable rûˋvolution dans les maniû´res dont les objets sont fabriquûˋsô : la production de masse et centralisûˋe serait ainsi remplacûˋe petit û petit par des mûˋthodes de fabrication dûˋcentralisûˋes, adaptûˋes en fonction des besoins individuels de chacun et en tenant compte de la soutenabilitûˋ des ressources (FabLab iMAL). Le mouvement Fab Lab entend donc non seulement dûˋmocratiser et dûˋcentraliser les processus dãinnovation, mais se pense aussi porteur dãune transformation durable de la production.
Or, un certain nombre de problû´mes se posent quant au potentiel dûˋmocratique et durable de ces mouvements.
Le premier concerne lãûˋgalitûˋ dãaccû´s. Les membres des Fab Labs correspondent le plus souvent aux caractûˋristiques des ô¨ô individus connectûˋsô ô£ô (Flichy, 2004)ô : ces personnes autonomes et flexibles capables de sãadapter en permanence aux dûˋveloppements rapides qui caractûˋrisent lãûˋconomie et la technologie de nos jours. En mûˆme temps, les valeurs dãentraide et dãapprentissage pair-û -pair renvoient û la recherche dãune ûˋthique collective et û lãentretien dãune communautûˋ (Toombs et al., 2015). Cette combinaison dãautonomisation et de solidaritûˋ fait que pour certains, le Fab Lab pourrait apporter une rûˋponse aux problû´mes de pauvretûˋ en donnant aux peuples les clûˋs pour sãentraider. Pour Rifkin, le Fab Lab est le ô¨ô laboratoire de recherche-dûˋveloppement du peuple de la troisiû´me rûˋvolution industrielleô ô£ (Rifkin, 2015, p. 144). Pour lui, il sãagit de dûˋmocratiser lãinnovation en la sortant des ô¨ô laboratoires ûˋlitistesô ô£ pour la rûˋpartir dans les quartiers et localitûˋs.
Mais malgrûˋ la faûÏade dãouverture û tous, il nãen reste pas moins que la plupart des membres des Fab Labs rûˋpondent û un profil stûˋrûˋotypûˋô : issu des classes moyennes ou supûˋrieures, autour de la trentaine, blanc, homme, diplûÇmûˋ, aisûˋ. Le pourcentage de femmes, dãimmigrûˋs ou de personnes issues de familles modestes y est relativement bas (Arnes et al., 2014). Les communautûˋs que ces personnes construisent sont en quelque sorte des communautûˋs de privilûˋgiûˋs, et ceux qui nãy trouvent pas accû´s ne profiteront pas de la circulation de savoirs et de compûˋtences. Malgrûˋ son optimisme (certains dirontô : utopisme), Rifkin avoue tout de mûˆme que la plupart des Fab Labs sont aujourdãhui localisûˋs dans des zones urbanisûˋes des pays industrialisûˋs, ce qui rûˋserve donc la ô¨ô dûˋmocratisation de lãinnovationô ô£ û ceux qui disposent dûˋjû de la plupart des ressources.
Le deuxiû´me problû´me est celui de lãinnovation responsable. Nous avons vu plus haut que les Fab Labs se rûˋclament non seulement des plateformes de dûˋmocratisation de lãinnovation, mais entendent ûˋgalement rendre les crûˋations techniques plus durables. Or, quand lãinnovation est librement accessible û tous et le cycle invention ã production ã mise sur le marchûˋ est accûˋlûˋrûˋ car libûˋrûˋ de toute contrainte ou formalitûˋ, qui contrûÇle les risques liûˋs aux innovationsô ? Quel type dãûˋconomie crûˋeront ces prosommateurs et individus connectûˋsô ?
Des exemples de cette auto-organisation – et de ses dûˋrives – prolifû´rentô : Airbnb, qui donne la possibilitûˋ aux particuliers de gagner beaucoup dãargent en louant leur appartement sans payer dãimpûÇts ni se conformer aux mûˆmes rû´gles que les professionnels du secteur, Uber, qui met en relation chauffeurs privûˋs et voyageurs, court-circuitant le cadre lûˋgalãÎ Au nom de ô¨ô lãûˋconomie du partageô ô£, ces initiatives donnent la libertûˋ aux utilisateurs de crûˋer des business trû´s lucratifs mais avec parfois des effets nûˋgatifs pour lãintûˋrûˆt gûˋnûˋral. A Paris, suite au dûˋveloppement dãAirbnb, on observe une concurrence dûˋloyale û lãûˋgard des hûÇtels et la perte de la convivialitûˋ et de lãesprit du voisinage dans certains quartiers trû´s prisûˋs, oû¿ des logements locatifs sont transformûˋs illûˋgalement en meublûˋ touristique. Pour ces exemples de lãûˋconomie des prosommateurs, la frontiû´re entre esprit libertaire et ultralibûˋralisme sãavû´re trû´s fine.
Le souci principal qui ûˋmerge avec lãinnovation libre et ouverte û tous est la disparition progressive de contraintes procûˋdurales ou organisationnelles qui, dans le cadre de lãinnovation technique contrûÇlûˋe par les entreprises, ralentissaient encore quelque peu les processus. Avec la baisse des coû£ts de production grûÂce aux nouvelles techniques, les barriû´res û lãinnovation et û la production disparaissent peu û peu. A aucun moment on ne trouve un moment dãhûˋsitation, de ralentissement, de prise de recul quant aux dynamiques dãinnovation bouleversantes et aux produits qui en sont le rûˋsultat. Comme lãindique dûˋjû le nom du cours de Neil Gershenfield qui avait donnûˋ naissance au premier Fab Lab, ô¨ô How to create (almost) everything ô£, le ralentissement des processus au profit de la dûˋlibûˋration commune ne fait pas partie du modû´le dãinnovation promu par ces mouvements. Dans un ô¨ô TedX talkô ô£ du juillet 2014, le directeur du Media Lab du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Joi Ito, sãenthousiasme sur la baisse des coû£ts et des contraintes suite au dûˋveloppement dãInternet et dãautres nouvelles technologies, libûˋrant la voie pour un nouveau type dãinnovation : rapide, chaotique, difficile û contrûÇler et ô¨ô dûˋmocratiqueô ô£. Il sãoppose aux modû´les classiques de lãapprentissage (ô¨ô û quoi bon apprendre lãencyclopûˋdie par céur alors quãon a tous accû´s û Wikipûˋdia sur nos tûˋlûˋphones ?ô ô£)ô û la planification et au contrûÇle et plaide pour lãinnovation ô¨ô sans permissionô ô£ (Joi Ito, TedX, 7 juillet 2014).
En revanche, cette innovation ô¨ô sans permissionô ô£ peut engendrer des situations dangereuses. En 2012, lãûˋtudiant en droit amûˋricain Cody Wilson avait dûˋveloppûˋ des modû´les pour des armes û feu imprimables et les avait partagûˋs sur le site de libre partage Thingiverse, crûˋûˋ par MakerBot, une start-up dans le domaine de lãimpression 3D. Aprû´s que celle-ci eu retirûˋ les modû´les de son site, Wilson a fondûˋ Defense Distributed, une association û but non-lucratif qui dûˋveloppe et distribue des modû´les pour des armes û feu open source (Lopez et Tweel, 2014). Lãexemple montre que mûˆme si lãun des principes du mouvement open source est le pacifisme, il nãy a aucun moyen de contrûÇler les actions de ceux qui ont dãautres intentions.
Le type dãinnovation quãon voit naûÛtre au sein de ces mouvements semble donc avoir plusieurs visages. Lû oû¿ il semble permettre de court-circuiter les monopoles et donner plus dãinfluence aux citoyens, il apporte en mûˆme temps de nouveaux risques pour lesquels on nãa pas encore trouvûˋ de procûˋdures de gestion, tûÂche qui se trouve compliquûˋe par la vitesse avec laquelle les choses se dûˋveloppent.
Pour emprunter les propos de Jarrige: ô¨ô Loin dãûˆtre lãexpression dãune prise de recul face û la prolifûˋration des techniques, dãune vûˋritable dûˋmocratisation, lãutopie libertaire des mouvements de (bio)hackers favorise lãabandon des discours critiques au profit de nouvelles utopies technologiquesô ô£ (2014, p. 286).
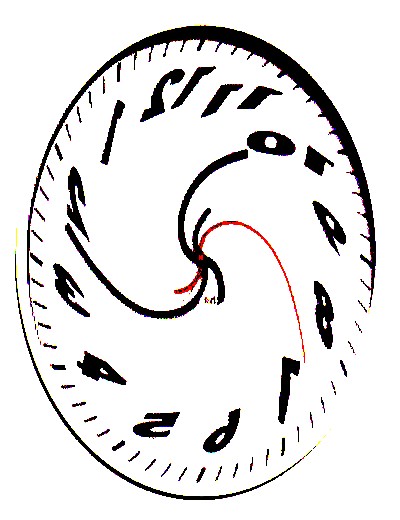

 mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-
mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-