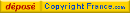Michelle van WEEREN
 ô¨ô Nous demeurons partout enchaûÛnûˋs û la technique et privûˋs de libertûˋ, que nous lãaffirmions avec passion ou que nous nous en dûˋfendions. Quand cependant nous considûˋrons la technique comme quelque chose de neutre, cãest alors que nous lui sommes livrûˋs de la pire faûÏon : car cette conception, qui jouit aujourdãhui dãune faveur toute particuliû´re, nous rend complû´tement aveugles quant û ce qui fait lãessence mûˆme de la techniqueô£ Martin Heidegger, La question de la technique (1958)
ô¨ô Nous demeurons partout enchaûÛnûˋs û la technique et privûˋs de libertûˋ, que nous lãaffirmions avec passion ou que nous nous en dûˋfendions. Quand cependant nous considûˋrons la technique comme quelque chose de neutre, cãest alors que nous lui sommes livrûˋs de la pire faûÏon : car cette conception, qui jouit aujourdãhui dãune faveur toute particuliû´re, nous rend complû´tement aveugles quant û ce qui fait lãessence mûˆme de la techniqueô£ Martin Heidegger, La question de la technique (1958)
Trois attitudes possibles
Quand il sãagit de lãessence de la technique, trois attitudes diffûˋrentes peuvent ûˆtre observûˋes.
Premiû´rement, les adeptes du progrû´s au sens moderne considû´rent les techniques comme de simples objets neutres, des ô¨ô objets sans risqueô ô£ (Latour, 1999), indiffûˋrents û leurs effets sociaux, environnementaux ou politiques, et destinûˋs û aider lãhumanitûˋ û aller de lãavant. Dans cette optique, lãobjet technique en lui-mûˆme est neutre, tout dûˋpend de lãusage quãon en fait. La technophilie, qui affirme que les techniques sont des outils merveilleux susceptibles dãamûˋliorer les conditions de la vie humaine, sãinscrit dans cette mûˆme idûˋe de neutralitûˋ des techniques.
Pourtant, les exemples qui montrent combien les techniques sont loin dãûˆtre des outils neutres mais au contraire revûˆtent des trajectoires particuliû´res et dûˋterminent le champ des possibles sont abondants. Les techniques sont porteuses dãune logique propre et interviennent activement dans la construction de notre monde : ce nãest pas parce que nous les avons crûˋûˋes quãelles nãexistent pas û leur propre ûˋchelle. Comme lãaffirme Michel Callon, les non-humains, et particuliû´rement les technologies, jouent un rûÇle actif dans le formatage de la sociûˋtûˋ : elles jettent des ponts entre groupes hûˋtûˋrogû´nes, font ûˋmerger de nouveaux collectifs, modifient les conceptions du temps et de lãespace et ûˋtendent les possibilitûˋs de ce qui est rûˋalisable (Callon, 2004). Par exemple, le dûˋveloppement des ondes ûˋlectromagnûˋtiques a fait ûˋmerger la nouvelle identitûˋ des ûˋlectro-hypersensibles, groupe qui nãexistait pas avant lãûˋmergence de cette technique (Chateaureynaud et Debaz, 2010).
Les humains, û leur tour, ne sont pas des sujets autonomes, maûÛtres du progrû´s technique qui cherchent rationnellement û rûˋpondre aux besoins de lãhumanitûˋ. Ils se trouvent eux-mûˆmes faûÏonnûˋs et influencûˋs par les techniques quãils ont fabriquûˋes. Leurs capacitûˋs sont dynamiques et flexibles en fonction des environnements sociotechniques dont ils dûˋpendent (Callon, 2004). Les techniques modifient profondûˋment notre maniû´re de penser, de travailler, de se comporter. Gûˋrard Berry, informaticien au CNRS, donne un exemple parlant û cet ûˋgard. Selon lui, ô¨ô des choses qui ûˋtaient triviales deviennent faciles, comme attendre le bus. Maintenant, on peut chercher les horaires de bus sur Internet, ce qui nous ûˋvite de perdre le temps û lãattendre quand il arrive dans longtemps. En revanche, des choses qui ûˋtaient naturelles auparavant deviennent plus compliquûˋes, comme les relations humaines. Puisque nous prûˆtons ûˋnormûˋment dãattention û nos appareils, nous oublions parfois de remarquer quãil y a dãautres humais autour de nousô ô£ (Berry citûˋ par De la Porte, fûˋvrier 2015). Parfois, les technologies ne tiennent pas complû´tement leurs promesses, comme le constatent ces utilisateurs de smartphones censûˋs accroûÛtre leur productivitûˋ, qui remarquent que leur capacitûˋ de concentration a diminuûˋ suite aux interruptions permanentes auxquelles ils sont soumis par ces derniers. Quoi quãil en soit, ce qui est certain, comme lãexprime Jacques Ellul : ô¨ô si lãusage dûˋtermine tout, nous sommes û notre tour modifiûˋs dans notre usageô ô£ (Ellul, 1988, p. 56).
Les techniques ne sont donc pas neutres. Sont-elles alors des entitûˋs autonomes disposant dãune conscience propre, quãil faut craindre et contrûÇlerô ? Sãinscrivant dans cette ligne de pensûˋe, Raya Dunayevskaya, ancienne secrûˋtaire de Trotski, critique lãautomatisation des annûˋes 1950 aux Etats-Unis en ûˋvoquant les ô¨ô monstres automatesô ô£ qui ô¨ô imposent un rythme dix fois plus grandô ô£ et accroissent ainsi le chûÇmage et lãaliûˋnation des travailleurs. Elle affirme que ô¨ô les machines assassinent les hommes, elles ne cessent de se dûˋtraquer et dûˋtraquent le systû´me nerveux de ceux qui travaillent dessusô ô£ (Dunayevskaya citûˋe par Jarrige, 2014, p. 255).
La technophilie et la technophobie relû´vent du mûˆme paradigme moderne. Les dualismes simplistes (faits/valeurs, objets/sujets, hommes/machines, nature/culture, etc.) sur lesquels la modernitûˋ a construit son discours donnent un cadre thûˋorique aussi bien û lãidûˋe de techniques comme objets neutres quãû lãaffirmation dãobjets techniques comme entitûˋs dangereuses. Mais il existe une troisiû´me attitude.
En effet, quand les Luddites, ces ouvriers de textile du XIXe siû´cle, se rebellaient contre les machines û filer, ils contestaient les jeux de pouvoir et de domination incorporûˋs par les techniques. Ils ûˋtaient conscients que ces machines nãûˋtaient pas le seul rûˋsultat possible des trajectoires techniques, quãil existait des alternatives qui auraient possiblement prûˋservûˋ leurs compûˋtences et savoir-faire. Ils rûˋclamaient donc un dûˋbat politique vûˋritable sur le choix de ces machines et leurs consûˋquences sociales. La troisiû´me attitude vis-û -vis des machines consiste û les considûˋrer comme des hybrides : des entitûˋs qui sont le rûˋsultat des choix politiques mais ûˋgalement porteuses dãune logique propre, capables dãinfluencer les rûˋseaux sociotechniques dont elles font partie.
En effet, dans un monde caractûˋrisûˋ par lãincertitude sur lãavenir technique de nos sociûˋtûˋs, il nãest pas possible de continuer û affirmer que les techniques sont de simples outils manipulables par lãhomme. En revanche, considûˋrer la technique comme une force autonome qui nous dûˋpasserait et nous dominerait obscurcit le rûÇle des choix politiques qui dûˋterminent leur dûˋveloppement. Il ne reste quãû rejeter la sûˋparation entre technique et sociûˋtûˋ et accepter que les deux ûˋvoluent conjointement, sãinfluenûÏant mutuellement dans un processus continu. Dû´s quãon a acceptûˋ ce constat, comment faire en sorte que ce processus se dûˋroule de maniû´re positive pour la sociûˋtûˋ toute entiû´reô ? Comment, dans les propos dãIsabelle Stengers, ô¨ô soumettre la fabrication des objets et des produits technoscientifiques û des fins dûˋsirables pour tous plutûÇt quãau seul objectif impûˋratif du profit maximalô ô£ô (2007) ? Deux approches complûˋmentaires semblent alors primordiales.
Prendre du temps
Le rapport au temps dans la sociûˋtûˋ moderne, et par consûˋquence dans lãentreprise moderne qui en fait partie, a rûˋsultûˋ en une accûˋlûˋration spectaculaire des processus dãinnovation. Sous la pression concurrentielle, les entreprises innovantes sont contraintes de mettre sur le marchûˋ de nouveaux produits toujours plus rapidement. Il nãest pas surprenant que tout cela ne favorise pas la prise de recul quant aux consûˋquences sociûˋtales ou environnementales ûˋventuelles de ces innovations. Loin de donner lãespace et le temps û la prise de recul, la plupart des innovations techniques actuelles sont au contraire destinûˋes û nous faire ô¨ô gagner du tempsô ô£. Dans le paradigme moderne, aller vite est devenu une valeur en soi, que lãon ne conteste plus (Ellul, 1988, p. 308).
En revanche, lorsque lãon sort lãinnovation du cadre classique de lãentreprise centralisûˋe, et quãelle est libûˋrûˋe de toute contrainte formelle, de tout contrûÇle collectif, et quãelle prend la forme dãun processus individualisûˋ, voire privatisûˋ, le type dãinnovations techniques ne sãapproche alors pas nûˋcessairement de ce quãon pourrait dûˋsigner dãinnovation ô¨ô responsable ô£.
Pourtant, prendre du temps est primordial quand il sãagit du progrû´s technique. Comme le remarque Mike Cooley, membre dãun syndicat anglais pour les travailleurs de lãaûˋronautique, en 1982 : ô¨ô La vraie tragûˋdie est quãavec la course en avant frûˋnûˋtique, on nãa pas le temps dãexaminer les implications culturelles, politiques, et sociales avant que des nouvelles infrastructures ne soient ûˋtablies, ce qui ûˋcarte toute ûˋtude dãalternativesô ô£ (Cooley citûˋ par Noble, 1995, p. 51). Prendre du temps ne veut pas dire arrûˆter le progrû´s. Il sãagit juste dãintroduire un moment dãhûˋsitation avant de se lancer dans telle ou telle innovation technique, dãûˋcouter les voix contestataires et dãassigner des porte-paroles aux voix sans reprûˋsentation politique. Le but est de crûˋer un monde commun viable et vivable dans lequel les techniques trouvent leur place (Callon et al., 2001)ô ; pour rendre cela possible, un minimum de prise de recul et de rûˋflexion commune avant de leur ouvrir la porte semble indispensable.
Ce moment dãhûˋsitation sera lãoccasion de se poser un certain nombre de questions, comme par exempleô :
- Quels seront les effets secondaires dãune application gûˋnûˋralisûˋe de cette technique, tant sur le plan matûˋriel que social ?
- Quels seront les changements sociaux nûˋcessaires avant quãon puisse la mettre en éuvre ô correctement ?
- Quels sont les effets sociaux probables de lãapplication de cette innovationô ?
- Quelles sont les consûˋquences environnementales probables de la gûˋnûˋralisation de cette innovationô ?
- Peut-on imaginer dãautres consûˋquences sociales ou environnementales qui ne semblent pas probables mais dont on ne peut pas exclure quãelles surviennentô suite û lãapplication de cette techniqueô ? ô ô ô Etc.
Pour finir sur lãimportance de la rûˋflexion dans les processus dãinnovation, un dernier exemple rûˋvûˋlateurô : la Technische UniversitûÊt Berlin, la deuxiû´me plus grande universitûˋ de la capitale allemande, a produit de nombreux scientifiques de renommûˋe et est û lãorigine de multiples innovations et dûˋveloppements techniques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lãuniversitûˋ a contribuûˋ û la crûˋation de diffûˋrentes inventions techniques au service de lãessor du IIIû´me Reich. Cãest pourquoi en 1948, les Alliûˋs ont seulement acceptûˋ la rûˋouverture de lãûˋtablissement û condition de fonder, û cûÇtûˋ des facultûˋs techniques, une facultûˋ de sciences humaines et de philosophie. Lãidûˋe ûˋtait quãune universitûˋ qui enseigne uniquement des sciences exactes et techniques peut ûˆtre dangereuseô ; la Facultûˋ I devait ainsi donner la possibilitûˋ de prendre du temps et de rûˋflûˋchir aux consûˋquences des innovations rûˋalisûˋes dans les autres facultûˋs. Que cette facultûˋ soit aujourdãhui moins bien dotûˋe en ressources et ûˋtudiants que les autres indique malheureusement que son importance nãest pas estimûˋe û sa juste valeur.
Multiplier les liens
Les deux attitudes simplistes et contradictoires que sont la technophilie et la technophobie nous ont conduit û considûˋrer lãobjet technique comme un ô¨ô ûˋtrangerô ô£, une entitûˋ ûˋtrange quãon a du mal û donner une place dans notre monde. Mais cette aliûˋnation nãest pas une fatalitûˋ. Lãhomme sãest toujours entourûˋ dãobjets techniques pour amûˋliorer les conditions de son existence. Les techniques font partie de son ûˆtre au mûˆme titre que le pelage fait partie de lãûˆtre dãun animal. Les machines ne sont pas humaines, certes, et ne font pas partie du corps humain û proprement parler. Mais on ne peut pas imaginer lãhomme sans ses attributs et artifices qui le distinguent de la plupart des autres animaux. Aprû´s avoir ûˋliminûˋ lãaccûˋlûˋration et avoir rûˋintroduit la rûˋflexivitûˋ dans les processus dãinnovation, le tout est de dûˋterminer quels objets techniques peuvent faire partie du monde commun, et avec quels liens ils peuvent sãattacher aux autres entitûˋs qui peuplent ce monde, humains et non-humains. En renforûÏant les liens avec ces objets techniques qui sont jugûˋs ûˋligibles û faire partie du monde commun, il est possible dãenfin les considûˋrer comme des ûˋlûˋments de co-construction de la sociûˋtûˋ û part entiû´re. Dans cette dûˋmarche, une distinction peut ûˆtre faite entre travailleursô et utilisateurs.
Afin de dûˋpasser lãaliûˋnation des travailleurs vis-û -vis de leurs outils de travail, dãaprû´s Simondon (1958), renforcer les liens suppose une culture technicienne, qui ne se situe non seulement dans la finalitûˋ des techniques mais aussi dans leur fonctionnement (p. 119). Pour cela, il propose de complûˋter le travail rûˋgulier, effectuûˋ û travers des auxiliaires techniques, par ce quãil appelle lãactivitûˋ technique. Celle-ci comporterait non seulement lãutilisation de la machine, mais aussi une ô¨ô attention portûˋe au fonctionnement technique, entretien, rûˋglage, amûˋlioration de la machine, qui prolonge lãactivitûˋ dãinvention et de constructionô ô£ (p. 250), approchant ainsi les travailleurs des machines quãils cûÇtoient quotidiennement. Par la crûˋation de cette culture technicienne, il est possible de multiplier les liens entre ouvrier et objet technique. Le premier reconnaûÛt dûˋsormais quãil forme avec ce dernier un collectif sociotechnique et que les machines lui ouvrent des possibilitûˋs quãil nãavait pas auparavant.
Les utilisateurs dãappareils techniques, quant û eux, se trouvent dans une situation comparable dãaliûˋnation. Le problû´me de lãobsolescence rapide des appareils ûˋlectroniques y trouve en partie sa cause: neufs pendant peu de temps, ils se dûˋgradent progressivement sans que lãutilisateur puisse intervenir pour effectuer des rûˋparations, car il ne comprend pas le fonctionnement de la machine. Il nãest pas non plus censûˋ le comprendre : la garantie, quãil a achetûˋe comme partie de la transaction ûˋconomique, lui accorde le droit de renvoyer son appareil au fabricateur en cas de dûˋfaillance prûˋcoce. Si cette dûˋfaillance ûˋmerge au-delû de la pûˋriode de la garantie, lãutilisateur se dûˋbarrasse de son appareil pour en acheter un nouveau. ô Ellul (1988) note que ô¨ô les objets techniques qui produisent le plus lãaliûˋnation sont ceux qui sont destinûˋs û des utilisateurs ignorantsô ô£ (p. 251). Pirsig (1974) consacre un roman emblûˋmatique û la cûˋlûˋbration de cette culture technicienne appliquûˋe û lãentretien des motos, et dûˋplore lãabsence de liens entre la plupart des motards et leurs machines, attitude reflûˋtûˋe par les manuels dãentretien: ô¨ô But what struck me for the most time was the agreement of these manuals with the spectator attitude I had seen in the shop. (ãÎ) Implicit in every line is the idea that ô¨ô Here is the machine, isolated in time and in space from everything else in the universe. It has no relationship to it, other than turn certain switches, maintain voltage levels, check for error conditionãÎ and so on. (ãÎ) And it occured to me there is no manual that deals with the real business of motorcycle maintenance, the most important aspect of all. Caring about what you are doing is either considered unimportant or taken for granted.ô ô£ (p. 34).
Si on arrive, û lãimage du travailleur qui retrouve les liens avec son outil de travail par une ô¨ô culture technicienneô ô£, û franchir la barriû´re entre la construction et lãutilisation des objets par la multiplication des liens entre lãobjet et son utilisateur, pour que ce dernier prenne soin de ce premier, la dûˋvaluation des objets techniques sera probablement moins gûˋnûˋralisûˋe. Latouche ûˋgalement estime que la multiplication des liens entre utilisateur et objet technique pourrait aider û lutter contre lãobsolescence et le gaspillageô : pour lui, il faudrait rattacher la ô¨ô nostalgieô ô£ aux objets pour quãon fasse un effort pour les entretenir et les sauvegarder (Latouche, 2012, p. 132). Si lãutilisateur retrouve du sens dans dãautres choses que la nouveautûˋ du produit, la qualitûˋ et durabilitûˋ de celui-ci regagnera en importance. On observe dûˋjû des dûˋveloppements allant dans ce sensô : des ô¨ô repair-cafûˋsô ô£ collectifs permettent aux utilisateurs soucieux de prolonger la durûˋe de vie de leur appareil dãavoir recours aux outils de rûˋparation et û la compûˋtence technique de volontaires.ô Malheureusement, le nombre dãutilisateurs qui se rendent û un repair-cafûˋ avec leurs smartphones cassûˋs reste minoritaire par rapport û ceux qui profitent de lãoccasion pour se procurer le dernier modû´le.
La dûˋmocratisation des choix techniques
ô¨ô La dûˋmocratie nãest pas un mode de gouvernement ou une forme dãEtat, elle nãest pas non plus la limitation du pouvoir par le droit, garantie par les droits de participation minimum que sont le droit de vote et lãûˋligibilitûˋ. La rûˋalitûˋ de la dûˋmocratie nãest pas dans la gestion (…), mais dans la mise en question continue de celle-ci.ô ô£ (Colliot-Thûˋlû´ne, ô¨ô Pour une politique des droits subjectifs : la lutte pour les droits comme lutte politiqueô ô£, 2009)
Une fois les techniques libûˋrûˋes du cadre de rûˋflexion ûˋtroit de la technophilie ou de la technophobie, on peut enfin les considûˋrer enfin comme des membres û part entiû´re du monde collectif que nous construisons continuellement. Mais comment faire en sorte que les techniques sûˋlectionnûˋes aient des consûˋquences bûˋnûˋfiques pour lãensemble de la sociûˋtûˋô ? Comment assurer que le processus de sûˋlection se dûˋroule de maniû´re dûˋmocratiqueô ?
Dãaprû´s Callon (2001) la dûˋmocratisation des choix techniques ne peut se mettre en pratique quãû condition de la mise en éuvre dãun certain nombre de formalitûˋs. Premiû´rement, tous ceux qui sont concernûˋs par les consûˋquences de telle ou telle innovation technique, dûˋveloppeurs, experts, entreprises, politiques, citoyens, utilisateurs, etc., devraient ûˆtre entendus avant que la dûˋcision soit prise. Des ô¨ô porte-parolesô ô£ devraient ûˆtre accordûˋs aux participants sans voix (les non-humains, comme lãenvironnement, pourraient par exemple ûˆtre reprûˋsentûˋs par des ONG). Deuxiû´mement, des procûˋdures strictes devraient ûˋviter que plus de poids soit accordûˋ aux voix les plus puissantes. La dûˋcision, finalement, ne devrait jamais ûˆtre dûˋfinitive et devrait toujours rester ouverte û de nouvelles informations, contestations ou formulations dãenjeu.
Callon appelle les espaces oû¿ ces dûˋbats politiques pourraient avoir lieu des ô¨ô forums hybridesô ô£. Quelle forme ô concrû´te un tel espace pourrait-il prendre ?
La conception participative
Les nouvelles technologies de production sont souvent perûÏues comme centralisûˋes, antidûˋmocratiques et aliûˋnantes par les travailleurs. Noble (1995) dûˋtecte plusieurs raisons û cela. Premiû´rement, les techniciens qui dûˋveloppent de telles technologies sont rarement en contact direct avec les travailleurs, ils communiquent uniquement avec les managers, dont ils dûˋpendent pour leur financement. Ces derniers, dãaprû´s Noble, choisiront toujours les options qui les aideront û rester en poste, car ils considû´rent que pour rendre la production la plus efficace possible, il faut la contrûÇler au maximum. Les technologies qui lãemportent sont donc celles qui maintiennent les relations existantes de pouvoir et laissent peu de possibilitûˋs dãintervention aux travailleurs.
Deuxiû´mement, ces techniciens, poussûˋs par ce que Noble appelle une fascination pour ces systû´mes mûˋcaniques en eux-mûˆmes, cherchent û perfectionner ces machines et û limiter le plus possible la possibilitûˋ de lãerreur humaine. Les meilleures machines sont donc celles qui sont ô¨ô idiot-proof ô£ (manipulables mûˆme par des imbûˋciles) (Noble, 1995, p. 80). Il est ûˋvident que ce genre de systû´mes ne laisse pas beaucoup de place û la crûˋativitûˋ de ceux qui les manipulent.
La conception participative a historiquement ûˋmergûˋ au croisement de deux objectifs. Premiû´rement, amûˋliorer la performance et le succû´s commercial des nouvelles technologies en impliquant lãutilisateur final dans leur processus de conception. Cãest lãapproche du Joint Application Design pratiquûˋ par IBM dû´s 1977 (Asaro, 2000). Cet objectif relû´ve du rationalisme technologique et ne comporte pas de regard critique vis-û -vis des techniques ou leurs consûˋquences. Le deuxiû´me objectif sãinscrit dans la tradition europûˋenne et cherche û rectifier des dûˋsûˋquilibres politiques causûˋs par des technologies sur le lieu de travail. On reconnaûÛt que les technologies ne sont pas neutres mais peuvent ûˆtre porteuses de valeurs qui peuvent servir plus ou moins bien les intûˋrûˆts des travailleurs. A lãorigine, le mouvement avait un fort ancrage dans la tradition syndicaliste scandinave. Plus tard, des entreprises comme Xerox se sont inspirûˋes des procûˋdures inventûˋes en Europe (Asaro, 2000, p. 261).
Dans cette approche, il sãagit dãimpliquer lãutilisateur final dans une phase prûˋcoce de dûˋveloppement dãune nouvelle technologie. Au lieu de dûˋvelopper une technique (objet) par des ingûˋnieurs qui sont censûˋs rûˋpondre û des attentes des utilisateurs (sujets), la conception participative cherche û construire un pont entre deux domaines diffûˋrents de reprûˋsentations et de pratiques, celui des ingûˋnieurs et celui des utilisateurs. En revanche, quãil sãagisse de dûˋmocratiser le lieu de travail ou de concevoir des produits qui rûˋpondent mieux aux besoins des utilisateurs et rencontreront probablement un meilleur succû´s commercial, le mûˆme problû´me semble toujours revenirô : la difficultûˋ de trouver un langage commun entre ingûˋnieurs et utilisateurs. Comme dans tout forum hybride, il sãagit ici aussi de dûˋpasser la frontiû´re entre experts et profanes. Ensuite, une fois les besoins des utilisateurs plus ou moins correctement reprûˋsentûˋs, des conflits peuvent survenir entre les valeurs dûˋmocratiques que ceux-ci souhaitent voir reflûˋtûˋs par la technologie et les objectifs de contrûÇle et dãefficacitûˋ des managers.
Bien quãil sãagisse ici dãune tentative louable de dûˋmocratisation des techniques û lãintûˋrieur des entreprises, il y a des limites û ce type dãexpûˋrimentations. En effet, certains auteurs considû´rent ces tentatives de proposer un cadre pour dûˋmocratiser les choix techniques ô¨ô par le hautô ô£ comme un moyen de faire taire les contestations et les formes de participation ô¨ô par le basô ô£ (Jarrige, 2014, p. 317). Lãhistorien David Noble par exemple a peu de confiance dans la capacitûˋ de telles initiatives de donner vûˋritablement une voix aux travailleurs dans les processus de conception des nouvelles technologies. Pour lui, la codûˋcision et la participation formelle ont pour rûˋsultat dãûˋloigner les questions techniques hors de la portûˋe directe des travailleurs. La formalisation rendrait les discussions autour des questions techniques de plus en plus abstraites et tournûˋes vers lãavenir, ûˋliminant ainsi la possibilitûˋ de lãaction directe (Noble, 1995, p. 32-33). PlutûÇt que de se contenter de la nûˋgociation post hoc, rûˋgie par les rapports de pouvoir ûˋmanant de la hiûˋrarchie dans lãentreprise, il appelle û lãaffrontement direct. Pour lui, les dispositifs de participation des travailleurs dans lãorientation des choix techniques donnent juste lãapparence dãune dûˋmocratisation sans que les prûˋfûˋrences des travailleurs soient rûˋellement prises en compte. Il met en avant des exemples des annûˋes 80 en Norvû´ge et au Danemark de ce quãil appelle ô¨ô lãaction directeô ô£ des travailleurs pour appuyer leurs revendications lorsquãils avaient le sentiment que les modes de participation formels ne leur donnaient pas assez de pouvoir. Selon Noble, la participation, si elle veut ûˆtre effective, doit sãaccompagner de la rûˋbellion. Or, il reconnaûÛt aussi quãil ne suffit pas de se lancer dans des manifestations de protestation sans avoir des objectifs et des visions û long terme (Noble, 1995, p. 48).
Pour lãassociation Piû´ces et Main dãéuvre, groupe grenoblois qui lutte contre la technicisation de la sociûˋtûˋ en gûˋnûˋral et les nanotechnologies en particulier, les expûˋriences comme la conception participative ont pour but dãaccompagner et de faire accepter le progrû´s perûÏu comme inûˋvitable, et non de remettre en question le bien-fondûˋ de lãaccûˋlûˋration des innovations. Pour ce groupe de contestation, le but de la conception participative est de faire participer pour faire accepter : ô¨ô qui accepte de participer û la gestion durable de sa propre dûˋgradation participe du mûˆme coup û lãacceptation de cette dûˋgradation dont il renonce û combattre le principeô ô£ (Piû´ces et Main dãéuvre, 2012, p. 83).
La contestation pure et simple qui sãaccompagne dãun refus de coopûˋration nãest pas en phase avec les principes de la dûˋmocratisation des choix techniques; la critique soulevûˋe par les auteurs citûˋs ci-dessus ne mû´ne donc pas û lãabandon de la conception participative comme possible exemple de forum hybride. Un autre point important mûˋrite toutefois dãûˆtre soulignûˋ. La conception participative a gûˋnûˋralement lieu û lãintûˋrieur des entreprises. Or, comme le soulignent Rambaud et Ornaf (2012), les forums hybrides impliquant des entreprises ont plus dãeffet quand ils sont situûˋs en dehors de celles-ci. Si leur enjeu est une nûˋgociation ontologique, le changement des identitûˋs en fonction des relations avec dãautres acteurs aura des difficultûˋs û se rûˋaliser si la nûˋgociation a lieu û lãintûˋrieur de la sphû´re dãinfluence de lãun des participants. Comme le montre ûˋgalement Noble, ce type de dialogues a tendance û sãorienter en fonction des relations de pouvoir existantes dans lãentreprise et les rûˋsultats seront par consûˋquent rarement contraires aux intûˋrûˆts de ceux en position de pouvoir (Noble, 1995).
La confûˋrence citoyenne
La confûˋrence citoyenne (initialement connue sous le terme ô¨ô confûˋrence de consensusô ô£) est une forme de technology assessment (TA) inventûˋe au Danemark en 1987. Il sãagit dãorganiser des ûˋvûˋnements dûˋdiûˋs û tel ou tel dossier sociotechnique, oû¿ les citoyens sont impliquûˋs explicitement dans les choix qui structurent le monde commun. Dãaprû´s Hennen (1999), le TA en gûˋnûˋral et la confûˋrence citoyenne en particulier seraient une rûˋponse û la crise de la forme classique de la sociûˋtûˋ moderne et sa dûˋpendance û la science et la technologie. Avec la croissance de la complexitûˋ des systû´mes technologiques, les consûˋquences ûˋventuelles sont plus complexes et le potentiel du risque sãagrandit. La science, basûˋe sur une vision rûˋduite du monde et fragmentûˋe en disciplines distinctes, nãest pas capable de prûˋvoir les consûˋquences de son interfûˋrence dans lãenvironnement. La confûˋrence citoyenne, qui implique les jugements de valeur des citoyens dans les procûˋdures de consultation, veut donner plus de matiû´re û la dûˋcision politique quant aux conditions socio-ûˋconomiques et quant aux ûˋventuels impacts sociaux, ûˋconomiques et environnementaux de lãintroduction de nouvelles technologies.
Plusieurs expûˋriences ont dûˋjû ûˋtûˋ rûˋalisûˋes ces derniû´res annûˋes en Europe et aux Etats-Unis (voir par exemple Laurent, 2010 pour une ûˋtude approfondie des ô¨ô techniques de dûˋmocratisationô ô£ appliquûˋs aux nanotechnologies, ou encore Levidow, 2010, pour un examen des manifestations organisûˋes par lãUnion europûˋenne sur les OGM). La ô¨ô rûˋussiteô ô£ de ces expûˋriences dûˋpend en grande partie de ce que Callon et al. (2001) appellent ô¨ô le degrûˋ de dialogismeô ô£. Le dialogisme des confûˋrences citoyennes se mesure par un certain nombre de critû´resô :
- Sources indûˋpendantes de financementô ;
- Ouverture des dûˋcisions possibles, y compris le rejet pur et simple de la technologieô ;
- Examen des alternatives, y compris lorsque celles-ci sãaccordent moins avec les intûˋrûˆts des groupes dominantsô ;
- Lien sûˋrieux avec la prise de dûˋcisionô politiqueô ;
- Participation active et prûˋcoce des profanesô ;
- Reprûˋsentativitûˋ des porte-parolesô ;
- Transparence et traûÏabilitûˋ des procûˋduresô ;
- Possibilitûˋ de poursuivre les dûˋbats dans lãespace public.
Lorsquãelle remplit ces critû´res, la confûˋrence citoyenne peut, û condition dãûˆtre rûˋpûˋtûˋe, constituer un outil puissant pour constater lãûˋmergence de nouvelles identitûˋs et de nouvelles demandes, et pour les faire prendre en considûˋration dans le dûˋbat public (Callon et al., 2001 p. 251).
De nombreuses critiques ont pourtant ûˋtûˋ formulûˋes û lãûˋgard de la dûˋmocratie technique thûˋorisûˋe par Callon et al. Les procûˋdures auraient pour objectif de lûˋgitimer des choix dûˋjû pris en avance, dã ô¨ô ûˋduquer le publicô ô£, de gûˋrer les conflits sociaux et finalement de faire taire la rûˋbellion en lãinstitutionnalisant.
Ainsi, lãhistorien FranûÏois Jarrige, dans une ouvrage de synthû´se sur lãhistoire des technocritiques, remarque û propos de la dûˋmocratie technique que la recherche de consensus par la discussion, censûˋe diluer les oppositions, relû´ve dãune critique molle et vise surtout û concilier la contestation avec le marchûˋ, lãentreprise et lãimpûˋratif de la croissance industrielle (Jarrige, 2014, p. 319). Mais il oublie lãattention que Callon accorde, dans sa prûˋface, û une remarque de Sheila Jasanoff û lãoccasion dãun symposium publique sur les conclusions de la premiû´re confûˋrence citoyenne sur la thûˋrapie gûˋnique organisûˋe au Japon en 1999 : ô¨ô Se donner comme objectif dãatteindre un consensus tiû´de est le plus mauvais objectif qui soit dans nos sociûˋtûˋs compliquûˋes. Lãaccord sãobtient souvent au dûˋtriment des opposants ou des rûˋcalcitrants qui nãont pas pu sãexprimer ou que lãon a fait taire. Et puis, lãaccord obtenu û un moment donnûˋ peut trû´s bien ne plus ûˆtre valable un peu plus tard quand les circonstances ont changûˋ. Lãaccord nãest que rarement dûˋsirable !ô ô£ (Jasanoff citûˋe par Callon et al., 2001, p. 15 – 16).
Lãenjeu des forums hybrides, lorsquãils sont correctement organisûˋs, nãest pas de chercher la conciliation au dûˋtriment des critiques. Cãest pourquoi il est prûˋfûˋrable dãemployer, au lieu du terme initial de ô¨ô confûˋrence de consensusô ô£, le terme franûÏais de ô¨ô confûˋrence citoyenneô ô£. Lãobjectif nãest en effet pas dãobtenir un accord au plus vite mais plutûÇt dãintroduire un moment dãhûˋsitation, dãûˋcoute de tous ceux qui rûˋclament la parole sur le sujet, de veiller û lãûˋgalitûˋ de rûˋpartition de cette parole, indûˋpendamment de la puissance des acteurs, et dãarriver finalement û des mesures politiques susceptibles de rûˋpondre avec suffisamment de fermetûˋ aux enjeux dãaujourdãhui, mais jamais dûˋfinitives et toujours ouvertes û la rûˋvision en fonction de nouveaux enjeux qui se prûˋsenteront peut-ûˆtre demain.
En alternative aux procûˋdures organisûˋes des forums hybrides, certains groupes prûˋfû´rent la confrontation directe sous la forme de manifestations, de grû´ves, voire de sabotage, ou encore de lãexploration dãalternatives ô¨ô par le basô ô£ : la recherche de technologies ô¨ô convivialesô ô£ (Illich, 1973) ou le rejet de certaines technologies : le mouvement slow, les villes en transition, lãagriculture biologique et locale, etc. Certains auteurs soulignent ainsi que ces formes ô¨ô spontanûˋesô ô£ de participation du public permettent – plus que les consultations organisûˋes – de laisser ouvert lãûˋventail de choix de futurs technologiques possibles (Levidow citûˋ par Bertrand, 2014, p. 8).
Lãexistence de forums hybrides nãimplique pas la disparition des groupes militants contestataires de la technique, comme lãassociation Piû´ces et Main dãéuvre dûˋjû mentionnûˋe. Lãobjectif de ce genre de groupes nãest souvent pas dãinstaurer un mouvement social ou de prendre des dûˋcisions face aux situations incertaines. Il est plutûÇt de provoquer un dûˋbat et de dûˋconstruire les mythes sur les liens inexorables entre progrû´s, innovation et compûˋtitivitûˋ. Ces groupes contestataires peuvent alors parfaitement coexister avec les forums hybrides. Leurs activitûˋs ne peuvent ûˆtre que bûˋnûˋfiques û la dûˋmocratisation des techniques. Celle-ci ne saurait ûˆtre limitûˋe aux seules procûˋdures ô¨ô officiellesô ô£, mais doit continuellement ûˆtre reformulûˋe en fonction des contestations et des critiques. Les rûˋsistances et protestations peuvent alors ûˆtre considûˋrûˋes comme le pûÇle le plus radical des critiques, indispensable au dûˋbat autour des arrangements sociotechniques dont on voudrait quãelles faûÏonnent le monde commun. Mais ce nãest pas assez, car ô¨ô le changement social nûˋcessite plus que des campagnes militantes et des mouvements protestataires (…), il nûˋcessite lãarticulation idûˋologique cohûˋrenteô ô£ (Castoriadis, 1998, citûˋ par Rambaud et Richard, 2013).
Si les expûˋriences dûˋcrites ici sont loin dãûˆtre des solutions parfaites et que de nombreuses critiques persistent, elles sont certainement porteuses dãun potentiel important pour la dûˋmocratisation du progrû´s technique et mûˋritent dãûˆtre dûˋveloppûˋes et amûˋliorûˋs.
En guise de conclusion, il ne reste quãû mentionner quelques limites û ces formes possibles de dûˋmocratisation de la technique. Premiû´rement, le complûˋment û la dûˋmocratie reprûˋsentative quãil est proposûˋ de crûˋer sous la forme de forums hybrides est susceptible de souffrir des mûˆmes problû´mes qui perturbent actuellement le bon fonctionnement des instances dûˋmocratiques existantesô : corruption, conflits dãintûˋrûˆts, domination des acteurs les plus puissants, etc. Afin de limiter ce risque, il faudrait veiller rigoureusement û ce que les procûˋdures rûˋpartissent le droit û la parole de maniû´re ûˋgale entre les participants.
Deuxiû´mement, lãorganisation des forums hybrides ne brise pas le lien qui existe entre progrû´s technique et profit financier, cause majeure de la perversion du rapport entre entreprise et innovations. Ceci empûˆche ûˋgalement que les entreprises participent de maniû´re volontaire û ce genre de procûˋdures. En effet, si une entreprise seule met en place un moment d’hûˋsitation avant de dûˋvelopper de nouvelles technologies ou de participer aux forums hybrides, dans le systû´me capitaliste actuel, elle sera dans une situation dûˋfavorable vis-û -vis de ses concurrents qui ne seraient pas ô¨ô contraintsô ô£ par de telles procûˋdures et pourraient aller plus vite. Pour que le modû´le de dûˋmocratie technique tel quãil a ûˋtûˋ dûˋcrit ici puisse fonctionner vûˋritablement, il faudrait probablement sortir du modû´le ûˋconomique basûˋ sur le capitalisme et la concurrence.
Finalement et plus fondamentalement, la dûˋmocratie technique telle quãelle est dûˋcrite ici ne rûˋsout pas le problû´me de la nature humaine, qui a du mal û prendre en compte le long terme alors que les consûˋquences de son comportement sãûˋtalent dans le temps. Il nãy a malheureusement pas de solution miracle û ce problû´me, mais le dûˋcouplage entre le profit financier et le progrû´s technique dans un systû´me post-capitaliste aiderait sans doute û favoriser la prise de recul face aux innovations techniques et contribuerait ainsi û les remettre au service de la crûˋation du monde commun.
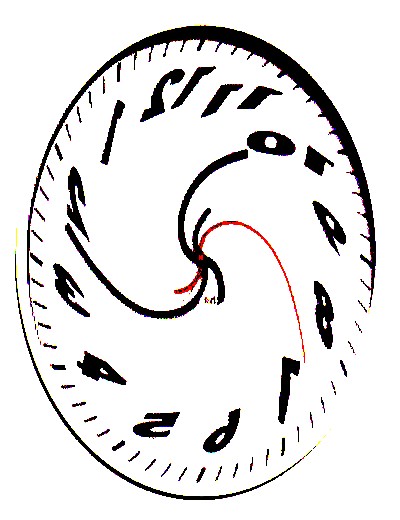

 mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-
mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-