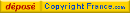Nicolas STENGER
 Sur les rapports personnels quﻗont entretenus Denis de Rougemont (1906-1985) et Jean-Paul Sartre (1905-1980), on sait ﺣ vrai dire relativement peu de choses, sinon que les deux hommes sﻗﺣ۸taient rencontrﺣ۸s ﺣ plusieurs reprises en 1939, aprﺣ۷s que Sartre fit la critique de LﻗAmour et lﻗOccident, le maﺣ؟tre-livre de Rougemont, dans la revue Europe [1]. Mais il ne sﻗagissait que dﻗune ﺡ، amitiﺣ۸ parisienne [2] ﺡﭨ, sans contacts rﺣ۸guliers, vite interrompue par la guerre. Ils se retrouvﺣ۷rent aux ﺣtats-Unis ﺣ la fin du conflit, quand Sartre y fit une tournﺣ۸e de confﺣ۸rences, Rougemont ﻗ qui sﻗﺣ۸tait alors exilﺣ۸ outre-Atlantique ﻗ lﻗintroduisant dans certains cercles intellectuels new-yorkais [3]. Mais ces amitiﺣ۸s, quﻗelles fussent parisiennes ou new-yorkaises, ne rﺣ۸sistﺣ۷rent pas longtemps ﺣ lﻗﺣ۸volution du climat intellectuel et politique au dﺣ۸but des annﺣ۸es 1950. Qui plus est, lﻗengagement pour lﻗunion fﺣ۸dﺣ۸rale, qui dﺣ۸finit lﻗidentitﺣ۸ et le parcours de Rougemont aprﺣ۷s la guerre, nﻗest pas un terrain sur lequel on puisse le confronter ﺣ Sartre, les prises de position du philosophe en la matiﺣ۷re ﺣ۸tant quasi inexistantes. Trﺣ۷s peu de commentaires chez lui sur les pﺣ۸ripﺣ۸ties de la construction europﺣ۸enne : lﻗHistoire se jouait ailleurs. En ﺣ۸tﺣ۸ 1954, par exemple, quand la bataille faisait rage au parlement franﺣ۶ais sur la ratification de la Communautﺣ۸ europﺣ۸enne de dﺣ۸fense, Sartre rapportait les impressions de son voyage en URSS, tﺣ۸moignant pour Libﺣ۸ration que ﺡ، la libertﺣ۸ de critique est totale [4] ﺡﭨ. Il est pourtant un thﺣ۷me oﺣﺗ la comparaison entre Rougemont et Sartre se rﺣ۸vﺣ۷le riche dﻗenseignements : cﻗest celui de lﻗengagement. Largement popularisﺣ۸e aprﺣ۷s 1945 sous lﻗinfluence de Sartre justement, la notion dﻗengagement avait ﺣ۸tﺣ۸ nﺣ۸anmoins formulﺣ۸e dﻗune maniﺣ۷re prﺣ۸cise dans les annﺣ۸es 1930, entre autres par Denis de Rougemont. Ce dernier sﻗest dﻗailleurs souvent agacﺣ۸ de ce quﻗil considﺣ۸rait comme une rﺣ۸cupﺣ۸ration par Sartre de son vocabulaire, en mﺣ۹me temps quﻗil ﺣ۸tait vidﺣ۸ de son sens initial. Au-delﺣ de cette querelle de prﺣ۸sﺣ۸ance, qui prﺣ۸sente peu dﻗintﺣ۸rﺣ۹t en soi, sinon dans la mesure oﺣﺗ elle tﺣ۸moigne de la centralitﺣ۸ de Sartre dans le dﺣ۸bat intellectuel, il est utile de sﻗinterroger sur les conceptions respectives de lﻗengagement dﺣ۸veloppﺣ۸es par les deux ﺣ۸crivains, car elles dﺣ۸terminent des rapports spﺣ۸cifiques au monde et ﺣ la littﺣ۸rature.
Sur les rapports personnels quﻗont entretenus Denis de Rougemont (1906-1985) et Jean-Paul Sartre (1905-1980), on sait ﺣ vrai dire relativement peu de choses, sinon que les deux hommes sﻗﺣ۸taient rencontrﺣ۸s ﺣ plusieurs reprises en 1939, aprﺣ۷s que Sartre fit la critique de LﻗAmour et lﻗOccident, le maﺣ؟tre-livre de Rougemont, dans la revue Europe [1]. Mais il ne sﻗagissait que dﻗune ﺡ، amitiﺣ۸ parisienne [2] ﺡﭨ, sans contacts rﺣ۸guliers, vite interrompue par la guerre. Ils se retrouvﺣ۷rent aux ﺣtats-Unis ﺣ la fin du conflit, quand Sartre y fit une tournﺣ۸e de confﺣ۸rences, Rougemont ﻗ qui sﻗﺣ۸tait alors exilﺣ۸ outre-Atlantique ﻗ lﻗintroduisant dans certains cercles intellectuels new-yorkais [3]. Mais ces amitiﺣ۸s, quﻗelles fussent parisiennes ou new-yorkaises, ne rﺣ۸sistﺣ۷rent pas longtemps ﺣ lﻗﺣ۸volution du climat intellectuel et politique au dﺣ۸but des annﺣ۸es 1950. Qui plus est, lﻗengagement pour lﻗunion fﺣ۸dﺣ۸rale, qui dﺣ۸finit lﻗidentitﺣ۸ et le parcours de Rougemont aprﺣ۷s la guerre, nﻗest pas un terrain sur lequel on puisse le confronter ﺣ Sartre, les prises de position du philosophe en la matiﺣ۷re ﺣ۸tant quasi inexistantes. Trﺣ۷s peu de commentaires chez lui sur les pﺣ۸ripﺣ۸ties de la construction europﺣ۸enne : lﻗHistoire se jouait ailleurs. En ﺣ۸tﺣ۸ 1954, par exemple, quand la bataille faisait rage au parlement franﺣ۶ais sur la ratification de la Communautﺣ۸ europﺣ۸enne de dﺣ۸fense, Sartre rapportait les impressions de son voyage en URSS, tﺣ۸moignant pour Libﺣ۸ration que ﺡ، la libertﺣ۸ de critique est totale [4] ﺡﭨ. Il est pourtant un thﺣ۷me oﺣﺗ la comparaison entre Rougemont et Sartre se rﺣ۸vﺣ۷le riche dﻗenseignements : cﻗest celui de lﻗengagement. Largement popularisﺣ۸e aprﺣ۷s 1945 sous lﻗinfluence de Sartre justement, la notion dﻗengagement avait ﺣ۸tﺣ۸ nﺣ۸anmoins formulﺣ۸e dﻗune maniﺣ۷re prﺣ۸cise dans les annﺣ۸es 1930, entre autres par Denis de Rougemont. Ce dernier sﻗest dﻗailleurs souvent agacﺣ۸ de ce quﻗil considﺣ۸rait comme une rﺣ۸cupﺣ۸ration par Sartre de son vocabulaire, en mﺣ۹me temps quﻗil ﺣ۸tait vidﺣ۸ de son sens initial. Au-delﺣ de cette querelle de prﺣ۸sﺣ۸ance, qui prﺣ۸sente peu dﻗintﺣ۸rﺣ۹t en soi, sinon dans la mesure oﺣﺗ elle tﺣ۸moigne de la centralitﺣ۸ de Sartre dans le dﺣ۸bat intellectuel, il est utile de sﻗinterroger sur les conceptions respectives de lﻗengagement dﺣ۸veloppﺣ۸es par les deux ﺣ۸crivains, car elles dﺣ۸terminent des rapports spﺣ۸cifiques au monde et ﺣ la littﺣ۸rature.
A. Lﻗengagement personnaliste
Au cours des annﺣ۸es trente, les gloses sﻗaccumulﺣ۷rent en France autour des ﺣ۸crits de Julien Benda, qui soutenait que la seule ﺧuvre digne de lﻗintellectuel ﺣ۸tait ﻗ sauf ﺣ trahir sa fonction ﻗ celle de ﺡ، dﺣ۸fendre les valeurs ﺣ۸ternelles et dﺣ۸sintﺣ۸ressﺣ۸es comme la justice et la raison [5] ﺡﭨ, sans se mﺣ۹ler de prendre position dans les dﺣ۸bats de son temps. Benda souhaitait prﺣ۸server lﻗintﺣ۸gritﺣ۸ de lﻗactivitﺣ۸ du penseur, quﻗil inscrivait dans la tradition des ﺡ، grands patriciens de lﻗEsprit ﺡﭨ, ﺣrasme, Malebranche, Spinozaﻗ۵ : cette activitﺣ۸ ﺣ۸tait pour lui essentiellement spﺣ۸culative. Au nom dﻗun ﺡ، opportunisme de la vﺣ۸ritﺣ۸ ﺡﭨ, Denis de Rougemont affirmait au contraire que toute pensﺣ۸e nﻗest valable quﻗﺣ partir du moment oﺣﺗ elle quitte le domaine des ﺡ، idﺣ۸es pures ﺡﭨ pour ﺣ۸pouser le rﺣ۸el, ﺣ partir du moment oﺣﺗ elle est engagﺣ۸e, ou encore ﺡ، incarnﺣ۸e ﺡﭨ. Le concept dﻗengagement procﺣ۸dait, comme en dﻗautres domaines de la pensﺣ۸e de Rougemont, de sa foi chrﺣ۸tienne (dominﺣ۸e par les figures de Sﺣﺕren Kierkegaard [6] et de Karl Barth [7]), de sa dﺣ۸finition de la personne humaine, laquelle est ﺣ la fois ﺡ، libre et responsable ﺡﭨ. Pour Benda, la pensﺣ۸e et lﻗaction ﺣ۸taient par dﺣ۸finition irrﺣ۸conciliables ; pour Rougemont, cette hypothﺣ۷se se rﺣ۸sumait ﺣ un sophisme qui ﺡ، consiste ﺣ enfermer les intellectuels dans le dilemme : pensﺣ۸e pure ou pensﺣ۸e asservie ﺣ lﻗaction, carence ou simonie, M. Benda ou Barrﺣ۷s. La jeunesse personnaliste repousse lﻗune et lﻗautre de ces trahisons, et affirme que la pensﺣ۸e doit entrer dans lﻗaction, non pas ﺣ son service, mais au service de la vﺣ۸ritﺣ۸. Le mot dﻗincarnation rﺣ۸sume cette position [8] ﺡﭨ. Benda rﺣ۸pondit ﺣ Rougemont en ces termes :
ﺡ، Voilﺣ notre opposition : au fond, elle revient ﺣ ce que jﻗhonore le verbe en dehors de son incarnation, suis ﺣ۸lﺣ۷ve de cette thﺣ۸ologie [ﻗ۵] qui dﺣ۸clare que lﻗincarnation ne fait pas partie essentielle du verbe, nﻗen est quﻗune condescendance, tandis que vous honorez uniquement le verbe incarnﺣ۸ (dﻗoﺣﺗ penser avec les mains [9]). Et il est entendu que toute pensﺣ۸e est incarnﺣ۸e, mais moi je le dﺣ۸plore et tends ﺣ en amoindrir autant que possible lﻗeffet, tandis que vous le respectez et ne songez nullement ﺣ le combattre au contraire. Notre opposition est de lﻗordre des prﺣ۸fﺣ۸rences mﺣ۸taphysiques, nullement des choses quﻗon peut dﺣ۸partager par lﻗexpﺣ۸rience. Cﻗest dire quﻗelle est irrﺣ۸ductible [10]. ﺡﭨ
Face ﺣ cette condamnation a priori de lﻗexistence mﺣ۹me de lﻗidﺣ۸e dﻗengagement, Rougemont et les personnalistes rﺣ۸affirmaient au contraire leur volontﺣ۸ dﻗancrer au maximum la rﺣ۸flexion intellectuelle dans les enjeux de lﻗﺣ۸poque. Dotﺣ۸e dﻗune forte conscience de soi, cette gﺣ۸nﺣ۸ration nﺣ۸e au dﺣ۸but du siﺣ۷cle sﻗopposait au ﺡ، camp des purs ﺡﭨ, aux philosophes ﺡ، idﺣ۸alistes ﺡﭨ, ﺣ lﻗimage de Lﺣ۸on Brunschvicg qui rﺣ۸gnait alors sur la Sorbonne (ce ﺡ، trﺣ۷s bourgeois, trﺣ۷s assis [11] ﺡﭨ selon Mounier), auxquels elle reprochait de faillir ﺣ lﻗune de leurs missions constitutives : car loin dﻗﺣ۹tre uniquement lﻗﺡ، effort pour ﺣ۸chapper ﺣ lﻗHistoire et au monde [12] ﺡﭨ, la philosophie devait ﺣ۹tre ﺣ۸galement une rﺣ۸flexion active, gﺣ۸nﺣ۸ratrice de solutions, sur la sociﺣ۸tﺣ۸ et la politique, leurs fondements et leurs pratiques.
Parmi les personnalistes, Rougemont ﺣ۸tait lﻗun des plus ardents dﺣ۸fenseurs de cette dialectique pensﺣ۸e-action. ﺣ lﻗorigine pourtant, cette posture nﻗallait pas de soi. Dans certains milieux oﺣﺗ ﺣ۸voluait le jeune ﺣ۸crivain, comme la Nouvelle Revue franﺣ۶aise de Jean Paulhan, une tradition de dﺣ۸gagement prﺣ۸valait : sﻗengager, cﻗﺣ۸tait entrer dans un domaine ﺣ۸tranger ﺣ son activitﺣ۸. La rﺣ۸flexion sur la politique nﻗﺣ۸tait pas ﺣ۸vidente pour celui ou celle qui ﺣ lﻗorigine vouait sa plume ﺣ lﻗanalyse du sentiment amoureux, de la culpabilitﺣ۸ et du regret, ou ﺣ nﻗimporte quel autre thﺣ۷me dﺣ۸tachﺣ۸ de la rumeur quotidienne de la politique et des actualitﺣ۸s. Ainsi, pour Rougemont lﻗﺣ۸crivain, il y eut tout dﻗabord ﺡ، empiﺣ۷tement ﺡﭨ, et sﻗengager, cﻗﺣ۸tait sortir de sa condition. Voici comment sﻗouvrait en 1934 le premier chapitre de Politique de la personne :
ﺡ، Jﻗai, pour la politique, une espﺣ۷ce dﻗaversion naturelle. [ﻗ۵] On se demande alors de quoi je me mﺣ۹le. Je rﺣ۸ponds que je voudrais bien nﻗavoir jamais ﺣ۸tﺣ۸ forcﺣ۸ de mﻗen mﺣ۹ler. Mais tel est le malheur des temps : pour peu que lﻗintellectuel dﻗaujourdﻗhui ait prﺣ۸servﺣ۸ en lui un pouvoir de colﺣ۷re, et par ailleurs le besoin de penser, il se voit obligﺣ۸ de rﺣ۸pondre activement aux empiﺣ۸tements dans son domaine de ce quﻗon a nommﺣ۸ le dﺣ۸sordre ﺣ۸tabli [13]. ﺡﭨ
Si Rougemont faisait de la politique, cﻗﺣ۸tait ﺡ، pour quﻗon nﻗen fasse plus, ou plutﺣﺑt pour quﻗun jour des hommes comme moi qui nﻗont le goﺣﭨt ni des habiletﺣ۸s ni des contraintes quﻗil y faut, puissent quitter ce combat mauvais, et porter ailleurs leur violence ﺡﭨ. Rougemont manifesta ﺣ plusieurs reprises la crainte que ﺡ، lﻗintelligence ﺡﭨ, dﺣ۸passant son dﺣ۸goﺣﭨt des affaires publiques, ne se dﺣ۸gradﺣ۱t en acceptant le combat. Et pourtant, prﺣ۸cisait-il, ﺡ، jﻗai prﺣ۸fﺣ۸rﺣ۸ ce risque ﺣ la politique de lﻗautruche, lﻗissue fﺣﭨt-elle dﺣ۸sespﺣ۸rﺣ۸e. Et peut-ﺣ۹tre ne lﻗest-elle pas [14] ﺡﭨ. Il ne faut pas surestimer cette aversion naturelle pour la politique, car la fonction de cet aveu est essentiellement rhﺣ۸torique. Il y avait, certes, un mﺣ۸pris pour les tactiques politiciennes, mais cﻗﺣ۸tait pour rﺣ۸affirmer immﺣ۸diatement aprﺣ۷s une attention particuliﺣ۷re aux problﺣ۷mes du temps, une volontﺣ۸ dﻗapprﺣ۸hender le rﺣ۸el et, surtout, le dﺣ۸sir de traduire, dﻗillustrer cette volontﺣ۸ par lﻗﺣ۸criture elle-mﺣ۹me. Cette prﺣ۸occupation ﺣ۸tait dﻗailleurs centrale dﺣ۷s les premiers textes de jeunesse. Voici une phrase typique, datﺣ۸e de 1926 : ﺡ، ﺣcrire, pas plus que vivre, nﻗest aujourdﻗhui un art dﻗagrﺣ۸ment [15]. ﺡﭨ Ou encore, quelques annﺣ۸es plus tard : ﺡ، Il sﻗagirait, au fond, dﻗamener la pensﺣ۸e ﺣ la plus insistante vﺣ۸nﺣ۸ration du rﺣ۸el [16]. ﺡﭨ Une telle conception du travail de lﻗﺣ۸crivain, opposﺣ۸e ﺣ lﻗidﺣ۸alisme prﺣ۸tendu de ses ainﺣ۸s, donnait invariablement ﺣ ses essais un ton tranchant, Rougemont prﺣ۸cisant par ailleurs que la littﺣ۸rature personnaliste serait ﺡ، franchement doctrinaire et polﺣ۸mique [17] ﺡﭨ. Ce choix de la polﺣ۸mique, rendu ﺣ ses yeux nﺣ۸cessaire par la crise globale que traversaient alors les sociﺣ۸tﺣ۸s europﺣ۸ennes, fait penser ﺣ une remarque de George Orwell, lorsque plus tard, celui-ci tenta ﺣ son tour de dﺣ۸finir son activitﺣ۸ dﻗﺣ۸crivain : ﺡ، En des temps paisibles, jﻗaurais pu ﺣ۸crire des livres fleuris ou purement descriptifs. [ﻗ۵] Mais en fait, par la force des choses, je suis devenu une sorte de pamphlﺣ۸taire [18]. ﺡﭨ
Privilﺣ۸gier la doctrine et la polﺣ۸mique ne signifiait nullement que le travail du style devait en pﺣ۱tir. Lﻗenjeu ﺣ۸tait autant ﺣ۸thique quﻗesthﺣ۸tique : ﺡ، Il nﻗest point de vﺣ۸ritﺣ۸ sans forme ﺡﭨ, affirmait Rougemont, car penser consiste ﺣ ﺡ، crﺣ۸er de tout son ﺣ۹tre spirituel des faits nouveaux et vrais, dans un certain style [19] ﺡﭨ. Dans Penser avec les mains, il dﺣ۸finissait ainsi un ﺡ، style nﺣ۸ de la seule passion de sﻗengager ﺡﭨ :
ﺡ، Que chaque phrase indique la volontﺣ۸ dﻗatteindre un but, dont la nature commande le choix des mots, le rythme, les figures. Que chaque phrase implique ce but, et le dﺣ۸signe par son allure mﺣ۹me. Que le style sﻗordonne ﺣ sa fin et non plus ﺣ de bons modﺣ۷les. Et quﻗil rappelle ﺣ la situation, au lieu de rappeler des sources. Que nos ﺣ۸crits figurent les microcosmes de cet ordre nouveau quﻗils revendiquent. Quﻗils illustrent, dans leur structure, visible ou secrﺣ۷te, la dialectique joyeuse de la personne en acte. Que celui qui sﻗengage dans leur lecture ﺣ۸prouve de tout son ﺣ۹tre la prﺣ۸sence dﻗune rﺣ۸alitﺣ۸ ﺣ۸thique immﺣ۸diate ﺣ chaque progrﺣ۷s du discours et quﻗil nﻗen sorte pas intact ! Ne rien ﺣ۸crire dﻗautre que ce qui pourrait dﺣ۸sespﺣ۸rer lﻗespﺣ۷ce dﻗhomme qui se hﺣ۱te, ﺣ۸crivait Nietzsche. Nous dirions : Ne rien ﺣ۸crire dﻗautre que ce qui pourrait dﺣ۸sespﺣ۸rer lﻗespﺣ۷ce dﻗhomme qui demande ﺣ la lecture une ﺣ۸vasion, un stupﺣ۸fiant, une justification du monde injuste, une occasion de refuser le premier pas dans lﻗimmﺣ۸diat [20]. ﺡﭨ
La vigueur de lﻗoffensive contre les idﺣ۸alistes, contre les ﺡ، petits-purs ﺡﭨ, nﻗest pleinement comprﺣ۸hensible que si lﻗon tient compte de la place quﻗoccupent ﺣ lﻗﺣ۸poque Rougemont et dﻗautres penseurs personnalistes comme Emmanuel Mounier ou Alexandre Marc, au sein du champ intellectuel. Alors que Sartre, par exemple, nﺣ۸ ﺣ Paris dans une famille bourgeoise, a suivi la voie royale (lycﺣ۸es Henri-IV et Louis-le-Grand, ﺣcole normale supﺣ۸rieure, agrﺣ۸gation de philosophie), les autres doivent marquer leur territoire afin de dﺣ۸passer leur statut de ﺡ، moins bien pourvus [21] ﺡﭨ, ﺣ la fois gﺣ۸ographiquement et socialement. Rougemont lutte contre un double provincialisme (Neuchﺣ۱tel et la Suisse) ; Mounier est dﻗorigine lyonnaise ; Marc a ﺣ۸tﺣ۸ forcﺣ۸ dﻗﺣ۸migrer de Russie pendant la Rﺣ۸volution. Tous les trois ont abandonnﺣ۸ le milieu acadﺣ۸mique : Rougemont nﻗa en poche quﻗune licence de Lettres ; Mounier a passﺣ۸ lﻗagrﺣ۸gation de philosophie, mais quittﺣ۸ rapidement lﻗenseignement ; Marc, dont le parcours est extrﺣ۹mement chaotique, travaille dans lﻗﺣ۸dition chez Hachette aprﺣ۷s des ﺣ۸tudes de droit et de sciences politiques, avant de dﺣ۸missionner sans que lﻗon sache trﺣ۷s bien comment il subvenait dﺣ۷s lors ﺣ ses besoins. Or il est significatif, au vu de ces parcours diffﺣ۸renciﺣ۸s, que Sartre ne soit pas encore ﺡ، engagﺣ۸ ﺡﭨ dans les annﺣ۸es trente, quand les autres agissent dﺣ۸jﺣ comme des ﺣ۸lectrons libres, tirant tous azimuts et ﺣ boulets rouges, sur les politiciens mais aussi sur un monde universitaire dont ils se sont dﺣ۸tachﺣ۸s, et dont ils dﺣ۸noncent la sclﺣ۸rose.
Pour Rougemont dﻗailleurs, ce nﻗﺣ۸tait pas seulement la politique ou la philosophie, mais la littﺣ۸rature dans son ensemble, de Gide aux surrﺣ۸alistes, qui faisait les frais dﻗune critique de ﺡ، lﻗacte gratuit [22] ﺡﭨ. La charge nﻗexclut pas la fascination vis-ﺣ -vis des avant-gardes dﻗune capitale parisienne qui reste ﺣ lﻗﺣ۸poque le pﺣﺑle de rﺣ۸fﺣ۸rence pour un jeune ﺣ۸crivain suisse romand. Quand Jean Paulhan, aiguillonnﺣ۸ par Roger Martin du Gard [23], contacta Rougemont en 1926 pour lui demander de collaborer avec la NRF [24], cﻗﺣ۸tait pour ce dernier comme une invitation au banquet des dieux ! Mﺣ۹me ses critiques contre les surrﺣ۸alistes montrent quﻗil partageait leur rﺣ۸volte, tout en dﺣ۸nonﺣ۶ant le caractﺣ۷re purement nﺣ۸gatif, voire ﺡ، irresponsable ﺡﭨ ﺣ ses yeux, de cette entreprise de ﺡ، dﺣ۸molition ﺡﭨ, alors quﻗil cherchait de son cﺣﺑtﺣ۸ ﺣ construire ﺡ، un monde nouveau [25] ﺡﭨ.
De fait, lﻗengagement personnaliste ﺣ۸tait conﺣ۶u comme un rappel permanent ﺣ la responsabilitﺣ۸, une maniﺣ۷re de se confronter au monde, tout en inventant de nouvelles formes institutionnelles et politiques, ﺡ، ﺣ hauteur dﻗhomme ﺡﭨ. Inventer : telle ﺣ۸tait la qualitﺣ۸ principale que le jeune Rougemont avait attribuﺣ۸ ﺣ lﻗutopiste dans son premier pamphlet, Les Mﺣ۸faits de lﻗinstruction publique, alors quﻗil ne se contentait encore, dans une joyeuse colﺣ۷re, que de ﺡ، vitupﺣ۸rer ﺡﭨ : ﺡ، Les sots vont rﺣ۸pﺣ۸tant que [lﻗutopiste] est un ﺣ۹tre qui ignore le rﺣ۸el. Cﻗest justement parce quﻗil le connaﺣ؟t mieux quﻗeux quﻗil y a vu des fissures et des possibilitﺣ۸s nouvelles. Tenir compte du rﺣ۸el ne signifie pas sﻗy soumettre sans combat. Lﻗutopiste est celui qui ne se rﺣ۸signe ﺣ aucun ﺣ۸tat de choses. Il est pour le mieux contre le bien [26]. ﺡﭨ Comme ailleurs chez Rougemont, le discours procﺣ۷de par exclusions et contrastes (le mieux contre le bien), prenant appui sur tout ce qui est perﺣ۶u comme une dﺣ۸viation, voire une compromission, face ﺣ lﻗﺣ۸lan vital de la personne et ﺣ lﻗurgence dﻗun travail en profondeur. Le thﺣ۷me de lﻗengagement sﻗintﺣ۷gre parfaitement dans cette logique. Alors quﻗil en appelait ﺣ une large refondation doctrinale, Rougemont critiquait ainsi les action ponctuelles, telles quﻗelles se manifestaient par exemple ﺣ travers les pﺣ۸titions, florissantes ﺣ lﻗﺣ۸poque, permettant selon lui aux ﺣ۸crivains de sﻗacheter une conscience sans sﻗengager vﺣ۸ritablement. Par ailleurs, la rﺣ۸flexion intellectuelle quﻗil promouvait dans ses ﺣ۸crits ne devait en aucun cas sﻗinfﺣ۸oder aux partis politiques :
ﺡ، Pour quﻗune pensﺣ۸e sﻗengage dans le rﺣ۸el, il ne faut pas et il ne saurait suffire quﻗelle se soumette ﺣ des rﺣ۸alitﺣ۸s dont elle ignore ou rﺣ۸pudie la loi interne : la tactique dﻗun parti, par exemple. Ce nﻗest pas dans lﻗutilisation accidentelle et partisane dﻗune pensﺣ۸e que rﺣ۸side son engagement. Cﻗest au contraire, dans sa dﺣ۸marche intime, dans son ﺣ۸lan premier, dans sa prise sur le rﺣ۸el et dans sa volontﺣ۸ de le transformer, donc finalement de le dominer [27] . ﺡﭨ
Le sens de ce terme dﻗengagement, le philosophe Paul-Louis Landsberg sﻗefforﺣ۶a de le dﺣ۸finir ﺣ son tour en 1937, dans un article dﻗEsprit qui impressionna vivement Mounier, et qui donne quelques clﺣ۸s supplﺣ۸mentaires quant ﺣ la maniﺣ۷re dont Rougemont concevait lui-mﺣ۹me le rapport de lﻗﺣ۸crivain ﺣ la Citﺣ۸. Landsberg insistait notamment sur le caractﺣ۷re ﺡ، imparfait ﺡﭨ de la cause qui engage :
ﺡ، Nous ne sommes pas libres de produire un idﺣ۸al arbitraire du fond de notre individualitﺣ۸ et de refuser au nom de cette perfection rﺣ۹vﺣ۸e toute activitﺣ۸ concrﺣ۷tement historique. Il nﻗy a guﺣ۷re de pareille activitﺣ۸ sans une certaine dﺣ۸cision pour une cause imparfaite, car nous nﻗavons pas ﺣ choisir entre des principes et des idﺣ۸ologies abstraites, mais entre des forces et des mouvements rﺣ۸els [ﻗ۵]. Il est bien difficile de se dﺣ۸cider pour une cause imparfaite, cﻗest-ﺣ -dire pour nﻗimporte quelle cause humaine ; mais la valeur dﻗun engagement consiste en grande partie dans la coexistence et la tension productive entre lﻗimperfection de la cause et le caractﺣ۷re dﺣ۸finitif de lﻗengagement [28]. ﺡﭨ
De mﺣ۹me que Landsberg jugeait la valeur de lﻗengagement ﺣ son caractﺣ۷re ﺡ، dﺣ۸finitif ﺡﭨ, Rougemont, ﺣ la suite de Kierkegaard, aurait peut-ﺣ۹tre ﺣ۸crit ﺡ، absurde ﺡﭨ. Ainsi dans LﻗAmour et lﻗOccident, ﺣ propos de la fidﺣ۸litﺣ۸ dans le mariage : ﺡ، Pour moi, renonﺣ۶ant dﻗemblﺣ۸e ﺣ toute apologie rationaliste ou hﺣ۸doniste, je ne parlerai que dﻗune fidﺣ۸litﺣ۸ observﺣ۸e en vertu de lﻗabsurde, parce quﻗon sﻗy est engagﺣ۸, simplement, et que cﻗest un fait absolu, sur quoi se fonde la personne des ﺣ۸poux [29]. ﺡﭨ Lﻗargument pourrait donner lieu ﺣ quelque ironie, quand on sait les affres de la vie privﺣ۸e de Rougemont dans les annﺣ۸es suivant cette ode ﺣ la fidﺣ۸litﺣ۸. Mais il reste intﺣ۸ressant ﺣ prendre en compte comme indication de tendance. Sans doute, en effet, est-ce un trait essentiel de la notion personnaliste dﻗengagement, dont lﻗexigence ﺣ۸thique dﺣ۸terminait la nature et la durﺣ۸e. Dﻗailleurs, Rougemont ne cessa de rappeler quﻗil consacra la seconde moitiﺣ۸ de sa vie ﺣ la promotion de lﻗidﺣ۸e europﺣ۸enne : si lﻗon suit cette logique littﺣ۸ralement, on pourrait dire quﻗil a pris un engagement ﻗ comme lorsque lﻗon se marie ﻗ, malgrﺣ۸ ﺡ، lﻗimperfection ﺡﭨ de la construction effective de lﻗEurope, malgrﺣ۸ les ﺡ، attentes dﺣ۸ﺣ۶ues [30] ﺡﭨ.
Ce discours et sa mise en pratique nﺣ۸cessitent nﺣ۸anmoins dﻗﺣ۹tre examinﺣ۸s ﺣ travers une analyse plus approfondie, car Denis de Rougemont a construit au cours de son existence, en pleine conscience, son propre mythe : Lﻗﺣ۸crivain, lﻗEuropﺣ۸en [31]ﻗ۵
B. Lﻗengagement sartrien
Jean-Paul Sartre a-t-il apportﺣ۸ des ﺣ۸lﺣ۸ments nouveaux ﺣ la conception de lﻗengagement dﺣ۸veloppﺣ۸e par Rougemont et les personnalistes ? Le dﺣ۸bat sur lﻗengagement intellectuel fut de fait relancﺣ۸ en octobre 1945, quand le philosophe publia sa ﺡ، prﺣ۸sentation des Temps modernes ﺡﭨ, oﺣﺗ il dﺣ۸finissait les orientations de la revue naissante. Accusant Flaubert et Goncourt dﻗavoir ﺣ۸tﺣ۸ ﺡ، responsables de la rﺣ۸pression qui suivit la Commune parce quﻗils nﻗont pas ﺣ۸crit une ligne pour lﻗempﺣ۹cher ﺡﭨ, invoquant ﺣ lﻗinverse la ﺡ، responsabilitﺣ۸ ﺡﭨ prise en leur temps par Voltaire ou Zola, Sartre en appelait lui aussi ﺣ une ﺡ، littﺣ۸rature engagﺣ۸e ﺡﭨ, indﺣ۸pendante des partis, mﺣ۹me si elle devait nﺣ۸cessairement et constamment prendre position sur les ﺣ۸vﺣ۸nements politiques et sociaux [32]. Lﻗﺣ۸cho de ce manifeste fut considﺣ۸rable dans les milieux intellectuels franﺣ۶ais. Jean Paulhan, Andrﺣ۸ Gide et dﻗautres ﺣ۸crivains ﺣ۸tablis sﻗoffusquﺣ۷rent de ce quﻗils considﺣ۸raient comme une ﺡ، subordination de la littﺣ۸rature ﺣ la politique ﺡﭨ. Dans le premier numﺣ۸ro des Cahiers de la Plﺣ۸ﺣﺁade, succﺣ۸dant ﺣ la NRF, Paulhan prit ainsi soin de prﺣ۸ciser que les Cahiers ﺡ، ne se croient pas tenus de prendre parti dans les grands conflits sociaux ou nationaux. Sﻗils se trouvent travailler ﺣ une nouvelle conscience du monde, ce sera sans lﻗavoir voulu [33] ﺡﭨ. Or, comme le souligne justement Anna Boschetti, Sartre ne faisait lﺣ que retrouver des ﺡ، modﺣ۷les familiers, esquissﺣ۸s par dﻗautres durant lﻗentre-deux-guerres [34] ﺡﭨ. Rougemont ne sﻗen scandalisa pas. Albert Camus le sollicita pour quﻗil donne son opinion sur le sujet dans le numﺣ۸ro de Combat de juillet 1946, et lﻗﺣ۸crivain livra un texte datﺣ۸ de lﻗavant-guerre [35], car le problﺣ۷me nﻗavait pas changﺣ۸ ﺣ ses yeux. Or, au contraire, tout avait changﺣ۸ selon Sartre.
Ce changement ne se situait pas tant du point de vue de la doctrine de lﻗengagement, dont la premiﺣ۷re formulation par Sartre ﺣ۸tait en effet assez proche de celle des personnalistes, que dans ﺡ، lﻗimage de rupture radicale avec le passﺣ۸ que Sartre avait de sa position ﺡﭨ, selon ﺡ، le schﺣ۷me structurant : Il a ﺣ۸tﺣ۸ ditﻗ۵ mais moi je vous dis [36] ﺡﭨ, un schﺣ۷me dont Denis de Rougemont usa dﻗailleurs sans rﺣ۸serve dans les annﺣ۸es trente, nous lﻗavons vu, en affirmant avec force ses positions, marquant ainsi nettement son statut dﻗintellectuel ﺡ، non-conformiste ﺡﭨ. La stratﺣ۸gie de Sartre consista dﻗabord ﺣ marteler la situation prﺣ۸tendument inﺣ۸dite de lﻗﺣ۸crivain :
ﺡ، Pour nous, en effet, affirmait Sartre, lﻗﺣ۸crivain nﻗest ni Vestale, ni Ariel : il est dans le coup quoi quﻗil fasse, marquﺣ۸, compromis, jusque dans sa plus lointaine retraite. [ﻗ۵] Nous voulons en tirer les conclusions pratiques. Puisque lﻗﺣ۸crivain nﻗa aucun moyen de sﻗﺣ۸vader, nous voulons quﻗil embrasse ﺣ۸troitement son ﺣ۸poque ; elle est sa chance unique : elle sﻗest faite pour lui et il est fait pour elle. [ﻗ۵] Nous ne voulons rien manquer de notre temps : peut-ﺣ۹tre en est-il de plus beaux, mais cﻗest le nﺣﺑtre ; nous nﻗavons que cette vie ﺣ vivre, au milieu de cette guerre, de cette rﺣ۸volution peut-ﺣ۹tre. [ﻗ۵] Lﻗﺣ۸crivain est en situation dans son ﺣ۸poque : chaque parole a des retentissements [37]. ﺡﭨ
Sartre enfonﺣ۶ait le clou, et certains historiens le prirent au mot, voyant lﺣ une nouveautﺣ۸ absolue : ﺡ، Le rapport avec lﻗHistoire devient consubstantiel du statut dﻗintellectuel, affirme ainsi Jean-Franﺣ۶ois Sirinelli. La littﺣ۸rature se veut dﺣ۸sormais engagﺣ۸e et revendique un lien ﺣ۸troit avec son temps, quﻗelle proclame du reste ﺣ double sens : la littﺣ۸rature est insﺣ۸rﺣ۸e dans son temps, elle est donc miroir ; lﻗﺣ۸crivain est engagﺣ۸, il est donc acteur [38]. ﺡﭨ Admettons cette hypothﺣ۷se. Si tel est le cas, il faut supposer avec Jean-Paul Sartre que ses ﺡ، prﺣ۸dﺣ۸cesseurs croyaient se tenir en dehors de lﻗHistoire [39] ﺡﭨ. Or quﻗen est-il des personnalistes ? Sartre nﻗen dit rien, car ce sont les romanciers quﻗil cible avant tout. Il nﻗen reste pas moins que la conscience de leur historicitﺣ۸ ﺣ۸tait bien prﺣ۸sente chez eux, Landsberg lﻗayant trﺣ۷s clairement identifiﺣ۸e comme lﻗun des critﺣ۷res essentiels de lﻗengagement : ﺡ، Notre destinﺣ۸e humaine, ﺣ۸crivit ce dernier, est tellement impliquﺣ۸e dans une destinﺣ۸e collective que notre vie propre ne peut jamais gagner son sens quﻗen participant ﺣ lﻗhistoire des collectivitﺣ۸s auxquelles nous appartenons. Dans la mesure oﺣﺗ nous vivons en pleine conscience cette participation, nous rﺣ۸alisons la prﺣ۸sence historique, lﻗhistoricitﺣ۸ essentielle ﺣ lﻗhumanisation de lﻗhomme [40]. ﺡﭨ Il est significatif que Sartre ne sﻗy soit jamais rﺣ۸fﺣ۸rﺣ۸, mﺣ۹me briﺣ۷vement, pour nuancer son tableau.
Sartre troqua ainsi ce rendez-vous manquﺣ۸ avec lﻗHistoire contre un autre. Un tel transfert sﻗimposa en raison de la violence de la guerre : entre les annﺣ۸es trente et le dﺣ۸veloppement de lﻗanalyse sartrienne, lﻗEurope fut le thﺣ۸ﺣ۱tre dﻗune telle tragﺣ۸die que lﻗengagement de lﻗﺣ۸crivain ﺡ، au centre du cyclone ﺡﭨ sﻗﺣ۸tait en quelque sorte rﺣ۸vﺣ۸lﺣ۸ ﺣ lui : ﺡ، Il nous a fallu, pour nous dﺣ۸couvrir, lﻗurgence et la rﺣ۸alitﺣ۸ physique dﻗun conflit. ﺡﭨ Considﺣ۸rﺣ۸ comme la consﺣ۸quence dﻗun trauma historique, lﻗengagement ﺣ۸tait dﺣ۷s lors fortement marquﺣ۸ par la brutalitﺣ۸ de son ﺣ۸closion, Sartre nﻗayant plus quﻗun seul projet en tﺣ۹te, celui dﻗune ﺣ۸criture ﺡ، des grandes circonstances ﺡﭨ. Revendiquant lﻗhﺣ۸ritage dﻗune littﺣ۸rature de rﺣ۸sistance, qui nﻗavait pourtant ﺡ، pas produit grand-chose de bon ﺡﭨ ﺣ ses yeux, il invitait lﻗﺣ۸crivain ﺣ rompre avec le confort de ses aﺣ؟nﺣ۸s, car ﺡ، le temps des vaches grasses ﺡﭨ ﺣ۸tait rﺣ۸volu [41]. La littﺣ۸rature engagﺣ۸e avait dﺣ۸sormais pour fonction dﻗenregistrer et de rﺣ۸flﺣ۸chir les soubresauts de lﻗhistoire, une histoire qui venait de rappeler ses dramatiques effets. En gﺣ۸nﺣ۸ralisant sa vision de lﻗengagement ﺣ partir dﻗune situation extrﺣ۹me, Sartre postulait lﻗﺣ۸tat de guerre permanent, tout en portant un immense espoir de renouveau. Dﻗoﺣﺗ lﻗemphase : ﺡ، Nous nﻗavons que cette vie ﺣ vivre, au milieu de cette guerre, de cette rﺣ۸volution peut-ﺣ۹tre [42]. ﺡﭨ ﺣ sa maniﺣ۷re, le philosophe Peter Sloterdijk a dﺣ۸crit la psychologie de lﻗﺣ۸crivain qui cherchait ﺣ combler le vide existentiel, aprﺣ۷s la surcompression :
ﺡ، La fin brutale de quarante millions de personnes avait mis lﻗatmosphﺣ۷re en vibration, une ﺣ۸mission mystique qui dﺣ۸vorait les vivants comme une faute sans limite. Un fossﺣ۸ semblait sﻗﺣ۹tre ﺣ jamais creusﺣ۸ entre les individus et les missions universelles, et seul un bond absurde pouvait permettre ﺣ ceux qui, malgrﺣ۸ tout, voulaient se rendre utiles, dﻗatteindre cette terre ferme que constituait un travail sur un projet concret. Depuis, sﻗengager signifie vouloir se sauver en bondissant dans une mission ﺣ remplir [43]. ﺡﭨ
La rﺣ۸volution ﺣ laquelle appelait Sartre dans sa ﺡ، prﺣ۸sentation des Temps modernes ﺡﭨ, ce nﻗﺣ۸tait pas lﻗﺣ۸crivain ﻗ marquﺣ۸ pour lﻗﺣ۸ternitﺣ۸ par son origine bourgeoise ﻗ mais le Peuple qui devait en constituer le vecteur principal. Ceci explique entre autres que Sartre fut constamment prﺣ۸occupﺣ۸ par la question du divorce entre lﻗﺣ۸crivain et son public. Il ﺣ۸tablit alors une distinction entre public rﺣ۸el (les bourgeois) et public virtuel (les ouvriers), en vertu de laquelle il put ﺡ، feindre dﻗﺣ۸crire pour des lecteurs qui ne le lisent pas et faire semblant dﻗignorer qui le lit vraiment [44] ﺡﭨ. De fait, le problﺣ۷me ﺣ۸tait quasi insoluble : pas plus que dﻗautres, Sartre nﻗa rﺣ۸ussi ﺣ toucher vﺣ۸ritablement le Peuple, les ouvriers ; tout au plus a-t-il produit un discours sur le Peuple, lu par les bourgeois quﻗil dﺣ۸testait tant, non par le Peuple quﻗil chﺣ۸rissait. Bien quﻗattachﺣ۸ ﺣ la restauration dﻗune ﺡ، commune mesure ﺡﭨ entre la culture et la sociﺣ۸tﺣ۸, entre lﻗﺣ۸crivain et le Peuple, Rougemont nﻗen concluait pas pour autant que ﺡ، le sort de la littﺣ۸rature ﺣ۸tait liﺣ۸ ﺣ celui de la classe ouvriﺣ۷re [45] ﺡﭨ. Les titres de quelques-uns de ses livres suffiront ﺣ illustrer ce point : Lettres aux dﺣ۸putﺣ۸s europﺣ۸ens, Lettre ouverte aux Europﺣ۸ens, LﻗAvenir est notre affaireﻗ۵ Autant dﻗappels adressﺣ۸s, soit aux ﺣ۸lites politiques, soit aux hommes et aux femmes dont la conscience europﺣ۸enne ﺣ۸tait embryonnaire, et quﻗil se donnait pour mission dﻗﺣ۸veiller. Rougemont ne raisonnait jamais en termes de classes. Son public, cﻗﺣ۸tait non seulement les prolﺣ۸taires, mais aussi la communautﺣ۸ des hommes ﺡ، renouvelﺣ۸s ﺡﭨ, cﻗest-ﺣ -dire ﺡ، rendus ﺣ la conscience de leur libertﺣ۸ ﺡﭨ : ﺡ، Il nous faut dire que cﻗest lﻗhomme en tant quﻗhomme ﻗ et pas seulement le non-bourgeois ﻗ qui pﺣ۱tit du dﺣ۸sordre ﺣ۸tabli [46]. ﺡﭨ Dans cette optique, lﻗﺣ۸crivain engagﺣ۸ avait pour fonction de dessiner un avenir possible, ﺡ، au nom dﻗune vision meilleure quﻗil annonce, illustre, anticipeﻗ۵ [47] ﺡﭨ. Comme le souligne Antoine Prost, ﺡ، ces nuances, cependant, ne sont guﺣ۷re perceptibles ﺣ lﻗopinion dans le contexte de la Libﺣ۸ration et la force de lﻗengagement communiste influenﺣ۶a tous les autres engagements au point quﻗon a pu confondre, pendant quelques annﺣ۸es, engagement et engagement au service de la classe ouvriﺣ۷re [48] ﺡﭨ. Sartre ne fit pas peu pour entretenir cette confusion.
Sﻗil en appelait constamment ﺣ lﻗaction, Rougemont aurait sans doute nﺣ۸anmoins fait sienne cette remarque dﻗun historien caractﺣ۸risant avant tout Esprit et LﻗOrdre nouveau comme des ﺡ، laboratoires de pensﺣ۸e [49] ﺡﭨ. Reformulant plus tard sa position, il appelait ainsi ﺣ faire preuve de rﺣ۸alisme et dﻗhumilitﺣ۸ quant au sens et ﺣ lﻗﺣ۸tendue souhaitables de lﻗengagement de lﻗﺣ۸crivain : ﺡ، Responsable est celui qui peut dire, dans une situation donnﺣ۸e : jﻗen rﺣ۸ponds. Mais de quoi lﻗﺣ۸crivain comme tel peut-il rﺣ۸pondre, sinon de son ﺧuvre elle-mﺣ۹me, de sa pensﺣ۸e et de son style ? [50] ﺡﭨ Or, ﺣ sa faﺣ۶on, Sartre brouillait quelque peu la frontiﺣ۷re entre lﻗengagement politique et lﻗengagement intellectuel, en traitant de ﺡ، moralistes ﺡﭨ tous ceux qui condamnaient lﻗactivisme partisan. Il reprochait ﺣ Denis de Rougemont, ﺡ، cet Europﺣ۸en ﺡﭨ, qualifiﺣ۸ ﺡ، dﻗhomme doux, bien ﺣ۸levﺣ۸ et, par-dessus le marchﺣ۸, un Suisse ﺡﭨ, de discourir dans le vide ﺡ، au nom du droit des gens ﺡﭨ et dﻗocculter le problﺣ۷me de la violence rﺣ۸elle quﻗimpliquait le jeu des forces politiques [51]. ﺣ lﻗinverse, la conception sartrienne de la praxis nﻗﺣ۸tait pour Rougemont quﻗune maniﺣ۷re de sortir de son rﺣﺑle dﻗﺣ۸crivain et de penseur. Ainsi ﺣ propos des surrﺣ۸alistes, auxquels Sartre reprochait de ﺡ، noircir beaucoup de papier ﺡﭨ, sans jamais rien dﺣ۸truire ﺡ، pour de vrai ﺡﭨ :
ﺡ، Lﻗﺣ۸crivain qui dﺣ۸truirait pour de vrai, selon Sartre, ne pourrait le faire par lﻗﺣ۸criture mais par lﻗapplication de ce quﻗil a ﺣ۸crit ﺣ la rﺣ۸alitﺣ۸ matﺣ۸rielle du physique, donc en cessant dﻗﺣ۹tre ﺣ۸crivain, en reniant sa fonction propre, tel un poteau indicateur qui dﺣ۸ciderait de faire lui-mﺣ۹me le chemin et cesserait aussitﺣﺑt dﻗﺣ۹tre utile. La vraie rﺣ۸volution nﻗest pas celle qui dﺣ۸truit, et la production de valeurs et dﻗun modﺣ۷le neuf de sociﺣ۸tﺣ۸ nﻗa jamais ﺣ۸tﺣ۸ le fait du militant de base (ﺣ۸lecteur, manifestant, grﺣ۸viste ou franc-tireur), mais dans tous les cas que lﻗon connaﺣ؟t, dﻗhommes qui ont ﺣ۸crit et mﺣ۹me beaucoup ﺣ۸crit. Ce nﻗest pas parce quﻗil nﻗa rien cassﺣ۸ pour de vrai que Breton nﻗﺣ۸tait pas engagﺣ۸, mais parce que sa pensﺣ۸e ne fut jamais en puissance dﻗaction politique et demeure purement subversive (comme le fait de descendre dans la rue un revolver dans chaque main et de tirer au hasard sur les passants, qui dﺣ۸finit lﻗacte surrﺣ۸aliste, selon lﻗun des premiers textes de Breton) [52]. ﺡﭨ
Sartre sentait parfaitement quﻗil fallait dﺣ۸passer la rﺣ۸volte surrﺣ۸aliste, et souhaitait lﻗﺣ۸mergence dﻗune littﺣ۸rature qui fﺣﭨt ﺣ la fois nﺣ۸gation et construction : ﺡ، La littﺣ۸rature concrﺣ۷te sera synthﺣ۷se de la Nﺣ۸gativitﺣ۸, comme pouvoir dﻗarrachement au donnﺣ۸, et du Projet, comme esquisse dﻗun ordre futur. ﺡﭨ Mais au dﺣ۸but des annﺣ۸es 1950, il remit le ﺡ، Projet ﺡﭨ entre les mains du PC, seul mﺣ۸diateur autorisﺣ۸ du changement rﺣ۸volutionnaire, pariant sur le fait que le parti sorte un jour du moment totalitaire dans lequel il se trouvait, car ﺡ، la nﺣ۸gativitﺣ۸ du parti communiste [contraiﺡrement ﺣ la nﺣ۸gativitﺣ۸ surrﺣ۸aliste] est provisoire, cﻗest un moment historique nﺣ۸cessaire dans sa grande entreprise de rﺣ۸organisation sociale [53] ﺡﭨ. La profesﺡsion de foi allait justifier ainsi plusieurs annﺣ۸es de compagnonnage avec le communisme, une sympathie qui ne commenﺣ۶a ﺣ se fissurer quﻗﺣ partir de la rﺣ۸pression hongroise en 1956. Mais, en dﺣ۸pit de tout, lﻗespﺣ۸rance rﺣ۸volutionnaire demeurait nﺣ۸anmoins intacte [54].
Dans un hommage rendu ﺣ lﻗﺣ۸crivain suisse, Jacques Ellul souligna ﺡ، la constance, la consﺣ۸quence qui a caractﺣ۸risﺣ۸ la pensﺣ۸e de Denis de Rougemont. Il a posﺣ۸ vers 1930 un certain nombre de prﺣ۸misses quﻗil nﻗa jamais reniﺣ۸es, il a formulﺣ۸ un certain nombre de diagnostics qui se sont toujours vﺣ۸rifiﺣ۸s. Or, le monde intellectuel nﻗattache pas une aussi grande valeur et notoriﺣ۸tﺣ۸ ﺣ cette constance quﻗﺣ lﻗinconsﺣ۸quence spectaculaire qui caractﺣ۸rise nos ﺣ۸lites. [ﻗ۵] Je laisse de cﺣﺑtﺣ۸ les spﺣ۸cialistes de la palinodie comme Sartre, justifiﺣ۸ par avance par sa philosophie [55] ﺡﭨ. Il est trop simple, comme le fait Jacques Ellul, de sﻗen tenir ﺣ cette opposition binaire entre la consﺣ۸quence de Rougemont et la palinodie de Sartre. A sa maniﺣ۷re, et malgrﺣ۸ certains invariants comme la notion centrale de ﺡ، personne humaine ﺡﭨ, Denis de Rougemont a lui aussi rﺣ۸visﺣ۸ ses idﺣ۸es et leur formulation au grﺣ۸ du contexte idﺣ۸ologique et politique. Il faut sortir des approches apologﺣ۸tiques, et rﺣ۸examiner au plus prﺣ۷s les textes, le milieu, les rﺣ۸seaux au sein desquels a ﺣ۸voluﺣ۸ cet ﺣ۸crivain tournﺣ۸ vers lﻗaction. Tel est lﻗobjet de notre livre : Denis de Rougemont. Les intellectuels et lﻗEurope au xxe siﺣ۷cle, que de mieux apprﺣ۸cier ce parcours et cet engagement apparemment sans faille.


 mythe-imaginaire-sociﺣ۸tﺣ۸
-
mythe-imaginaire-sociﺣ۸tﺣ۸
-