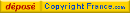Bernard PINIAU
Le dialogue des cultures et la double position d’André Malraux
Samedi 23 novembre 1996. Place du Panthéon. Tandis que se déroule l’hommage visuel et sonore réglé par Jean-Paul Chambas et que le cercueil, contenant la dépouille d’André Malraux, remonte la rue Soufflot, le Président de la République s’apprête à prendre la parole.
Cet hommage, je le regarde à la télévision, et le souvenir, et les images, et le ton superbement incantatoire d’un autre discours prononcé ici par André Malraux lui-même, me revient à la mémoire. Jean Moulin… C’était en 1964 et j’étais malade, déjà… Je découvrirai, plus tard, heureux, que bien des gens que rien ne rapprochait de la famille politique d’André Malraux l’avaient eux aussi écouté, ce soir là, la gorge nouée : Pierre Goldman notamment. Jacques Chirac sait-il la difficulté de l’exercice auquel il va se livrer, en ce même lieu ? Bien sûr…
André Malraux engageait la France tout entière et s’engageait lui-même. Il affirmait qu’au-delà des différences de générations, d’opinions politiques ou de croyances, il est des instants où une nation se rassemble autour des valeurs qui la fondent et ceci pour mieux la faire vivre.
J’écoute… La voix du chef de l’Etat s’impose rapidement, et l’évidente sincérité de son discours. L’Indochine, l’Asie, la relation avec le Parti communiste, l’Espagne, la Résistance, le Gaullisme, l’art, l’écriture, la fonction ministérielle, le mémorialiste…, le ton est didactique, le parcours chronologique ; Jacques Chirac entend s’adresser à la jeunesse, à cette partie de la jeunesse qui connaît sans doute moins bien la biographie haletante et la somptuosité tellurique de l’écriture d’André Malraux.
J’écoute… et l’un des thèmes profonds du discours revient :
André Malraux, je voudrais vous dire, ce soir, pourquoi l’hommage de toute la nation, acte d’évidence, est aussi le signe de notre engagement.
Je viens de terminer un long travail[1] consacré à l’histoire mal connue du dialogue des cultures, à l’apparition quelque peu tâtonnante de ses pratiques au tournant du siècle, à la naissance de l’idée avec l’UNESCO autour de 1945, puis à l’invention de l’expression, dans un cadre européen, en 1961, par Denis de Rougemont ; au long rejet de cette notion par nos institutions françaises, à cause de l’idée d’universalité de la culture française qu’elles avaient mises en oeuvre, puis à son adoption officielle, en 1981, parce que cette notion d’universalité pouvait alors évoluer… Et, malgré tout, à l’approche qui avait été celle de Malraux, ministre des Affaires culturelles de 1959 à 1969, et à son apport en qualité de ministre, partiel certes, limité, mais indiscutable.
Ce travail reconstituait une trame, dénombrait des faits, établissait des dates, mais au-delà de cette approche historique, il y avait bien eu un choc philosophique, dont la paternité revient à André Malraux.
Tellurique, disions-nous à propos de son style ? Tel pourrait bien être en effet la qualificatif approprié pour décrire cet apport fondamental, cette métamorphose brutale à laquelle il commença d’abord par assister, qu’il comprit, et qu’il accéléra, en en tirant toutes les conclusions intellectuelles, esthétiques et sensibles, qui nous bouleverse nous-mêmes en bouleversant notre rapport au monde et qui, risquée, insécurisante en diable et superbe, constitue peut-être son apport théorique le plus riche et le plus original, quoiqu’il n’ait jamais été, à ma connaissance, souligné ni par ses biographes ni par ses exégètes.
Télévision. Malraux répond aux questions de Jean-Marie Drot :
- « Le déclenchement intérieur, en vous, du Musée Imaginaire ?
- « C’est le fait que, étant familier du cubisme, j’ai pu me trouver en face de la culture de l’Inde ou de la Chine comme d’une chose normale, et non pas d’un choc exotique, ce qui à l’époque était assez rare ».
Le souvenir est précis. Il renvoie à la Première Guerre mondiale, à Kahnweiller, à Max Jacob, à Pablo Picasso. Malraux n’avait pas vingt ans.
Dans l’Introduction générale de la Métamorphose des Dieux, Malraux écrit, gouailleur : « L’Occident a découvert l’art africain avec les bananes ? Constatons qu’il n’avait pas découvert l’art mexicain avec le chocolat. Les explorateurs de l’Afrique n’ont pas découvert l’art nègre, mais les fétiches : les conquistadores n’ont pas découvert l’art mexicain mais les idoles aztèques. Dans toutes leurs Isles, les Européens n’avaient trouvé que des curiosités »[2]
Cette idée, Malraux la reprend et la développe dans L’Intemporel, troisième volume de la Métamorphose :
[... de l'art nègre ] la société de 1900 n’avait retenu – à peine – que l’exotisme ou l’amusante maladresse. Le domaine où elle l’eût accueilli n’existait pas – n’existait que pour quelques artistes. On connut d’abord les «bonshommes», que l’on appela folkloriques parce que les coloniaux rapportaient d’Afrique les fétiches qui ressemblaient aux marionnettes. Les masques pénétraient en Europe par les collections d’ethnographie, surtout celles que les Allemands avaient formées au Cameroun et au nouveau Mecklembourg. Picasso seul, lorsqu’il découvrit le Musée du Trocadéro, ressentit leur caractère magique, indifférent à ses amis [ . . . ]. Paul Guillaume vendait à grand peine ses fétiches [ . . . ]. La sculpture africaine resta longtemps prisonnière des collections d’ethnographie. En raison, disait-on, de son anonymat ; les maîtres des grottes chinoises, hindoues, étaient-ils moins anonymes ? Puiqu’on parlait d’Ajanta comme d’un sculpteur, pourquoi pas de l’ethnie Dogon ?[3]
Malgré la force des questions, ce n’est évidemmment pas dans ces précisions successives que réside l’apport déterminant d’André Malraux. Ils restituent un contexte, que l’on pourrait d’ailleurs étendre à la musique, à la danse, aux «rituels», à ce que l’on n’appelle pas encore la littérature orale, et que l’on pourrait préciser en fonction de la géographie.
Non, l’apport de Malraux est capital lorsqu’il poursuit, toujours dans l’Introduction générale :
« L’Europe a découvert l’Art nègre lorsqu’elle a regardé des sculptures africaines entre Cézanne et Picasso, et non des fétiches entre des noix de coco et des crocodiles. Elle a découvert la grande sculpture de la Chine à travers les figures romanes, non à travers les chinoiseries. Et elle n’a pas découvert l’art roman au bout du monde, mais aux murs et aux chapitaux de ses églises…[4]
Alors, Cézanne et Picasso, comme l’art médiéval, seraient des pédagogues, des médiateurs ? Non plus. Ce qui est en jeu, là, est beaucoup plus profond que cela, beaucoup plus tellurique…
La métamorphose du passé fut d’abord une métamorphose du regard. Sans une révolution esthétique, jamais la sculpture des hautes époques, la mosaïque, le vitrail, n’eussent rejoint la peinture de la Renaissance et des grandes monarchies ; jamais les collections d’ethnographie, si vastes qu’elles fussent devenues, n’eussent franchi la barrière qui les séparait des musées. Il eût été vain que l’Europe dominât la terre, si elle n’avait suscité la peinture par laquelle les artistes l’ont opérée de la cataracte, et qui lui a révélé le «pouvoir de formation» d’oeuvres dont elle attribuait la «déformation» à l’impuissance et à la maladresse<[5]
La métamorphose du passé fut d’abord une métamorphose du regard. Sans une révolution esthétique…Tout est dit.
Pour percevoir la diversité des mondes, pour accéder à celle-ci, il nous faudra d’abord renoncer à l’ordre d’une certaine tradition, qui était nôtre, et qui interdisait absolument cette perception, cette accession. Pour accéder, il nous faut renoncer. Renoncer à nous-mêmes pour devenir nous-mêmes, un nous-mêmes plus large, plus grand, plus riche de divers et somptueux miroitements… Et il y aura lutte pour cela. Lutte, en Europe[6] Par delà les dates – mais gardons bien en mémoire celle du souvenir confié à Jean-Marie Drot – c’est là que s’enracine, que s’invente, lentement, à des rythmes diversifiés selon les genres artistiques considérés – et laissons ici momentanément de côté le politique, les mouvements de revendication des indépendances – la philosophie de ce qui deviendra plus tard ce que nous appelons le dialogue des cultures, la philosophie qui le rend possible.
La génération des grands intellectuels généralistes nés dans les années 1870 – Paul Valéry, André Gide, Thomas Mann, etc… avait été européenne ; une Europe à laquelle il fallait ajouter une vaste extension : les Etats-Unis, comme Dvorak et Mahler nous le rappellent. Avec la génération née autour de 1900, ce n’est plus seulement de l’Europe, c’est du monde qu’il va s’agir, avant, après et même pendant le grand étranglement du nazisme. Certes, il y avait eu l’étonnant éclair de lucidité de Valéry – mais tout théorique : : il n’y était jamais allé – à propos de la guerre du Japon contre la Russie, des Etats-Unis contre l’Espagne, et de ce qu’elles annonçaient – mais le monde se met à vivre, dans son infinie diversité, l’expression est de Max Weber, pour la génération suivante : Moravia, Malraux, Klaus Mann, Hemingway, Senghor, Breton, Carpentier, et le processus s’accélérera encore avec la génération des années vingt… Encore le parcourir ne sert-il de rien. Il faut pouvoir le penser. Conceptuellement, esthétiquement, poli-tiquement… Et procéder à ces vastes réajustements du regard – cette opération de la cataracte – sans quoi on pourrait sans doute le voir, mais certainement pas le regarder, et certainement pas tenter de le penser.
Or ce que montre Malraux au travers de la peinture et de la sculpture, comme Olivier Messiaen et Pierre Boulez le montreront en musique, comme Antonin Artaud le montrera, disons, des arts de la scène, de la danse, du théâtre et de leur expressivité, comme Breton ensuite, et Caillois, c’est que, pour naviguer au large, au loin, vraiment au loin – ce qui d’ailleurs veut peut-être dire tout près ! – il faut littéralement démâter le navire, et le remâter autrement.Que l’on ne procède pas par addition, en ajoutant des mâts et des voiles pour aller plus loin, mais en adoptant un autre dispositif. Les masques africains, les poupées Hopi, l’art de Nouvelle Guinée ne sont pas venus s’ajouter, naturellement, nos connaissances s’accroissant, au domaine de l’art que nous savourions. Il a fallu changer le domaine en question. Changer le domaine de référence. « Le domaine où elle l’eût [l'art nègre] accueilli n’existait pas ».
Le monde de l’art dans lequel nous admirons un fétiche dogon n’a qu’indifférence pour la logique de ceux du raffinement et de la beauté. Pour que le masque Kanaga se métamorphose en oeuvre d’art, il faut que se métamorphose insensiblement le domaine de référence qui va l’annexer. Et qu’il y contribue. [ . . . ] Alors les arts sans histoire contraignent le Musée Imaginaire à mettre en question quelques unes des idées sur lesquelles il croyait se fonder[7]
Et les premiers chapitres de l’Intemporel sont consacrés à cette remise en question, au conflit entre les Officiels et les Indépendants : Les Indépendants veulent créer une nouvelle peinture. Les Officiels, découvrir une nouvelle représentation : trouver un nouvel illusionnisme plus convaincant que le précédant.
[ . . . ] Le conflit dans lequel s’élabore l’art moderne est plus profond qu’un conflit entre un présent et une survivance du passé, même dérisoire. Et nous ne pouvons le ramener ni à un conflit d’écoles, ni à une rupture comme celle qui fait succéder Giotto à la peinture byzantine (Cézanne ne succède pas à Cabanel), car ce combat ne fut pas seulement de formes, mais sans doute le plus violent affrontement de valeurs que connaisse l’histoire de l’art. Les Officiels prétendaient continuer le Louvre au nom de l’illusion ; les Indépendants, au nom des valeurs spécifiques de la peinture …[8]
Claude Debussy, Olivier Messiaen, Pierre Boulez vivront, toutes choses égales, dans ce que ce dernier nommera admirablement « la rupture du cercle d’Occident », un identique conflit. Il ne s’agit plus, pour eux, de trouver des recettes permettant d’exotiser une partition, comme d’autres un tableau ou un objet, de les orientaliser par exemple, comme Puccini orientalise encore Turandot, avec d’ailleurs un immense talent musical, en 1925, et comme d’autres se livrent au même exercice, avec succès, mais en des partitions fades et décoratives, grâce à des procédés et des ornementations convenus. Il s’agit au contraire de trouver, dans des oeuvres extra-européennes, des réponses que l’on peut qualifier à la fois de techniques et d’organiques – et non plus d’exotiques – aux problèmes formels qui se posent à eux.
Après, seulement après, ou, plus justement, parallèlement, mais avec, toujours, de légers décalages, il y aura donc les avatars, le jeu des dates, la constitution des collections, les expositions, les concerts, les spectacles – et leur progressif changement de statut. Les artistes découvrent les arts primitifs dans les collections d’ethnographie ? Bien sûr et c’est, de même, à l’Exposition universelle de Paris, en 1889, que Debussy avait entendu de la musique orientale, à l’Exposition coloniale de Marseille en 1922 qu’Antonin Artaud a vu des danses cambodgiennes. À l’exposition coloniale de Paris, en 1931, qu’il voit du théâtre balinais et que Messiaen entend de la musique extra-européenne. Une trentaine d’années plus tard, lorsque le Théâtre des Nations commence à reprendre dans sa programmation ces mêmes «spectacles», l’univers culturel dans lequel il les présentera n’aura plus rien à voir avec celui des expostions coloniales.
Or, en 1954, on achève justement de décrocher des cimaises des Musées nationaux les toiles des Officiels, remplacées, sur les murs, par celles des Indépendants. Comme le rappelle opportunément la republication, par Janine Mossuz-Lavau, de textes de Malraux devenus introuvables[9]c’est en 1946 qu’il demande que l’on « envoie au grenier (il est absurde de détruire quoi que ce soit) les navets académiques qui encombrent les musées de province ». Il demande, mais c’est Jean Cassou qui fait le travail, et commence alors à décrocher !
Et l’onde de choc philosophique poursuit sa course… Dans la revue Diogène qu’il fonde en 1953, André Caillois note :
Vu l’élargissement des connaissances, la culture ne saurait se limiter aux traditionnels apports gréco-latins… Aujourd’hui, les Humanités sont loin de coïncider avec l’Humanisme[10]
Même si Caillois recourt à l’image, trop simple, « d’élargissement », nous savons bien, nous, que les Humanités des autres ne nous parviennent que sous la forme de Livres des Merveilles, de Livres des Sagesses – comme le Mahâbhârata nous en apporte à nouveau la preuve – mais qu’elles ne sont actives, agissantes, qu’au travers d’une révolution esthétique de l’ordre de celle que décrit Malraux et qui accompagne une révolution – au sens étymologique du mot – de l’ensemble des civilisations. Ce sont les civilisations modernes qui, aujourd’hui, réenvisagent leur passé et qui entreprennent de dialoguer entre elles… L’intrusion de la cuvette de wc en émail blanc, qui gênait tant Tanizaki[11]parce qu’elle détruisait l’ordre esthétique d’un intérieur japonais, était sans doute d’origine, d’invention occidentale, mais lorsque l’usage s’en répandit, elle bouleversa aussi, comme l’intrusion du téléphone dans un cabinet de travail au tournant du siècle, tout un ordre esthétique européen !
Et il est d’ailleurs permis de se demander, en regardant la création contemporaine japonaise – de l’architecture aux arts plastiques – si Malraux ne s’est pas prononcé trop tôt lorsqu’il écrivit :
L’Extrême-Orient n’a pu maintenir ou retrouver son indépendance qu’en intégrant un concept occidentalisé de l’homme, malgré les caractères idéographiques. L’industrie japonaise, le marxisme chinois, ne sont pas des gadgets. [ . . . ] Une Asie qui ne peut devenir elle-même qu’en renonçant à l’ordre de sa tradition, est désarmée devant le Musée Imaginaire occidental. Car il annexe les oeuvres asiatiques survivantes, alors que la tradition extrême-orientale ne l’annexe pas, parce qu’elle n’existe plus[12]
A propos des Humanités des autres, ni Caillois à l’UNESCO, ni Malraux en ministre, ne feront fondamentalement évoluer la position de l’Éducation nationale. Même s’il a besoin, pour sa formulation, des travaux des universitaires, c’est pour l’essentiel par la culture que le message passera, ce qui explique peut-être sa très inégale diffusion dans le corps social, forte ici, beaucoup plus faible ailleurs… Toujours est-il que le problème est posé, et dans des termes qui doivent beaucoup à la pensée de Malraux.
Sa réponse n’était pas la seule possible. Oublions celle de l’indifférence et du repli sur soi. Vers 1975, il écrit :
[ . . . ] le grand art nègre est un art enseveli, non dans la terre, mais dans le secret des cultes animistes, qu’assure aujourd’hui encore le silence d’un continent. Ce qui ne va pas sans conséquences, pour un art où l’intensité magique tient le rôle que tient la beauté dans l’esthétique classique[13].
Au même moment, je réside en forêt équatoriale, au nord-est du Zaïre, et sillonne cette région qui vient d’être le théâtre d’intenses mouvements de rébellions dans lesquelles une partie de la jeunesse a pris une part active. Les sorciers – et l’ordre intolérable qu’ils représentent et incarnent à la fois – ont été spécialement visés, et nombre d’entre eux assassinés. Le secret des cultes animistes ? Le silence d’un continent ? Ils gisent, là… avec les sorciers.
Les grands mouvements révolutionnaires du tiers-monde, les aspirations que traduisaient les mouvements beaucoup plus informels des rébellions, constituaient une autre, il faudrait même dire l’autre réponse possible à ces questions. Et s’ils ont été parfois porteurs du pire, ils participaient de ces voies diverses – mais pas si nombreuses que cela – de l’accession à la modernité… Et je comprends que du temps soit nécessaire pour qu’un jeune du Haut-Zaïre regarde, sans gène particulière, une parure cérémonielle exposée dans un musée occidental… Combien de temps nous a-t-il fallu pour regarder, sans trouble émotion, une parure royale ? Souvenons-nous de Flaubert. Etrange et complexe dialogue des cultures, tout parcouru de courants et de forces contraires.
Dans l’introduction à l’Atlas de l’imaginaire, je m’étais efforcé de montrer que cette notion de dialogue des cultures n’avait aucun fondement scientifique, qu’elle n’avait cessé d’être une pure notion de politique culturelle, avant que d’entrer, sans majuscules ni guillemets, dans le langage commun.
Reste que son long rejet par les institutions françaises, puis son adoption par celles-ci en 1981, pose un problème de fond. Quelle a été, à son propos, la position de Malraux ministre ? Il n’emploie jamais l’expression alors qu’il en déploie de manière plus aiguë que quiconque toute l’ampleur philosophique. Il en initie, au niveau des institutions, la pratique, tout en en limitant considérablement l’usage !
Eliminons ou, plus exactement, laissons de côté la part de la subjectivité. Elle est omniprésente, et ne constitue en aucun cas un trait distinctif. Debussy, Apollinaire, Artaud, Breton, Messiaen, Soustelle, Leiris, Levi-Strauss, Eloy, chacun élira, dans le monde sonore et visuel, en fonction de ses propres préoccupations et de sa propre sensibilité, son domaine de référence privilégié, ses «ethnies» de prédilection, et notre connaissance collective progressera en fonction de ces choix intimes. Bon !
La définition de la culture, des cultures, telle que l’UNESCO la diffuse alors, paraît à Malraux trop simpliste ? Oui et non. Oui, lorsqu’il est dit : c’est l’expression de tous les peuples. Non, lorsque l’organisation internationale lui offre une formidable tribune pour appeler au sauvetage des temples d’Egypte menacés par la montée des eaux du Nil : « Notre civilisation rassemble les oeuvres devenues fraternelles de tant de civilisations qui se haïrent ou s’ignorèrent »[14]
Résumons. Il n’aime guère, on le sait, la musique. Ni la nôtre ni, à fortiori, celle des autres… Et l’on chercherait en vain, sous son ministère, une aide notable en faveur des musiques traditionnelles… Le théâtre ? Il fait ce qu’il faut mais il est, à titre personnel, très sélectif. Il préfère les arts visuels. Le message de l’UNESCO lui est connu. Il s’est exprimé à ce sujet dès 1946[15] et maîtrise parfaitement toute la problématique, née au XIXème siècle, du passage au pluriel de la notion de culture, et de l’abandon, dans celle de civilisation, de toute référence au raffinement.
Non, le problème est ailleurs et, encore une fois, d’ordre philosophique. Mais il est capital car il touche au noyau dur de la philosophie de l’Etat. Une philosophie certainement partagée à l’époque – on n’a pas de sondages ! – par une très large majorité de Français. Cette question philosophique, c’est celle de l’universalité de la culture française, et c’est bien celle qui hante, d’une certaine manière, le discours de Jacques Chirac, le soir du 23 novembre 1996, place du Panthéon.
Il y a accord, et en même temps rupture, entre la philosophie de l’Etat, celle des institutions nouvelles de la Vème République, et la philosophie intime du ministre d’Etat ! Cette universalité c’est, dans un ensemble de citadelles symboliques qui se sont effondrées, un dernier bastion renforcé, ravivé en 1958,. et les ministres du général de Gaulle, comme le général lui-même, y tiennent farouchement. De Molière à Victor Hugo en passant par Descartes, la culture française exprime une expérience de l’homme valable pour tous, partout, et en tous temps. C’est en ce sens qu’elle est universelle. Elle parle à tous les hommes et pour tous les hommes. Qu’il soit asiatique, latino-américain ou africain, tout homme est sensible au message des Misérables. Cette doctrine univoque architecture la puissante politique de diffusion de la culture française mise en place par le ministre des Affaires étrangères de 1959 à 1969.
Elle s’oppose à toute idée de dialogue des cultures, qui suppose un relativisme inacceptable au terme duquel la culture française ne serait qu’une au milieu de dix, de cent autres, également estimables, également riches, également porteuses d’un passé et d’un avenir. Irrecevable.
Or, si Malraux est convaincu du génie français, il sait, lui, qu’il y en a d’autres… Il récuse probablement l’unanimisme excessif de l’UNESCO, mais n’a pas besoin de le récuser expressément car ce n’est pas son problème. Ce qui l’intéresse c’est la plus haute expression symbolique de sociétés vivantes ou disparues, leurs oeuvres, leurs chefs d’oeuvres, leurs créations, et le dialogue – là, il emploie l’expression – qui naît entre eux, au XXème siècle, dans le cadre du Musée Imaginaire. Ce qui dialogue, ce ne sont pas les sociétés, ce sont ces chefs d’oeuvre… D’où les expositions qu’il organise, ministre, et qui sont les premières à avoir cette envergure, sur le Mexique, l’Egypte, l’Art nègre, la Perse, le Japon, et par où s’insinue une très acceptable relativisation des cathédrales et de Versailles car elle n’en remet pas en cause, pour la Vème République naissante, l’absolue primauté. Le continuum est affirmé.
En 1982, François Mitterrand et Jack Lang, en modifiant partiellement mais, en même temps, profondément dans cette partialité même, l’approche et la définition de la notion d’universalité de la culture française, ils ouvrent la voie à un dialogue non point tous azimuths mais considérablement élargi, qui met d’une part en lumière le rôle qu’ont sans cesse joué artistes étrangers et cultures étrangères dans la constitution de la culture française – sa nature métisse – et, d’autre part,la nécessité d’un dialogue artistique – on reçoit des témoignages de la vie artistique des autres comme on permet aux autres de voir les témoignages de la nôtre – autant que diplomatique, que monétaire, qu’agricole, portant sur le respect des souverainetés, les termes de l’échange, les cours des matières premières, etc…
Reste qu’au fond, avec les débuts de la Vème République comme aujourd’hui, la réflexion intime de Malraux demeure largement iconoclaste, et conserve son pouvoir tellurique… Que la famille gaulliste, disons, au sens large, conservatrice, s’y soit, en France, si longtemps opposée, alors que son ministre-écrivain en était l’auteur, appelait une réconciliation, et c’est cette réconcilation, cette acceptation de l’héritage qu’opère aussi le Chef de l’Etat lorsqu’il fait entrer le corps d’André Malraux au Panthéon. Au travers de l’oeuvre de Malraux c’est la réconciliation d’une famille de pensée que son profond nationalisme, et son sens de la légitimité, avaient conduite à sous estimer et le poids et la richesse et la diversité du monde, comme à récuser les profondes déchirures qui constituent aussi son propre continuum historique.
Réconciliation, car d’autres hommes, sans aller peut-être aussi loin dans l’ordre de la réflexion, avaient, contre la famille gaulliste, continué de constituer des collections, de faire entendre des musiques, d’inviter des spectacles, de faire progresser la recherche universitaire, toutes démarches constitutives du dialogue des cultures…
Alors, pourquoi avoir employé un peu plus haut l’expression de miroitements et dit que voyager au loin, c’était peut-être voyager tout près ? Parce que cette pensée demeure une projection occidentale, et qu’après Michel Foucault, V.Y. Mudimbe[16], en des pages d’une grande finesse, en a bien dit les limites épistémologiques. Si, à partir de 1982, le dialogue des cultures devient un outil si utile, si pratique, dans les relations avec les quelque deux cents Etats qui composent désormais la planète, si, au-delà même de la doctrine, s’affirme sa valeur technico-diplomatique, c’est bien parce que s’affirme un autre ordre qui est de l’ordre du même, et qui prolonge, déploie, enveloppe… Le système n’était pas épuisé ? Non, le système n’était pas épuisé !
Reste, à l’inverse, que peu de cultures sont capables d’un tel ressourcement critique, d’une telle métamorphose, d’une telle secousse tellurique. Bien d’autres n’y auraient pas survécu et, d’ailleurs, en sont mortes. De cet ordre du même, il n’y a donc pas lieu de rougir. Au contraire. Même s’il convient de s’y mouvoir avec lucidité.
Le dialogue avec l’Inde – perçue, depuis le début du siècle, comme le modèle de l’autre grande civilisation vivante – un dialogue régulièrement repris, relancé, conduit dans toutes les voies du savoir, et dans les deux sens, montre bien, à lui seul, la difficulté de l’entreprise…
Quant au dialogue avec l’ensemble des cultures traditionnelles hier rassemblées sous le vocable unique de tiers-monde, nous savons bien qu’il pose plus de questions qu’il n’en résoud.
C’est bien, comme le remarquait justement Georges Balandier, autour des terres de modernité, partout surgies, que gens du Sud et gens du Nord pourront se retrouver.
Bernard PINIAU
Janvier 1997
Université Paris 8
Tous droits réservés © 2009


 mythe-imaginaire-société
-
mythe-imaginaire-société
-